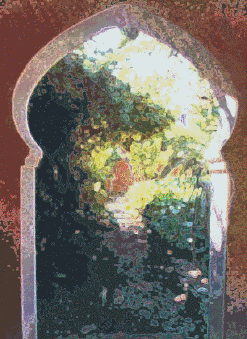|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 25 mars 2010, 01:47 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 1 445 |
Etats-Unis: la loi sur la santé devra être revotée
Rebondissement | La loi sur la réforme de l'assurance maladie de Barack Obama devra être renvoyée devant la Chambre des représentants pour un nouveau vote en raison d'une irrégularité de procédure.
© KEYSTONE | Ce rebondissement constitue un revers pour Barack Obama.
AFP/ATS | 25.03.2010 | 08:47
Dernière mise à jour: 25.03.2010 | 09:23
Ce revirement est dû à l'adoption jeudi au Sénat de deux clauses techniques sur la régularité du vote.
Le Sénat a engagé un vote marathon dans la nuit de mercredi à jeudi sur des dizaines d'amendements déposés par les républicains à propos des "corrections" apportées au texte par la Chambre.
Mais ils y ont adjoint un ensemble de modifications pour le rendre plus conforme à leurs exigences et c'est sur cet additif législatif que les sénateurs républicains ont engagé une bataille d'amendements, tous rejetés méthodiquement par les démocrates.
Or, deux clauses "mineures et techniques" ont été retenues par les sénateurs sur la procédure de vote concernant une réforme des prêts étudiants, a déclaré un porte-parole du chef de la majorité démocrate au Sénat Harry Reid.
Par conséquent, un nouveau vote devra être organisé à la Chambre des représentants sur cet ensemble de modifications, retardant la mise en oeuvre du texte réclamée par Obama.
"Après des heures à essayer de bloquer" le texte, les Républicains "ont trouvé deux dispositions relativement mineures qui constituent des vices de la procédure du Sénat et nous allons devoir renvoyer le texte devant la Chambre des représentants", a déclaré mercredi soir (jeudi matin en Suisse) Jim Manley, porte-parole du chef de la majorité au Sénat Harry Reid.
Rebondissement | La loi sur la réforme de l'assurance maladie de Barack Obama devra être renvoyée devant la Chambre des représentants pour un nouveau vote en raison d'une irrégularité de procédure.
© KEYSTONE | Ce rebondissement constitue un revers pour Barack Obama.
AFP/ATS | 25.03.2010 | 08:47
Dernière mise à jour: 25.03.2010 | 09:23
Ce revirement est dû à l'adoption jeudi au Sénat de deux clauses techniques sur la régularité du vote.
Le Sénat a engagé un vote marathon dans la nuit de mercredi à jeudi sur des dizaines d'amendements déposés par les républicains à propos des "corrections" apportées au texte par la Chambre.
Mais ils y ont adjoint un ensemble de modifications pour le rendre plus conforme à leurs exigences et c'est sur cet additif législatif que les sénateurs républicains ont engagé une bataille d'amendements, tous rejetés méthodiquement par les démocrates.
Or, deux clauses "mineures et techniques" ont été retenues par les sénateurs sur la procédure de vote concernant une réforme des prêts étudiants, a déclaré un porte-parole du chef de la majorité démocrate au Sénat Harry Reid.
Par conséquent, un nouveau vote devra être organisé à la Chambre des représentants sur cet ensemble de modifications, retardant la mise en oeuvre du texte réclamée par Obama.
"Après des heures à essayer de bloquer" le texte, les Républicains "ont trouvé deux dispositions relativement mineures qui constituent des vices de la procédure du Sénat et nous allons devoir renvoyer le texte devant la Chambre des représentants", a déclaré mercredi soir (jeudi matin en Suisse) Jim Manley, porte-parole du chef de la majorité au Sénat Harry Reid.
|
Re: Géopolitique 26 mars 2010, 02:35 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le bras de fer israélo-américain
Lorsqu’on ne laisse pas entrer les cameras, c’est qu’on ne veut pas se sourire. Quand on ne fait pas de déclaration finale, c’est qu’on a trop de désaccords pour les afficher et c’est donc portes fermées, loin de tout journaliste, que Barack Obama a reçu, hier, Benjamin Netanyahu.
L’entretien a été long, 90 minutes. Le Premier ministre est ensuite resté deux heures de plus à la Maison-Blanche pour une raison qui n’a pas été précisée. C’est tout ce que la presse a pu apprendre mais beaucoup de choses s’étaient déjà dites, publiquement, depuis l’arrivée de Benjamin Netanyahu à Washington, quarante-huit heures plus tôt. Devant le congrès annuel de l’AIPAC, la principale organisation américaine de soutien à Israël, la secrétaire d’Etat américaine, Hilary Clinton, avait ouvert le feu en déclarant que le soutien à Israël était, pour elle, un « engagement personnel » mais que la responsabilité des Etats-Unis était de « reconnaître les mérites » de leur allié « quand il y avait lieu de le faire et de dire la vérité lorsqu’il le fallait ».
« La poursuite des constructions à Jérusalem-Est et en Cisjordanie affaiblit la confiance mutuelle », avait-elle enchaîné en déclarant que « le statu quo n’était pas tenable » et que « toutes les parties, Israël compris, devaient faire des choix difficiles mais nécessaires ». C’était une réponse on ne peut plus carrée à Benjamin Netanyahu qui avait déclaré, lui, juste avant de prendre l’avion pour Washington, que « construire à Jérusalem, c’était comme construire à Tel-Aviv », autrement dit comme dans n’importe quelle ville israélienne puisque la position d’Israël est que les quartiers Est de Jérusalem dont aucun pays ne reconnaît l’annexion font partie de sa capitale, « une et indivisible ».
Pas du tout, venait de lui dire Hilary Clinton et Benjamin Netanyahu, loin de reculer, a alors enfoncé le clou en martelant, devant le même congrès de l’Aipac : « Jérusalem n’est pas une colonie. C’est notre capitale » avant d’expliquer aux journalistes israéliens qui l’accompagnent que, « si les Américains soutiennent les demandes déraisonnables des Palestiniens sur un gel des constructions à Jérusalem, le processus politique risque d’être bloqué pendant un an ». C’était une fin de non-recevoir à laquelle le département d’Etat rétorque immédiatement, par la voix de son porte parole, que « la question du statut final de Jérusalem doit être résolu par la négociation » et que « les deux parties auront à faire des compromis sur Jérusalem, les réfugiés, les frontières et un certain nombre d’autres dossiers ». C’est là qu’on en était avant les entretiens à huis clos du Bureau ovale.
Américains et Israéliens protestent de leur inébranlable amitié mais c’est une crise. Elle n’ira évidemment pas jusqu’à une rupture entre les deux pays mais le fait est que, depuis son élection, Barack Obama n’a pas cessé de faire monter la pression sur Benjamin Netanyahu, que le président américain vient de sortir renforcé de sa victoire sur la réforme de la couverture médicale et que le Premier ministre israélien ne bénéficie, lui, d’aucun soutien international puisque toutes les grandes puissances font front, contre lui, avec les Etats-Unis.
|
Re: Géopolitique 26 mars 2010, 02:43 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'Europe, devant l'incendie
Pour ce qui est de l’image, ce n’est pas vraiment ça. A moins d’un jour de l’ouverture du Conseil européen, ce soir, à 17h, rien n’était encore acquis. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont pour ainsi dire passé la journée d’hier au téléphone à chercher une position commune sur l’aide à la Grèce pendant que leurs conseillers respectifs planchaient non stop. En début de soirée, on ne savait pas même si les discussions auraient assez avancé pour que les seize dirigeants de la zone euro puissent être saisis d’un projet de compromis au cours d’une réunion qui précéderait l’ouverture du Conseil ou s’ils ne pourraient se réunir qu’après le dîner à 27, après une nouvelle journée de conciliabules.
Tout cela donne une bien piètre image de l’Union et de la zone euro mais, au-delà de cette confusion, c’est peut-être l’Europe qui s’invente, là, dans la confusion, comme toujours, d’une crise à chaud.
Mettons les choses en perspective. Avant la crise grecque, avant qu’on ne découvre que les comptes publics de ce pays avaient été maquillés et que ses déficits étaient presque deux fois plus importants qu’on ne le croyait, avant ce coup de tonnerre qui pourrait ébranler toute la zone euro, il y avait eu celui de l’automne 2008. Le krach de Wall Street avait alors mis tout le système bancaire et, donc, l’économie mondiale au bord de la faillite et, pour faire face, l’Europe, les pays qui la composent, avaient du improviser une réaction commune.
Cela aurait pu être mieux, beaucoup mieux et plus rapide mais, l’un dans l’autre, l’Union avait colmaté les brèches, évité une vraie catastrophe et, dans cette situation d’urgence, l’Allemagne et la France avaient retrouvé une connivence en prônant, côte à côte, une plus grande régulation de l’économie mondiale et une concertation internationale non plus seulement entre les huit plus vieilles puissances économiques mais, également, avec les puissances émergentes. Tirée par Paris et Berlin, l’Europe avait joué un rôle déterminant dans ce passage du G-8 au G-20. L’Europe s’était affirmée en acteur de la scène internationale et, sur cette lancée, la France et l’Allemagne avaient décidé de travailler à un nouveau rapprochement qui avait abouti, cet hiver, à leur accord sur la nécessité d’un gouvernement économique de l’Europe à laquelle s’était rallié l’ensemble de l’Union.
Le Conseil d’aujourd’hui sera, de fait, la première réunion de ce gouvernement, un balbutiement qui n’en est pas moins une révolution mais, entretemps, il y avait eut la Grèce qui oblige l’Europe à une deuxième révolution, à l’invention d’une solidarité dont les traités n’avaient pas voulu afin que l’euro ne soit pas l’assurance vie d’Etats membres à gestion trop laxiste.
Sur le papier, cette rigueur avait une logique mais, lorsqu’il y a le feu et qu’il risque de se propager, que le Portugal faiblit après la Grèce, il faut bien, à la fois, éteindre l’incendie et trouver les moyens d’en prévenir d’autres. Il faut bien adapter les traités, inventer l’Europe des réalités, et c’est tout l’enjeu de cette fébrilité, de cette confrontation au bord du gouffre entre les intérêts, les cultures et les contraintes de politique intérieure des différents pays de l’euro.
|
Re: Géopolitique 30 mars 2010, 15:18 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Barack et Nicolas vont, désormais, s'aimer
Entre eux, le courant ne passait pas mais, ça y est, ils vont tout faire pour que cela change. Reçu, demain, dans le Bureau ovale après la conférence qu’il donne, aujourd’hui, à New York, Nicolas Sarkozy sera ensuite l’hôte de Barack Obama, dans ses appartements privés, pour un dîner à quatre, les deux présidents, leurs épouses et eux seuls.
C’est « un témoignage d’amitié particulier », souligne-t-on fièrement à l’Elysée et c’est vrai. Que ce mot d’« amitié » soit ou non le bon, Barack Obama marque, là, une volonté de tourner la page sur une période, il y a juste un an, où Nicolas Sarkozy l’avait sérieusement agacé.
Le président français sortait, alors, de son grand moment diplomatique, le deuxième semestre 2008. En tant que président de l’Union européenne, il venait de négocier un compromis entre Russes et Géorgiens qu’il avait fait avaliser, aux forceps, par les 27. Non seulement, à travers lui, la France avait joué dans cette affaire un rôle d’autant plus éclatant que les Etats-Unis s’étaient mis aux abonnés absents mais, sitôt cette crise réglée, Nicolas Sarkozy avait très vite réagi au krach de Wall Street. Repassant du modèle anglo-saxon au modèle européen, il avait littéralement imposé aux Etats-Unis la convocation d’un sommet réunissant puissances établies et puissances émergentes, le G-20 qui s’est institutionnalisé depuis.
Durant six mois, Nicolas Sarkozy avait été à son meilleur et sans rival sur la scène internationale, une sorte de roi du monde qu’il était devenu en profitant à la fois de ses bonnes relations avec Georges Bush et de la position de faiblesse dans laquelle se trouvait le président américain sortant, totalement déboussolé par l’échec de sa présidence et la crise financière sur laquelle elle s’achevait.
Nicolas Sarkozy aurait aimé prolonger ce moment et l’élection de ce jeune Démocrate dont le monde était tombé tellement amoureux lui avait fait, disons-le, de l’ombre. Barack Obama, de son côté, n’était pas naturellement porté à une grande sympathie pour ce Français qui avait tant aimé son prédécesseur et pas du tout détesté l’intervention américaine en Irak.
Entre ces deux hommes, cela démarrait mal et ça ne s’était pas arrangé lorsque Nicolas Sarkozy s’était raidi sur l’Iran auquel Barack Obama tentait, lui, de « tendre la main » et avait rééquilibré la politique proche-orientale de la France en faveur d’Israël tandis que Barack Obama rééquilibrait celle des Etats-Unis en faveur des Palestiniens. A la condescendance du premier répondait l’indifférence du second, presque du mépris, mais les temps ont changé.
Affaibli, Nicolas Sarkozy a désormais besoin de se rapprocher de la Maison Blanche pour peser dans le jeu international. Renforcé par son rapprochement avec la Russie et l’adoption de sa réforme de la couverture médicale, Barack Obama peut, lui, se montrer d’autant plus magnanime qu’il découvre que l’Europe existe, que les Etats-Unis ont besoin d’elle et que la France y compte. Cette soudaine « amitié » s’appelle le réalisme.
|
Re: Géopolitique 30 mars 2010, 15:23 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Partie serrée à Moscou
Rappelé par les attentats de Moscou, c’est un lien, vieux de vingt ans déjà, sanglant et plein d’ombres. Entre la politique intérieure russe et les déchirements du Caucase, l’interférence remonte à l’époque où Boris Eltsine, voulant disloquer l’URSS pour pouvoir chasser Mikhaïl Gorbatchev du Kremlin et l’y remplacer, attisait les indépendantismes en appelant les peuples soviétique à prendre « le plus d’autonomie possible ».
Cyniquement parlant, c’était bien vu. C’est ainsi que Boris Eltsine était devenu calife à la place du calife sur les décombres d’un empire qui avait été celui des tsars mais, entré au Kremlin, il avait vite buté sur la Tchétchénie. Nulle part ailleurs que là-bas, dans la Caucase, son appel n’avait été autant entendu car les Tchétchènes ont gardé le souvenir de la conquête russe au 19ième siècle et, surtout, de leur déportation par Staline à la fin de la guerre. La Tchétchénie voulait son indépendance et Boris Eltsine ne pouvait que s’y opposer car cette République est partie intégrante de la Fédération de Russie dont il devait défendre l’intégrité avant que la Fédération ne se délite à son tour. Ce fut la guerre, une guerre perdue par la Russie, une défaite que les Russes avaient mal pardonnée à leur président et que Vladimir Poutine, devenu Premier ministre en août 1999, avait voulu effacer pour mieux se mettre en lice pour le Kremlin. Dès septembre, une série de mystérieux attentats aussitôt attribués aux Tchétchènes précipitent les choses. C’est le déclanchement de la deuxième guerre de Tchétchénie qui assure, au printemps 2000, un triomphe électoral à Vladimir Poutine, candidat de l’ordre et de la fierté russe retrouvée.
Dix ans après, non seulement cette guerre n’est toujours pas vraiment gagnée par la Russie, non seulement elle s’est étendue à tout le Caucase du Nord sous la direction d’islamistes illuminés qui ont pris le relais des nationalistes, mais les attentats ont repris, à l’automne dernier, en Russie même, alors qu’ils y avaient cessé depuis 2004. Avec cette boucherie du métro de Moscou, la Tchétchénie revient en force sur la scène politique russe, au moment précis où un petit vent de liberté commençait d’y souffler, suscité par la rivalité montante entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev.
Les deux hommes ont condamné avec une égale fermeté ces attentats suicide qui bien sûr, les desservent puisque ni l’un ni l’autre n’ont su les empêcher. Tous deux sont atteints mais si l’homme d’ordre, Vladimir Poutine, le super flic et Premier ministre, enregistre un échec, l’homme de l’ouverture, ce jeune Président qui venait de s’attaquer à la corruption de la police et du ministère de l’Intérieur, se retrouve, lui, dans l’impasse. Il venait de nommer un homme à lui à la tête du Caucase où il prônait le développement économique en réponse au terrorisme. Il incarnait l’aspiration à moins d’arbitraire et plus de démocratie alors que ces attentats redonnent évidemment la main aux partisans de la manière forte, aux services secrets dont est issu Vladimir Poutine et dont le siège, la Loubianka, se situe au dessus de la station où a eu lieu le premier des deux attentats d’hier. L’interférence se poursuit. La partie devient serrée.
|
Re: Géopolitique 03 avril 2010, 10:06 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les excuses de la Serbie
Il a fallu quinze ans de recul et treize heures de débats, mais c’est fait. A l’issue d’une séance retransmise en direct par la télévision, le Parlement serbe a adopté, la nuit dernière, une résolution reconnaissant et condamnant le massacre commis, en juillet 1995, contre la population de Srebrenica, le plus atroce des crimes de guerre commis en Europe depuis la fin du nazisme.
A l’époque, les conflits nés de l’éclatement de la Yougoslavie se concentraient en Bosnie Herzégovine, la plus multiethnique des Républiques sorties de cette fédération désunie dans le sillage de la chute du Mur de Berlin. Trois populations se mêlaient en Bosnie, des Serbes, des Croates et des Musulmans, des musulmans convertis aux temps de l’occupation ottomane et auxquels la Yougoslavie avait donné un statut national pour asseoir leurs droits. En Bosnie, les Croates voulaient leur rattachement à la Croatie, les Serbes à la Serbie alors que les Musulmans voulaient conserver à cette République ses anciennes frontières fédérales car elle était, à leurs yeux, leur Etat nation comme les autres peuples yougoslaves avaient désormais le leur.
En ce début de l’été 1995, les forces bosno-serbes, armées et financées par la Serbie, veulent donc s’assurer le contrôle du nord-est de la Bosnie, de la région limitrophe de la Serbie, pour créer une continuité territoriale qui aurait préludé à la constitution d’une grande Serbie les rattachant à la mère patrie. Ces forces touchent au but mais se heurtent à un dernier obstacle, l’enclave de Srebrenica où des dizaines de milliers de Musulmans se sont réfugiés autour de cette ville où ils sont majoritaires. Protégée par l’Onu, cette enclave leur a paru sûre mais les forces bosno-serbes l’assiègent, s’en rendent maîtres sans que les casques bleus ne bougent et c’est alors que le crime à lieu. Les familles sont séparées, femmes et enfants d’un côté, hommes et adolescents de l’autre. Les femmes sont évacuées en autobus et les hommes, 8000 hommes, sont massacrés, méthodiquement, en groupes et à la mitraillette.
La Serbie avait longtemps nié ce massacre qu’elle a laissé faire si ce n’est encouragé mais, maintenant que le temps a passé, que d’autres générations la dirigent et, surtout, qu’elle aspire à entrer dans l’Union européenne, son Parlement a présenté ses « excuses » aux familles des victimes car « tout n’a pas été fait, dit la résolution adoptée hier, pour empêcher cette tragédie ».
Les plaies se pansent. La page se tourne. Les Etats issus de la Yougoslavie pourront tous retrouver, un jour, au sein de l’Union mais une responsabilité morale reste à établir, celle de l’Europe, de l’Amérique et de l’Onu qui ont beaucoup contribué à ce crime non seulement parce qu’elles ne l’ont pas empêché mais, aussi, parce que leur politique yougoslave aura été totalement incohérente. Au lieu de faire un choix, de défendre le maintien de la Fédération ou de promouvoir son partage en Etats nations, elles ont voulu imposer en Bosnie le multiethnisme qu’elles avaient laissé détruire au niveau fédéral avant d’imposer, par les armes, une partition ethnique au Kosovo. Par leur cécité, elles ont attisé et prolongé une guerre qui portait en elle ce massacre.
|
Re: Géopolitique 03 avril 2010, 10:12 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'Eglise et son chemin de croix]
Il n’y a pas que cette cascade de révélations. L’Eglise catholique est aujourd’hui ébranlée par ces affaires de pédophilie mais, bien au-delà de ces scandales, l’Eglise est confrontée aux difficultés, et à la nécessité, d’un renouveau qu’elle se cherche depuis un demi-siècle.
Ancrée dans l’Europe, projetée dans le monde par la projection de l’Europe, essentiellement européenne bien que son nom signifie « universelle » en grec, l’Eglise catholique a du faire face, après guerre, au grand bouleversement géopolitique du dernier siècle. Pour la première fois depuis la Renaissance, le monde n’était plus dominé par l’Europe mais par une nouvelle puissance, les Etats-Unis, façonnée par le protestantisme et avec laquelle elle n’avait, donc, pas de connivence, ni politique ni culturelle.
Non seulement l’Eglise devait s’adapter à un monde dont les rapports de force n’étaient plus ceux dont elle avait naturellement bénéficié jusqu’alors mais elle devait, également, relever les défis de la montée de l’athéisme, des débuts de la libération de la femme, d’une contestation de plus en plus large de sa morale, d’une modernité, en un mot, à laquelle elle n’était pas prête.
Sa réponse à la profondeur et la multiplicité de ces changements fut Vatican II, le Concile de l’aggiornamento, de la mise à jour, durant lequel des évêques et des cardinaux ont débordé la Curie romaine pour imposer l’abandon de la messe en latin, de ce symbole de la toute puissance du clergé, le dialogue avec les autres branches du christianisme et la volonté de réconciliation avec le judaïsme. Menacée par les temps modernes, l’Eglise s’y ouvrait, voulait conquérir un respect que le déclin de son autorité ne lui assurait plus automatiquement mais une telle révolution ne se digère pas en jour.
Une fois adaptée au monde, l’Eglise devait s’adapter à son propre changement et cette tâche revint à un Pape venu de Pologne, pays vivant sous le communisme après avoir été crucifié par le nazisme. Jeune et habitué au combat, Jean-Paul II aura laissé deux legs à l’Eglise. Sous son pontificat, l’un des trois plus longs de l’histoire il y avait eu la réaffirmation de l’autorité du Vatican et d’une intransigeance morale, une reprise en main identitaire et centralisatrice aussi fermement menée que son autre bataille, la renaissance d’une Eglise combattante et présente parmi les hommes. Comme le Christ avait marché et parlé pour semer la bonne parole, Jean-Paul II fut un Pape voyageur, sillonnant les cinq continents pour interpeller les pouvoirs temporels, communiste et capitaliste, témoigner auprès des plus pauvres, tendre la main à tous, demander le pardon de ceux que l’Eglise avait blessés et appeler à la Justice.
Avec lui, l’Eglise avait retrouvé une force et une popularité, un message et un rôle mais, à la mort de ce très grand Pape, elle a choisi le repli. En élisant Benoît XVI, elle a choisi de mettre à sa tête l’homme qui n’incarnait que le premier des legs de Jean-Paul II, la reprise en main, et de remettre le témoignage à plus tard. Comme fatiguée de l’audace, c’est l’institution que l’Eglise a choisie, celle dont les faiblesses lui reviennent en boomerang.
|
Re: Géopolitique 03 avril 2010, 10:19 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'heure des choix pour Téhéran
Lentement mais sûrement l’étau se resserre sur Téhéran. Au cours d’une conférence téléphonique, l’Allemagne et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, se sont mis d’accord, hier, sur le principe de nouvelles sanctions économiques visant à contrer le développement du programme nucléaire iranien.
Après la Russie, la Chine a ainsi fini par se rallier aux Occidentaux dans cette crise et l’ensemble des grandes puissances devraient maintenant entamer des discussions à l’Onu sur l’ampleur et la nature de ces sanctions que l’Union européenne et les Etats-Unis veulent « dures ». Un projet de résolution américain circule déjà à New York et la situation s’est suffisamment modifiée, en défaveur de Téhéran, pour que le ministre iranien des Affaires étrangères ait accepté de se rendre à Pékin, aujourd’hui même, où les Chinois devraient lui lancer un ultime appel au dialogue.
Ou bien l’Iran va reculer, même à moitié, ne serait-ce que dans une énième tentative de gagner du temps, ou bien il devra faire face non seulement à des sanctions du Conseil de sécurité mais, également, à des sanctions additionnelles des Occidentaux dont l’impact cumulé pourrait peser lourd sur un régime déjà confronté à une très forte contestation intérieure et de grandes difficultés économiques.
On va voir. On le saura vite mais la certitude est que l’Iran est à l’heure des choix et que la scène internationale se modifie, à bas bruit mais profondément. Premier changement, l’Amérique est de retour. On la disait durablement hors-jeu, paralysée par les revers, internes et externes, de son président mais Barack Obama vient, coup sur coup, de faire adopter sa réforme de la couverture médicale et de se rapprocher de la Russie en finalisant avec elle un nouvel accord de réduction des armements stratégiques.
Non seulement le président américain peut ainsi marquer des points contre le régime iranien vis-à-vis duquel il peut hausser le ton car il lui avait, auparavant, tendu la main mais il accentue constamment, sans éclats mais fermement, ses pressions sur la droite israélienne. Rien n’a filtré des longs entretiens à huis-clos que Benjamin Netanyahou a eu la semaine dernière à la Maison-Blanche mais Barack Obama, deuxième changement, lui a fait clairement comprendre que l’intérêt national américain était qu’Israël accepte un gel total des constructions dans les Territoires occupés, y compris à Jérusalem-est, et s’engage dans de vraies négociations avec les Palestiniens.
Les choses bougent beaucoup plus qu’on ne le croit au Proche-Orient et, troisième changement, illustré par la crise iranienne, la Chine monte en puissance sur la scène diplomatique en y devenant aussi incontournable que sur le marché mondial. La Chine devient un arbitre de la scène internationale et, quatrième changement, l’Europe rassemble, petit à petit, ses forces en marchant vers une harmonisation de ses politiques économiques et rapprochant ses politiques étrangères. Rien de tout cela n’est joué, rien n'est acquis, mais, partout, le monde se modifie.
|
Re: Géopolitique 03 avril 2010, 15:50 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
|
Re: Géopolitique 04 avril 2010, 06:47 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Au nom d’une vision stratégique nouvelle correspondant à ce qu’ils estiment être leurs intérêts supérieurs, les USA, sous la nouvelle conduite du Président Obama ont décidé une réorientation radicale de leurs choix politiques. Israël n’est plus l’allié et l’ami privilégié, bien au contraire il serait devenu l’obstacle à une réconciliation des USA avec le monde arabo musulman.
Par son alliance avec Israël, les USA se priveraient d’une relation favorable avec le monde arabe, si riche en potentialités énergétiques et économiques. Israël est donc devenu le gêneur pour une hypothétique harmonie planétaire. L’obstination de cet Etat à affirmer son droit à vivre en tant qu’Etat souverain est aujourd’hui dénoncée par une offensive multiple visant à le délégitimer. C’est Israël qui est dénoncé comme faisant obstacle à la paix. C’est Israël qui est accusé de crimes contre l’humanité par un ubuesque conseil des droits de l’homme de l’ONU.
C’est Israël qui est nazifié. En attribuant au seul Israël la responsabilité du présent blocage on feint d’ignorer la responsabilité à multiples tiroirs de la partie adverse.
Cette réorientation stratégique est fondée sur une analyse fausse de la réalité des rapports de force en cours au Proche Orient et dans le Monde. Israël est prêt à la paix et prêt à faire des concessions majeures pour y parvenir. Israël a déjà fait la preuve dans le passé de sa capacité à échanger des territoires contre des traités de paix avec l’Egypte et avec la Jordanie mais Israël peux-t-il faire la paix avec celui qui à fait de son anéantissement l’objectif ultime de son combat ? Qui peut nier le lien historique, culturel, spirituel de la ville de Jérusalem avec le peuple juif ? Vouloir priver ce peuple de sa capitale consiste à nier ses fondements, à contester la légitimité du choix de son retour sur cette minuscule portion de terre au Proche Orient.
Jérusalem n’est pas une colonie. Elle est la capitale de l’Etat d’Israël. Elle est le lien symbolique de tout le peuple juif qui a inscrit depuis des siècles dans sa liturgie la prière de son retour. Contester au peuple juif ce droit consiste à contester les fondements de sa légitimité en tant que peuple et par là même en tant qu’Etat. Une imposture historique prétend inscrire Jérusalem dans le patrimoine fondamental de l’Islam dont la Palestine à venir serait le porte drapeau politique. Ce dispositif s’inscrit dans un grand projet de reconquête visant à faire du Proche Orient une terre exclusivement musulmane. Au Liban, au Soudan, en Irak, au Maghreb, les chrétiens sont depuis longtemps les victimes de cette offensive.
A l’intérieur de l’Europe, en France, en Belgique, aux Pays Bas, en Allemagne, en Suisse, la même offensive est à l’œuvre. Elle grignote chaque jour, de mois en mois, d’année en année, ce qui constituait jusqu’à pas si longtemps encore un beau patrimoine de civilisation. Ce qui aujourd’hui menace l’identité européenne, menace en priorité Israël. Estimer le contraire et penser que ce serait l’intransigeance israélienne qui menacerait des rapports pacifiés du monde occidental avec le monde arabo musulman relève de l’auto-illusion.
Qui peut croire que l’enjeu de conflit se réduirait à l’exigence arabe de récupérer dix kilomètres carrés et que ce serait la décision de construire des logements à Jérusalem qui menacerait un processus de paix illusoire. Le jour même de cette annonce stupide, l’Autorité Palestinienne annonçait de son côté qu’elle honorait la mémoire d’un grand tueur, Al Mugrabi, responsable en 1978 de l’assassinat de 38 citoyens israéliens et d’un photographe américain dans une spectaculaire opération terroriste contre un autobus civil. A symboles comparés, on reste stupéfait devant les choix des héros arabes.
Israël est prêt à échanger une partie de la Cisjordanie pour qu’elle devienne la future Palestine. Israël est prêt à garantir, et le fait déjà, le libre accès des lieux saints pour tous ceux qui trouvent dans Jérusalem la source de leur spiritualité mais Israël ne négociera pas sa souveraineté sur cette ville, sauf à considérer qu’Israël tout entier est une « implantation ». Obama est il prêt à rendre le Dakota aux Cheyennes, la Caroline aux Oglalas, le Minnesota aux Sioux ?
Certains arabes réclament le retour de l’Andalousie dans l’Oumma et le partage de Cordoue. Faut il céder à cette demande ? Le peuple palestinien a forgé son identité dans sa lutte contre Israël. Avant 1948, le peuple arabe de Palestine ne réclamait que faiblement ses droits nationaux à l’occupant ottoman, égyptien, ou anglais.
Le peuple palestinien fut inventé pour la cause du nationalisme arabe dont les Etats arabes firent le rebut pendant plus de soixante ans. Aujourd’hui ce peuple se définit comme tel et il a ses droits, ce que personne ne conteste mais ces droits ne sauraient se fonder sur la négation des droits de l’autre. On pouvait estimer depuis 1993, avec les accords d’Oslo, qu’un bout de chemin avait été fait côté palestinien mais l’intifada déclenchée en 2000 avait aussitôt démenti ce faux espoir. En Europe et aux Etats Unis on feint de croire que l’apaisement au Proche Orient réduirait la menace islamiste.
C’est ne rien comprendre à la stratégie à l’œuvre dans le monde musulman depuis la révolution islamiste en Iran en 1979. Le Hamas et le Hezbollah ont inscrit l’anéantissement d’Israël au cœur de leur projet politique. Peut-on négocier la paix avec celui qui veut votre mort ?
Par une suite ininterrompue d’offensives multiples, de replis tactiques, d’attaques terroristes, d’offensives culturelles, de pénétration démographique l’islamisme s’affirme comme la grande menace du XXIème siècle. Il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte qu’après les fascismes, après le communisme, l’islamisme est bien le grand projet totalitaire messianique qui menace les libertés dans le monde. On ne contraint un totalitarisme offensif par de bons sentiments.
Déjà du temps de la guerre froide le Mouvement de la paix confondait l’agresseur et l’agressé et préférait le totalitarisme soviétique au système libéral américain. Faire de l’attitude rétive d’Israël le premier obstacle à la paix est une erreur d’appréciation considérable. Ne pas prendre en compte le double discours palestinien constitue l’autre erreur de jugement.
Ne pas inscrire la tactique palestinienne dans la cadre plus large des stratégies arabes c’est faire preuve de courte vue. Ne pas inscrire ces stratégies dans la grande partie d’échecs qui se joue autour la bombe iranienne c’est faire preuve d’aveuglement. Ne pas voir qu’Israël, loin d’être un obstacle constitue le premier rempart contre cette agression, est le signe d’une disposition suicidaire de l’Occident.
Le 11 septembre 2001, l’attaque contre les USA avait apporté la preuve du choix délibéré du choc des civilisations voulu par l’islam radical. Par couardise ou par courte vue certains estiment aujourd’hui que tendre la main à celui qui veut votre mort est une bonne attitude, un bon choix stratégique. Ce qui menace Israël nous menace, nous démocraties occidentales. Loin de menacer la paix, Israël nous protège.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.