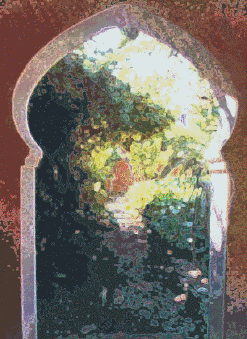|
|
Accueil des forums
>
ADRA - COMMENTAIRES
>
Discussion
Jacques Taieb - Soirée du livre à sa mémoire le 6 février
Envoyé par lapid
|
Jacques Taieb - Soirée du livre à sa mémoire le 6 février 06 mai 2011, 01:46 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 3 376 |
Décès de Jacques Taieb, co-fondateur de la SHJT
La Société d’Histoire des Juifs de Tunisie
a le regret de vous faire part du décès de son co-fondateur:
Jacques Taieb
Agrégé de Sciences Sociales
Ancien chargé de cours à Paris 1
Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des Juifs du Maghreb
Arrière petit-fils du Grand Rabbin de Tunisie Eliaou Borgel
survenu le 2 mai 2011 en début de matinée
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 5 mai 2011 à 11 heures au Cimetière du Montparnasse.
La Société d’Histoire des Juifs de Tunisie
a le regret de vous faire part du décès de son co-fondateur:
Jacques Taieb
Agrégé de Sciences Sociales
Ancien chargé de cours à Paris 1
Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des Juifs du Maghreb
Arrière petit-fils du Grand Rabbin de Tunisie Eliaou Borgel
survenu le 2 mai 2011 en début de matinée
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 5 mai 2011 à 11 heures au Cimetière du Montparnasse.
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 06 mai 2011, 02:14 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 3 376 |
Jacques Taïeb

Jacques Taïeb z'l, agrégé de sciences sociales, ancien professeur d’histoire et géographie, a enseigne les sciences économiques et sociales au lycée La Fontaine à Paris.
Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur les Juifs du Maghreb.
[www.akadem.org]
Emancipation et francophonie au Maghreb - L'école et les juifs en Afrique du Nord (1830-1950) (55 mn)
[www.akadem.org] Qui son les sepharades ?
Les principaux ouvrages de Jacques Taieb
Cent mots pour dire le judaïsme, (Maisonneuve & Larose, 2002)
Etre juif au Maghreb à la veille de la colonisation, (Albin Michel, 1994)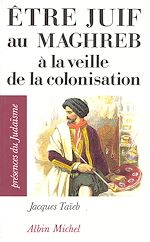
Les grandes crises : 1873, 1929, 1973, (Nathan, 2006)
Juifs du Maghreb: nom de famille et société, (Servedit, 2004)
Societes juives du maghreb moderne, (Maisonneuve & Larose, 2000)

Sélection d'articles, entretiens, réflexions de Jacques Taieb
"Expulsés de Provence au Maghreb". Extr. de , L'expulsion des juifs de Provence et de l'Europe méditerranéenne, XVe-XVIe siècles : exils et conversions, (Peeters, 2005)
Les Juifs d'Algérie (1830-1962) : Démographie et société., (Liana Levi, 1996)
Les Juifs du Maghreb au XIXe siècle à travers leurs patronymes : Actes du 5ème Congrès de Généalogie Juive 13-17 juillet 1997, (s.n., 1998)
Les Juifs du Maghreb au XIXe siècle : Aperçu de la démographie historique et répartition géographique. (Population, 1992)
Les Juifs de Tunisie : Sous le règne de l'Islam. de la conquête française à l'indépendance. (Fédération Sépharadie de France, 1976)
Juifs en Tunisie : le multiculturalisme. (Les Cahiers de l'Orient, 1996)
[www.numilog.com]

Jacques Taïeb z'l, agrégé de sciences sociales, ancien professeur d’histoire et géographie, a enseigne les sciences économiques et sociales au lycée La Fontaine à Paris.
Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur les Juifs du Maghreb.
[www.akadem.org]
Emancipation et francophonie au Maghreb - L'école et les juifs en Afrique du Nord (1830-1950) (55 mn)
[www.akadem.org] Qui son les sepharades ?
Les principaux ouvrages de Jacques Taieb
Cent mots pour dire le judaïsme, (Maisonneuve & Larose, 2002)
Etre juif au Maghreb à la veille de la colonisation, (Albin Michel, 1994)
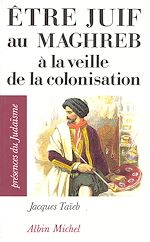
Les grandes crises : 1873, 1929, 1973, (Nathan, 2006)
Juifs du Maghreb: nom de famille et société, (Servedit, 2004)
Societes juives du maghreb moderne, (Maisonneuve & Larose, 2000)

Sélection d'articles, entretiens, réflexions de Jacques Taieb
"Expulsés de Provence au Maghreb". Extr. de , L'expulsion des juifs de Provence et de l'Europe méditerranéenne, XVe-XVIe siècles : exils et conversions, (Peeters, 2005)
Les Juifs d'Algérie (1830-1962) : Démographie et société., (Liana Levi, 1996)
Les Juifs du Maghreb au XIXe siècle à travers leurs patronymes : Actes du 5ème Congrès de Généalogie Juive 13-17 juillet 1997, (s.n., 1998)
Les Juifs du Maghreb au XIXe siècle : Aperçu de la démographie historique et répartition géographique. (Population, 1992)
Les Juifs de Tunisie : Sous le règne de l'Islam. de la conquête française à l'indépendance. (Fédération Sépharadie de France, 1976)
Juifs en Tunisie : le multiculturalisme. (Les Cahiers de l'Orient, 1996)
[www.numilog.com]
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 06 mai 2011, 07:59 |
Modérateur Membre depuis : 20 ans Messages: 3 103 |
Je rencontrais régulièrement Jacques Taïeb aux journées de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie.
Ses interventions étaient très vivantes et appréciées des participants.
C'est une perte pour le judaïsme tunisien.
La photo ci-dessus est extraite du Colloque International de la SHJT qui s'était tenu à La Sorbonne du 4 au 7 avril 2005 et dont j'avais rendu compte dans HARISSA : [www.harissa.com]
Voici une autre photo prise durant ce colloque.
Ses interventions étaient très vivantes et appréciées des participants.
C'est une perte pour le judaïsme tunisien.
La photo ci-dessus est extraite du Colloque International de la SHJT qui s'était tenu à La Sorbonne du 4 au 7 avril 2005 et dont j'avais rendu compte dans HARISSA : [www.harissa.com]
Voici une autre photo prise durant ce colloque.
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 08 mai 2011, 00:24 |
Membre depuis : 19 ans Messages: 3 376 |
Jacques Taieb - Historien
L’ANCIEN CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE TUNIS
Jacques Taïeb vous propose de mieux découvrir l’histoire de l’ancien cimetière Israélite de Tunis.
Située hors des murs de la médina et de ses faubourgs, elle s’étendait au nord de la cité. Elle paraît bien avoir été fonctionnelle quatre siècles durant avec, de siècle en siècle, l’abandon de certains espaces et l’occupation de terrains vierges.
Cette note vise à conter la longue histoire de ce cimetière, largement corrélée à l’histoire de la communauté juive de la ville. Il s’agira ensuite de cerner la physionomie et le caractère de ce champ du repos et de les recadrer dans la psychologie collective et les rites mortuaires des Juifs de la cité. En troisième lieu, enfin, elle tentera quelque échappée anthroponymique à partir des épitaphes des terres tombales ou en dehors d’elles.
Envie d’en savoir plus? Vous pouvez découvrir cette note sur l’ancien cimetière juif de Tunis.
=========================================================================
L’ANCIEN CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE TUNIS ET L’ANTHROPONYMIE DES JUIFS DE LA CITÉ
Telle était la dénomination courante de cette nécropole sous le Protectorat français (1881-1956). Située hors des murs de la médina et de ses faubourgs, elle s’étendait au nord de la cité. Elle paraît bien avoir été fonctionnelle quatre siècles durant avec, de siècle en siècle, l’abandon de certains espaces et l’occupation de terrains vierges.
Notre propos dans cette note est d’abord de conter la longue histoire de ce cimetière, largement corrélée à l’histoire de la communauté juive de la ville. Il s’agira ensuite de cerner la physionomie et le caractère de ce champ du repos et de les recadrer dans la psychologie collective et les rites mortuaires des Juifs de la cité. En troisième lieu, enfin, on tentera quelque échappée anthroponymique à partir des épitaphes des terres tombales ou en dehors d’elles.
* *
*
I - HISTORIQUE D’UNE NÉCROPOLE
Dans son ouvrage sur la ville de Tunis ( i ) , Paul Sebag présentait quatre plans de la cité et de ses abords aux XVIème, XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles avec, à quatre reprises, le cimetière israélite placé au même endroit ou, plus probablement, compte tenu de ce que nous écrivons dans l’introduction de ce texte, à des emplacements voisins. Cette ancienneté de la nécropole est attestée par d’autres sources. Dans son livre « Les Juifs à Bible vécue », Charles Haddad de Paz (ii), président du Conseil de la communauté israélite de Tunis de 1951 à 1958, signale que la communauté disposait d’un acte d’achat, en bonne et due forme, vieux de plusieurs siècles. Acte d’achat effectué par sept notables juifs, puisque la notion de personne morale n’existait pas alors. Ces sept notables agissaient, bien entendu, au nom de la communauté ; l’acte de propriété enroulé était placé dans un cylindre métallique. Il n’y a donc, en la matière, aucune hésitation ; cet ossuaire était bien pluriséculaire et il était la propriété de la communauté.
Mais au cours des siècles les parties fonctionnelles du cimetière avaient migré au fur et à mesure que se remplissaient certains espaces. À la fin du XIXème siècle le cimetière israélite, limité par l’avenue de Londres au nord, la rue des Salines à l’ouest, la rue Navarin et d’autres petites artères au sud, l’avenue Roustan à l’Est – devenue l’avenue Habib Thameur après l’indépendance de la Tunisie – formait un grossier quadrilatère.
Cet espace n’abritait que les tombes allant grossièrement de 1800-1805 à 1890-1891, date à laquelle, faute de place, on créa, hors la ville, un nouveau cimetière dit de Borgel ou, de manière incorrecte, du Borgel.
La carte annotée par Paul Sebag ( iii ) dans son livre sur la Ḥâra de Tunis, montre bien que des tombes (essentiellement celles de docteurs de la loi) se trouvaient en dehors de la nécropole du XIXème siècle. On y trouvait les pierres tombales datant du XVIIIème siècle comme celles d’Abraham Cohen, mort en 1715, d’Abraham Benmoussa, Moïse Darmon et Abraham Taïeb, tous décédés en 1741, de Joseph Bismuth mort en 1775, comme Messaoud Raphaël El Fassi, d’Isaac Lumbroso morts en 1752, et enfin d’Elie Gabison mort en 1795.
Pierres tombales enchâssées dans les nouveaux immeubles construits, autour de ou après 1900, abritées par des chambrettes, après accord avec les propriétaires et la municipalité de Tunis. Accord peut-être facilité par le fait que la grande majorité des habitants de ces immeubles étaient juifs. Une seule tombe bénéficiait d’un modeste mausolée, celle d’Abraham Cohen dit Bâbâ er-rebbi ou Bâbâ Rebbi (« notre père le rabbin », en arabe vernaculaire). Pas de doute, là aussi, l’espace comprenant les avenues de Londres, de Madrid, de Lyon et des rues transversales correspondait à l’évidence à la nécropole du XVIIIème siècle, voire à celle du second XVIIème siècle. Nous garderons, d’ailleurs, sur ce thème l’ancienne terminologie coloniale pour éviter tout anachronisme, beaucoup de rues et d’avenues ayant changé de noms depuis l’indépendance de la Tunisie.
Mais où étaient donc les sépultures des premières décennies du XVIIème et celles du XVIème siècles ? Peut-être, au-delà de l’avenue de Lyon, plus au nord donc et pas trop loin de la porte du faubourg Bâb El khaḍra (« la porte de la verdure » en arabe). Une information communiquée par notre ami Itshaq Avrahami paraît aller dans ce sens. Il nous signalait chez de veilles personnes, autour de 1900, le souvenir d’un cimetière dit de Bâb El khaḍra. Il ne s’agissait sans doute pas d’un autre cimetière, mais de la partie la plus ancienne et la plus septentrionale de la grande nécropole. Grande nécropole dont la partie réservée aux sépultures du XIXème siècle faisait 6,5 hectares, et celles abritant les tombes des siècles antérieurs bien davantage, 15 hectares, voire plus ? Remonter aux époques antérieures au XVIème siècle pour déterminer l’emplacement du ou des cimetières juifs s’avère délicat faute de documents.
Il y a toutefois une certitude, la présence des Juifs dans la cité est antérieure, très antérieure au XVIème siècle. Une consultation rabbinique autour de 1465 ( iv ) , adressée par les rabbins de Tunis à ceux d’Alger, montre bien l’existence d’une communauté. D’autre part, la grande synagogue de la Ḥâra de Tunis, le vieux quartier juif de la médina, aurait été fonctionnelle dès 1365, selon des sources autorisées ( v ) .
Ce cimetière multiséculaire fut aussi par bien d’autres aspects lié à la vie de la collectivité. Retenons l’un d’entre eux, celui du schisme des Livournais. Ces derniers, d’anciens marranes portugais établis à Livourne à la fin du XVIème siècle, commencèrent à affluer à Tunis au début du siècle suivant. En 1710, ils se séparèrent des indigènes, lesquels finirent par reconnaître, en 1741, la séparation. Il y eut désormais dans la capitale deux communautés, celle des Twânsa (Tunisiens), et celle des Grâna (Livournais). Encore que ces derniers utilisassent dans leurs actes officiels le terme de communauté portugaise, ce qui n’était rien qu’une erreur.
Cette séparation, selon certains, aurait entraîné l’existence de deux cimetières. Affirmation erronée. Dans la carte présentée par Paul Sebag dans son étude sur la Ḥâra de Tunis, Abraham Benmoussa (Tunisien) et Moïse Darmon (Livournais) sont enterrés côte à côte. On retrouve aussi, au milieu des sépultures, des lettrés indigènes, comme celle d’Isaac Lumbroso, également Livournais. Il n’y avait donc, au XVIIIème siècle, qu’un seul cimetière.
Il faudra attendre 1851 pour voir se créer un second cimetière. Débordés par le nombre de décès, lors de l’épidémie de choléra de 1850-1851, les Livournais demandent au caïd des Juifs, Joseph Bellaïche, l’autorisation d’acheter un terrain pour y ensevelir leurs morts. Ils se heurtèrent à un refus. Le caïd, toujours choisi chez les Twânsa, craignant peut-être la mise en place d’un cimetière séparé. C’est ce qui se produisit. Les Livournais, disposant sans doute d’appuis à la cour, passèrent outre et firent l’acquisition d’une pièce de terre située au sud-est de la nécropole, adjacente à ce qui deviendra sous le Protectorat la rue Navarin (voir carte de P. Sebag, p. 79). Cet épisode aggravait donc la séparation des deux communautés ( vi ) , bien qu’il n’y eût aucune clôture entre les deux espaces.
L’instauration du Protectorat français, le 12 mai 1881, allait ouvrir un nouvel et long épisode de nature différente de tout ce qui précède. La municipalité de Tunis, probablement après 1884, clôtura la nécropole du XIXème siècle encore fonctionnelle, expropriant, de facto, la communauté de tout le reste, pour cause d’utilité publique. Là s’élevèrent, par la suite, les immeubles dont nous avons parlé (Avenue de Londres, de Madrid, etc).
Pendant toute la durée du Protectorat (1881-1956), la municipalité tenta, sans succès, d’acheter le cimetière du XIXème siècle à la communauté qui s’y refusa, ne voulant aliéner le lieu de crainte (crainte fondée) que les cadavres ne fussent exhumés, acte interdit par la loi juive. En fait, la nécropole ne pouvait qu’attirer les convoitises, car située entre la médina et le lac de Tunis dans l’espace qui, dès 1884-1885, deviendra la ville européenne, de part et d’autre des avenues de France et Jules Ferry, la partie sud étant le domaine des Européens, la partie nord celui des Juifs évadés de la Ḥâra et de ses dépendances.
L’article de Rodolphe Arditti sur les épitaphes rabbiniques ( vii ) apporte encore quelques lumières. Rodolphe Arditti ou Raphaël de son nom hébraïque, d’origine bulgare, était un rabbin issu du Séminaire israélite de Paris. Il s’installa en Tunisie fin 1898 et sans doute commença-t-il ses recherches autour de 1900-1910, ne retenant, bien sûr, que les tombes des docteurs de la loi. Toutes ces tombes visitées dataient des XVIIIème et XIXème siècles. Il y avait donc un énorme trou pour les périodes antérieures. À cela plusieurs raisons, pas nécessairement opposées ; les lettrés étaient rares à Tunis avant la renaissance des études hébraïques au XVIIIème siècle. Dans ces espaces mal clôturés où plus personne ne venait visiter les tombes depuis des générations, des vandales ou des voyous s’étaient sans doute approprié les pierres tombales comme matériaux de construction. On dit enfin que le Bey Hamouda Pacha, qui régna de 1782 à 1814, aurait confisqué des pierres tombales. Peut-être eut-il l’élégance de ne pas toucher à celles du XVIIIème siècle, encore visitées, et se contenta-t-il des sépultures du XVIIème siècle, voire du XVIème siècle, depuis longtemps à l’abandon. Episode qui, a priori, ne paraît pas irrecevable dans l’exacte mesure où, au delà des pillages privés, des confiscations publiques eurent probablement lieu.
Ce cimetière eut une fin assez triste. Deux ans après l’indépendance, le 26 février 1958, la municipalité de Tunis expropria la communauté sans indemnité aucune, et dans les mois qui suivirent le cimetière devint un jardin public. De toute manière, pour les raisons signalées plus haut, la communauté ne pouvait accepter aucune indemnité. On parvint, après de longues négociations, à inhumer, dans le nouveau cimetière, les dépouilles de plusieurs lettrés, exhumés de cet espace. Autoritaire, ô combien, cet épisode laissa chez les Juifs de la ville des traces évidentes.
II – LE SITE MORTUAIRE. DÉPOUILLEMENT ET EXTRAVAGANCES
Comment se présentait la nécropole, forte de près de 22 hectares, située extramuros et inaugurée de longs siècles plus tôt, vers 1881-1890, au début du Protectorat français ? Il s’agissait de terrains humides et salés à cause de la proximité du lac de Tunis. Terrains médiocres et gorgés d’eau en hiver, à l’herbe desséchée et squelettique en saison chaude. Cet espace, d’une grande platitude, n’était égayé par aucun arbre, aucune fleur. Seuls couraient les rongeurs dont de nombreux lièvres. Il en restait quelques-uns encore, en 1945, dans le cimetière-croupion du XIXème siècle. Désaffecté vers 1890-1891, ce cimetière du XIXème siècle n’en devint pas pour autant un lieu désert, contrairement à ce qui s’était passé aux siècles précédents. Clôturé, encore que de manière rudimentaire, le cimetière fut bien moins qu’auparavant la proie des pillards. Surtout, il conserva quelques activités bien précises. Il connut quelques épisodes folkloriques ou tristes, resta fréquenté par les visites aux tombes antérieures à 1890-1891, et ce jusqu’aux années 1920, et plus encore par les pèlerinages sur les sépultures de deux rabbins fameux.
À partir de 1887, la communauté érigea avenue de Londres le dépositoire des Twânsa où les corps des défunts étaient déposés au moment des prières d’usage, avant d’être transportés par voiture hippomobile au nouveau cimetière. Rue Navarin on construisit celui des Livournais. Innovation que ces voitures tirées par des chevaux robustes à la belle prestance, esthétiquement harnachés, tranchant sur les humbles cortèges du temps jadis où les cercueils étaient portés par des hommes. Se répandit aussi à cette époque, ou un peu plus tôt, l’usage, très italien, des avis mortuaires placardés sur les murs de la ville, et surtout sur ceux du cimetière.
Les pèlerinages animèrent surtout la nécropole jusque vers 1958, pèlerinages presque strictement locaux, quasiment limités aux habitants de Tunis et un peu plus tard de ses banlieues, lorsque, après 1914-1918, des Juifs commencèrent à y habiter. Pèlerinages sur les tombes de deux rabbins : Josué Bessis, lettré connu et cabaliste, perçu par le petit peuple comme intercesseur auprès de Dieu et occultiste, voire thaumaturge ; et surtout Ḥay Taïeb, personnage étrange, très porté sur l’eau de vie de figue (la bûkha en arabe), tenu en piètre estime par les clercs de son temps dont la production littéraire nous est globalement inconnue. Il paraît avoir écrit un traité dit Ḥelev ḥi Ḥiṭṭâm (« suc de froment » en hébreu) mais la sottise d’une servante en fit disparaître la plus grande partie.
Sa tombe, surélevée de 15 ou 20 cm au-dessus du sol, surélévation pompeusement appelée, en arabe, El jbel, la montagne, était entourée d’une petite foule, canalisée par le dénommé ‘Anîba (« petit raisin » en arabe), personnage atypique, sombre comme Othello, sec et noueux comme un sarment de vigne, descendant d’un collatéral du rabbin et qui réclamait quelque argent à l’issue de la cérémonie. Il est à noter que le cimetière du XIXème siècle abritait les sépultures, jamais visitées, de bien d’autres savants, car trop intellectualisés, trop distants, incapables de faire des miracles ou de jouer le rôle d’intercesseur, ils étaient boudés, donc, par le petit peuple. Notons enfin que les tombes des rabbins du XVIIIème siècle, hors cimetière, étaient aussi visitées mais de manière moins fournie et plus discrète.
Deux épisodes très dissemblables émaillèrent la vie du cimetière après sa désaffection. Celui courant de novembre 1942 à mai 1943, lors de l’occupation allemande, où l’on creusa des tranchées pour permettre à la population des immeubles voisins de se mettre à l’abri lors des bombardements alliés. Celui, plus haut en couleurs, dit de la « guerre du cimetière », opposant, au cours de l’année scolaire 1943-1944, des enfants juifs à des enfants musulmans, à coups de pierres, qui dura de longs mois, jusqu’à ce que le Conseil de la communauté israélite de Tunis qui n’avait aucun goût pour le folklore, ne mette fin à cette guerre « picrocholine », selon l’expression de François Rabelais, en colmatant les brèches des murs. Le combat cessa alors, faute de combattants.
L’aspect de la grande nécropole (le cimetière du XIXème siècle mais aussi ceux des siècles passés) au niveau des pierres tombales était, encore que de manière complexe et contradictoire, intriqué avec les rites mortuaires de la population juive de la cité. Ces pierres tombales du XVIème au XIXème siècles étaient de simples dalles, posées à même le sol, sans aucune ostentation et dépourvues de surcharges ornementales. Or ce dépouillement, cette simplicité, contrastait violemment avec l’exubérance des cérémonies mortuaires dont il faudrait maintenant parler.
Avant les funérailles, les cris et les pleurs des femmes, accompagnés des hurlements des pleureuses qui souvent se laceraient les joues, composaient un étrange tableau contrastant avec les visages fermés des hommes et leur pesant silence ( viii ). Les cortèges funèbres se composaient la plupart du temps d’hommes. Les femmes apparaissaient, en force, lors des visites au cimetière, en règle générale, les vendredis matins. Là, assises près des sépulcres ou couchées sur eux, elles reprochaient amèrement au défunt, ou à la défunte, leur absence, les tenaient au courant des menus événements de la chronique, réclamaient leur retour. Ces manifestations, le plus souvent, duraient quelques mois ou un peu plus. Puis s’installait le silence et l’opacité. Ainsi au dépouillement, à l’humilité des lieux, à la modestie des pierres tombales, s’opposaient la violence de la gestuelle, l’extravagance, et l’excentricité du discours. Mort baroque, dirions-nous, selon l’expression de l’historien français Michel Vovelle, mais à la différence que le baroque d’Occident comportait une surcharge ornementale des monuments funéraires, ici absente.
III – EPITAPHES, ANTHROPONYMIE
Les sources concernant les épitaphes et leurs retombées anthroponymiques se trouvent, bien sûr, dans l’article de Rodolphe Arditti déjà cité. Cependant, la liste des patronymes que nous pourrions y découvrir est loin d’être exhaustive. Il faut donc recourir à deux ouvrages récents. Celui de Paul Sebag sur les noms des Juifs de Tunisie, paru en 2002, et celui que nous avons nous-mêmes commis en 2004 sous l’égide du Cercle de généalogie juive concernant tout le Maghreb .( ix )
Nous nous bornerons dans cette étude anthroponymique à la communauté des Twânsa, celle des Grâna ayant déjà été traitée dans les pages de la Revue du Cercle de généalogie juive ( x ). Le livre de Paul Sebag et le nôtre ayant déjà, dans une large mesure, élucidé le sens des patronymes et leur date d’apparition, il ne sera pas question d’y revenir. On recensera donc simplement les noms de famille, on cherchera à déterminer leur fréquence ( xi ) ou leur rareté. On se livrera, enfin, à quelques considérations sur les caractéristiques anthroponymiques de la population juive de la cité.
L’article de Rodolphe Arditti recense, pour les XVIIIème et XIXème siècles, plusieurs dizaines de patronymes appartenant surtout à la communauté des Twânsa. Il s’agit le plus souvent de familles patriciennes, de lignées rabbiniques. Nous en citons ici simplement quelques-uns comme les Borgel, les Cohen-Tanugi, les Cohen-Solal, mais également les Scemama, les Nataf, les Bessis qui, elles, avaient des homonymes, en revanche, dont il fallait se distinguer.
Au-delà, vient la masse des noms de famille. Mais là encore il ne saurait être question de recenser tous les noms de famille de la capitale tunisienne au temps du Protectorat. On se contentera des Tunisois de souche, c’est-à-dire de ceux qui y vivaient avant le Protectorat. Car eux, et eux seuls, s’inscrivaient dans la longue durée. Quant un nom, selon la mémoire collective, provenait d’une autre ville ou d’une autre région, nous en avons mentionné l’origine entre parenthèse et parfois, approximativement, la date d’installation à Tunis.
Nous commencerons, dans le tableau ci-après, par présenter les noms de famille les plus courants. Comme pour le second tableau qui suivra, nous retiendrons les orthographes les plus fréquentes.
NOMS DE FAMILLE FRÉQUENTS
Abitbol ou Boutboul Gozlan Nadjar ou Nizard
Ankri Guetta (Libye ?) Nahum ou Nahoum
Assous Guez ou Ghez Nataf
Attal Haddad (Djerba) Pariente
Azoulay Haouzi Perez
Barouch Hayoun Saada
Bellaïche Jami Samama ou Scemama
Berrebi Jaoui Sarfati
Bessis Journo (Sicile ou Italie du Sud ?) Sebag
Bijaoui ou Bigiaoui Junès ou Younès Sfez
Bocobza ou Bokobza Kalfon ou Halfon Sitbon ou Setbon
Boubli ou Boublil Kayat ou Hayat Sitruk
Bramli ou Brami* Koskas ou Coscas Slama
Chikly ou Chikli Krief Smadja ou Smaja
Chemla ou Chmila Ktorza ou Ctorza Taïeb
Cohen (Djerba pour partie) Lellouche
(Testour S.O de Tunis pour partie)
Uzan
Cohen-Tanugi (Sicile, 1493 ?) Lévi ou Lévy Zarka
Dana Maarek Zerah
Fellous Madar (Djerba) Zeitoun ou Zitoun
Fitoussi Marouani Zuili (Mahdia, centre est
de la Tunisie ?)
Gabison Meimoun et Meïmouni**
Gablula (Libye ?) Moati
Ganem ou Ghanem Naccache
*Les deux patronymes Brami et Bramli n’appartiennent pas à la même souche. Le premier signifie en hébreu « appartenant à la famille » d’un certain Abrahami ou Brahami. Le second signifie en arabe « tonnelier ». Il était plus fréquent que l’autre vers 1880. Pour des raisons qui nous échappent, la municipalité de Tunis transforma, pour l’état-civil, beaucoup de Bramli en Brami, créant une certaine confusion.
**Le second patronyme, assez rare, appartient à la même souche que le premier et serait originaire de Testour, S.O. de Tunis.
Nous chercherons donc d’abord à déterminer la fréquence de ces patronymes et à nous livrer à quelques exercices statistiques. La mémoire collective, souvent fidèle dans ces sociétés traditionnelles, retient aisément l’origine géographique des porteurs de patronymes, connaît les noms les plus fréquents mais sans fournir, bien entendu, la moindre donnée statistique. Essayer de démêler quelque chose dans le précédent tableau commanderait de connaître, même approximativement, le nombre des Juifs de la capitale à différentes époques. En nous basant sur les premiers recensements effectués la Tunisie, après la Grande Guerre et plus encore sur des estimations communautaires sérieuses datant de 1895, on peut raisonnablement penser que vers 1880 il y avait à Tunis 14 000 Juifs dont quelque 2 000 Livournais. La population à cerner s’élèverait donc à quelque 12 000. Pour la plupart des patronymes du tableau il y avait une grosse centaine de porteurs, mais certains en comptaient davantage.
Ces patronymes plus fréquents étaient les suivants : Assous, Attal, Bellaïche, Bismuth, Brami et Bramli, Chemla et son diminutif Chmila, Cohen, Fellous, Guez, Haddad, Maarek, Najjar ou Nizard, Saada, Samama ou Scemama, Serfati, Sitbon, Sitruk, Slama, Smadja, Taïeb, Uzan, Zeïtoun.
Le tableau ci-après comptait donc probablement plus de 10 000 porteurs, c’est-à-dire près de 85 % de la population. L’anthroponymie était donc relativement resserrée et également probablement ancienne. Une partie de la population descendait de gens vivant dans la ville avant la présence ottomane (fin du XVIème siècle). Une partie s’y était installée après cette date, tout au long des XVIIème et XVIIIème siècles, avec le développement économique dont bénéficiaient la cité et son avant-port de la Goulette.
Tous ces noms, sauf Cohen-Tanugi, correspondaient à plusieurs familles homonymes. Ces familles appartenaient à des strates sociales différentes, séparées qu’elles étaient par le revenu et le niveau de dignité urbaine. Quelques-uns étaient, en ce temps, considérés comme plébéiens : Haouzi, Journo, Krief.
NOMS DE FAMILLES RARES*
Adda Cohen-Boulakia
(Levant ottoman) Raccah (Libye)
Addaoui
Cohen-Hadria** Riahi ou Yarhi*** (Languedoc,
Provence ?)
Allal
Cohen-Jonathan
(Alger ?) Ruben, Rubens
Allouche (Sud tunisien)
Cohen-Solal
(Baléares, Alger ?) Saadoun (Sud tunisien)
Assal Cohen-Zardi Saal
Baranès Constantini
Sabban (Djerba ?)
Belhassen (Maroc) Diens ou Dian
Sberro ou Zbirou
(Libye ?)
Benaïnous (Alger 1800 ?) Douieb (Djerba) Secnazi
Benmoussa
El Malih (Maroc) Senouf
Benattar
(Gibraltar fin XVIIIème) Fargeon (Djerba) Slakmon (Djerba)
Benisti Farhi (Levant ottoman)
Stioui (Libye ?)
Bennéro Fassi, Elfassi (Maroc)
Taji et Bismuth-Taji
Berda (Lybie)
Hababou (Sousse, Tunisie ?)
Tartour
Besnaïnou Haccoun (Alger) Temam
Bijaoui-Bellham Hassan Temim
Bissor Hassid
Tibi
Bittan Houbani Touitou (Tozeur S.O Tunisie)
Borgel
Jarmon (Tripoli de
Barbarie, Libye) Tubiana (Alger ?)
Cacoub
Jerusalmi (Levant ottoman) Tuil
Caroubi
Krissi
Tuil-Tartour
Castro (Espagne)
Nataf-Tartour
Wakil ou Ouakil ou Ouaki
Cattan (Levant ottoman)
Lahmi
Zakine
Chaltiel
(Testour S.O de Tunis)
Marzouk
Zarhi
Chaouat
Melloul Zouari
Chiche (Alger 1800 ?)
Messas ou Mechach
Messica (nord de la
Tunisie)
*On pourrait y rajouter le patronyme de Freva. Mais sa naissance serait récente (à quelle date ?). Il semble en tout cas extérieur à notre horizon temporel à long terme.
**Les Cohen-Hadria ne seraient qu’une branche des Cohen-Tanugi.
***Riahi peut bien être la metathèse (inversion de lettres) de Yarhi. Ou encore il pourrait s’agir de deux noms différents :
Riahi, en arabe, désigne un membre d’une tribu bédouine, celle des Riyâh, du nord de la Tunisie. Yarèaḥ, qui signifie “lune” en araméen. Les Riahi ou Yarhi se disent originaires de la cité de Lunel en Languedoc qui, avant l’expulsion des Juifs de France au XIVème siècle, abritait une importante communauté
Le nombre de porteurs par patronymes (un peu plus de vingt ?) est ici sensiblement plus bas que précédemment, mais certains noms comme Assal, Baranès, Chaouat, Hababou, Raccah, Temam, Tuil, Zakine, Zouari étaient sans doute un peu moins rares. Peut-être avons-nous affaire à l’existence de deux familles homonymes dans ces cas précis ?
La faible fréquence correspondait à l’existence de surnoms, par essence, typiques et limités. Un cas paradigmatique nous est donné par l’existence du patronyme Tartour (un couvre-chef turc) donné (vers 1800 ?) à une famille Nataf et à une famille Tuil avec création de deux noms composés ou à une véritable substitution, Tartour tout court.
Une autre cause de ces faibles moyennes de fréquence est, peut-être, à chercher dans l’arrivée au cours des siècles de familles nucléaires, par essence, peu nombreuses, surtout avec les ravages de la mortalité d’alors. Le phénomène paraît moins se retrouver dans le précédent tableau. En particulier, les immigrés venus nombreux de Djerba, surpeuplée et pauvre, appartenaient souvent à des familles homonymes installées dans la capitale à différentes époques (Cohen, Haddad, Madar). Conséquence de cette faiblesse statistique, le fait probable que les patronymes du second tableau, globalement, étaient des familles uniques sans homonymes.
Mentionnons, comme pour le premier tableau, que certains noms, à l’époque, étaient perçus comme plébéiens, tels Assal, Benisti, Bissor, El Malih, Haccoun, Hasson, Melloul, Tuil, Wakil, Zarhi, Zouari. Les Krissi, enfin, « petite chaise » en arabe, se seraient jadis appelés Bonan (une vieille famille de Tunis considérée comme livournaise), tout au moins à l’origine.
* *
*
Situé en plein cœur de la ville coloniale, de 1900 à 1958, le vieux cimetière fut jadis en position périphérique, extramuros. En fait, au fil des siècles, il ne cessa de glisser du Septentrion vers le Midi au fur et à mesure des mises à sac ou des abandons des vieilles nécropoles, surtout celles du XVIème et du XVIIème siècles, plus jamais visitées, l’oubli des décès les plus anciens ayant fait son œuvre.
Au début du Protectorat, les autorités communautaires n’oseront s’opposer à ce qui ressemblait à une expropriation pour les parties les plus anciennes du cimetière (XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles). Par la suite, la découverte de l’état de droit permit de sauvegarder l’espace du XIXème siècle avant l’éviction rapide de 1958. Demeuré plus ou moins un musée, cet espace frappait par sa pauvreté et son austérité, à l’image des usages du pays où les nécropoles musulmanes présentaient le même aspect. Le cimetière résiduel fut aussi un livre d’histoire. L’anthroponymie qu’il livra fut, durant quatre siècles, celle de la communauté des vivants, de leur foi et de leurs peines ; mais elle peupla massivement, aux mêmes époques, les stèles funéraires d’une cité qui, du début du XVIIIème siècle à la Grande Guerre, voire au-delà, abrita la plus grande collectivité juive du Maghreb, avant d’être devancée par l’agglomération de Casablanca, probablement dès avant 1940, puisque, en 1947, la cité marocaine et ses banlieues dépassaient vraisemblablement 86 000 Juifs au-delà de ce que disaient les annuaires statistiques.
La fin du cimetière inaugura la fin des lieux de mémoire. En 1958 on expropria les morts. En 1960-1961 fut détruit le vieux cimetière historique de la Ḥâra et de sa vénérable grande synagogue, le tout, quelques années avant que les vivants ne quittent à jamais les rives de Carthage. Demeuré en l’état, le nouveau cimetière de Borgel, inscrit dans la modernité, mais dépourvu de légitimité faute d’enracinement dans le temps long. Survivra-t-il d’ailleurs devant l’extension urbaine de la ville de Tunis ? Rien n’est moins sûr.
i Cf. Paul Sebag, Tunis, Histoire d’une ville, Paris, L’Harmattan, Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1998, pp. 131, 175, 235, 277.
ii Charles Haddad de Paz, Les Juifs de Tunisie, à bible vécue, Paris, sans mention d’éditeur ?, 1988, pp. 312-313.
iii Cf. Paul Sebag avec la collaboration de Robert Attal, La Ḥara de Tunis, Evolution d’un ghetto nord-africain, Paris, PUF, 1959, p. 79.
iv H.Z. Hirschberg, A History of the Jews in north Africa, Leiden, E.J. Brill, 1974, From Antiquity to the sixteenth century, tome I, pp. 458-480.
Encore que la présence juive dans la capitale soit sans doute très antérieure à cette date, puisqu’il y est dit que jadis les Juifs habitaient un fondouk, type d’habitat précaire, près de Bâb el kḥar, « la porte de la mer » en arabe. Ce n’est que bien plus tard qu’ils s’installèrent dans un autre quartier, car sans doute devenus plus nombreux. Ce nouveau quartier était vraisemblablement la Ḥara de Tunis.
v Cf. Avraham Attal, Bate kenesiyot betunis bechana 1956 (en hébreu), Les synagogues de Tunis dans l’année 1956, in Tarchich (Carthage en Hébreu), direction Ephraïm Hazan, Haïm Saadoun, Ramat Gan (Israël), Université Bar Ilan, 1987 ?
Voir aussi Benjamin Raphaël Cohen, Malké Tarchich (en hébreu), Les rois de Carthage, Israël, pas de mention d’éditeur, 1984 ou 1985. Ce temple que nous avons connu dans notre jeunesse, semblait, à première vue, bien moins ancien, mais au fil des siècles des restaurations eurent lieu, la dernière en date se situant autour de 1910. Sur ce dernier point voir Jacques Revault, La grande synagogue de la Ḥara de Tunis, Cahiers de Tunisie, n° 41-42, 1968.
vi Cf. Itshaq Avrahami, Qehilat Portuguesim betûnîs upinquasah (en hébreu), La communauté portuguaise de Tunis et son mémorial, Ramat Gan (Israël), Université Bar Ilan, 1982, tome 1, p. 149 et sq.
vii Cf. Rodolphe Arditti, Epitaphes rabbiniques de l’ancien cimetière israélite de Tunis, Revue tunisienne, 1931, pp. 105-119 et 405-411 et 1932 pp. 99-111.
viii Le souci de l’exactitude amène à légèrement nuancer ce tableau car les familles patriciennes, les lignées rabbiniques, les lettrés avaient en règle générale une attitude plus discrète. Les Livournais de leur côté étaient extérieurs à ces « extravagances ». Plus précisément, les Livournais, venus au XIXème siècle, de langue et de culture italiennes, Garibaldiens, bourgeois libéraux adeptes des lumières et très loin de l’orthopraxie en matière religieuse, alors que ceux, plus anciennement installés, surtout chez les pauvres, devenus de langue et de culture arabes, avaient adopté les us et coutumes des indigènes en la matière. Un amusant dicton chez les Twânsa qualifie de meṭṭa met’a Gwâna (un enterrement livournais), une assemblée discrète et silencieuse. Le mot meṭṭa de l’hébreu miṭṭa (lit.) désigne un enterrement comme son équivalent arabe, dafîna.
ix Cf. Paul Sebag, Les noms des Juifs de Tunisie, origines et significations, Paris, L’Harmattan, 2002, passim. Jacques Taïeb, Juifs du Maghreb, noms de familles et société, Paris, Cercle de généalogie juive, 2004, passim.
x Cf. Jacques Taïeb, Les Juifs livournais de Tunis : démographie et anthroponymie historiques, Revue du Cercle de Généalogie juive, n° 95, tome 24, juillet-septembre 2008,
pp. 14-19.
Sur ces questions de fréquence des patronymes voir Jacques Taïeb, Juifs du Maghreb… op. cit., pp. 184-189. Voir aussi Joseph Tolédano, Une histoire de familles. Les noms de famille des Juifs d’Afrique du Nord des origines à nos jours, Jérusalem, Editions Rambol), 1998, p. 862.
xi Cf. André Chouraqui, La condition juridique de l’Israélite marocain, Paris, AIU, Presse du Livre français, p. 211. Tunis et ses banlieues, en 1947-1948, comptaient sans doute 63 000 Juifs.
L’ANCIEN CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE TUNIS
Jacques Taïeb vous propose de mieux découvrir l’histoire de l’ancien cimetière Israélite de Tunis.
Située hors des murs de la médina et de ses faubourgs, elle s’étendait au nord de la cité. Elle paraît bien avoir été fonctionnelle quatre siècles durant avec, de siècle en siècle, l’abandon de certains espaces et l’occupation de terrains vierges.
Cette note vise à conter la longue histoire de ce cimetière, largement corrélée à l’histoire de la communauté juive de la ville. Il s’agira ensuite de cerner la physionomie et le caractère de ce champ du repos et de les recadrer dans la psychologie collective et les rites mortuaires des Juifs de la cité. En troisième lieu, enfin, elle tentera quelque échappée anthroponymique à partir des épitaphes des terres tombales ou en dehors d’elles.
Envie d’en savoir plus? Vous pouvez découvrir cette note sur l’ancien cimetière juif de Tunis.
=========================================================================
L’ANCIEN CIMETIÈRE ISRAÉLITE DE TUNIS ET L’ANTHROPONYMIE DES JUIFS DE LA CITÉ
Telle était la dénomination courante de cette nécropole sous le Protectorat français (1881-1956). Située hors des murs de la médina et de ses faubourgs, elle s’étendait au nord de la cité. Elle paraît bien avoir été fonctionnelle quatre siècles durant avec, de siècle en siècle, l’abandon de certains espaces et l’occupation de terrains vierges.
Notre propos dans cette note est d’abord de conter la longue histoire de ce cimetière, largement corrélée à l’histoire de la communauté juive de la ville. Il s’agira ensuite de cerner la physionomie et le caractère de ce champ du repos et de les recadrer dans la psychologie collective et les rites mortuaires des Juifs de la cité. En troisième lieu, enfin, on tentera quelque échappée anthroponymique à partir des épitaphes des terres tombales ou en dehors d’elles.
* *
*
I - HISTORIQUE D’UNE NÉCROPOLE
Dans son ouvrage sur la ville de Tunis ( i ) , Paul Sebag présentait quatre plans de la cité et de ses abords aux XVIème, XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles avec, à quatre reprises, le cimetière israélite placé au même endroit ou, plus probablement, compte tenu de ce que nous écrivons dans l’introduction de ce texte, à des emplacements voisins. Cette ancienneté de la nécropole est attestée par d’autres sources. Dans son livre « Les Juifs à Bible vécue », Charles Haddad de Paz (ii), président du Conseil de la communauté israélite de Tunis de 1951 à 1958, signale que la communauté disposait d’un acte d’achat, en bonne et due forme, vieux de plusieurs siècles. Acte d’achat effectué par sept notables juifs, puisque la notion de personne morale n’existait pas alors. Ces sept notables agissaient, bien entendu, au nom de la communauté ; l’acte de propriété enroulé était placé dans un cylindre métallique. Il n’y a donc, en la matière, aucune hésitation ; cet ossuaire était bien pluriséculaire et il était la propriété de la communauté.
Mais au cours des siècles les parties fonctionnelles du cimetière avaient migré au fur et à mesure que se remplissaient certains espaces. À la fin du XIXème siècle le cimetière israélite, limité par l’avenue de Londres au nord, la rue des Salines à l’ouest, la rue Navarin et d’autres petites artères au sud, l’avenue Roustan à l’Est – devenue l’avenue Habib Thameur après l’indépendance de la Tunisie – formait un grossier quadrilatère.
Cet espace n’abritait que les tombes allant grossièrement de 1800-1805 à 1890-1891, date à laquelle, faute de place, on créa, hors la ville, un nouveau cimetière dit de Borgel ou, de manière incorrecte, du Borgel.
La carte annotée par Paul Sebag ( iii ) dans son livre sur la Ḥâra de Tunis, montre bien que des tombes (essentiellement celles de docteurs de la loi) se trouvaient en dehors de la nécropole du XIXème siècle. On y trouvait les pierres tombales datant du XVIIIème siècle comme celles d’Abraham Cohen, mort en 1715, d’Abraham Benmoussa, Moïse Darmon et Abraham Taïeb, tous décédés en 1741, de Joseph Bismuth mort en 1775, comme Messaoud Raphaël El Fassi, d’Isaac Lumbroso morts en 1752, et enfin d’Elie Gabison mort en 1795.
Pierres tombales enchâssées dans les nouveaux immeubles construits, autour de ou après 1900, abritées par des chambrettes, après accord avec les propriétaires et la municipalité de Tunis. Accord peut-être facilité par le fait que la grande majorité des habitants de ces immeubles étaient juifs. Une seule tombe bénéficiait d’un modeste mausolée, celle d’Abraham Cohen dit Bâbâ er-rebbi ou Bâbâ Rebbi (« notre père le rabbin », en arabe vernaculaire). Pas de doute, là aussi, l’espace comprenant les avenues de Londres, de Madrid, de Lyon et des rues transversales correspondait à l’évidence à la nécropole du XVIIIème siècle, voire à celle du second XVIIème siècle. Nous garderons, d’ailleurs, sur ce thème l’ancienne terminologie coloniale pour éviter tout anachronisme, beaucoup de rues et d’avenues ayant changé de noms depuis l’indépendance de la Tunisie.
Mais où étaient donc les sépultures des premières décennies du XVIIème et celles du XVIème siècles ? Peut-être, au-delà de l’avenue de Lyon, plus au nord donc et pas trop loin de la porte du faubourg Bâb El khaḍra (« la porte de la verdure » en arabe). Une information communiquée par notre ami Itshaq Avrahami paraît aller dans ce sens. Il nous signalait chez de veilles personnes, autour de 1900, le souvenir d’un cimetière dit de Bâb El khaḍra. Il ne s’agissait sans doute pas d’un autre cimetière, mais de la partie la plus ancienne et la plus septentrionale de la grande nécropole. Grande nécropole dont la partie réservée aux sépultures du XIXème siècle faisait 6,5 hectares, et celles abritant les tombes des siècles antérieurs bien davantage, 15 hectares, voire plus ? Remonter aux époques antérieures au XVIème siècle pour déterminer l’emplacement du ou des cimetières juifs s’avère délicat faute de documents.
Il y a toutefois une certitude, la présence des Juifs dans la cité est antérieure, très antérieure au XVIème siècle. Une consultation rabbinique autour de 1465 ( iv ) , adressée par les rabbins de Tunis à ceux d’Alger, montre bien l’existence d’une communauté. D’autre part, la grande synagogue de la Ḥâra de Tunis, le vieux quartier juif de la médina, aurait été fonctionnelle dès 1365, selon des sources autorisées ( v ) .
Ce cimetière multiséculaire fut aussi par bien d’autres aspects lié à la vie de la collectivité. Retenons l’un d’entre eux, celui du schisme des Livournais. Ces derniers, d’anciens marranes portugais établis à Livourne à la fin du XVIème siècle, commencèrent à affluer à Tunis au début du siècle suivant. En 1710, ils se séparèrent des indigènes, lesquels finirent par reconnaître, en 1741, la séparation. Il y eut désormais dans la capitale deux communautés, celle des Twânsa (Tunisiens), et celle des Grâna (Livournais). Encore que ces derniers utilisassent dans leurs actes officiels le terme de communauté portugaise, ce qui n’était rien qu’une erreur.
Cette séparation, selon certains, aurait entraîné l’existence de deux cimetières. Affirmation erronée. Dans la carte présentée par Paul Sebag dans son étude sur la Ḥâra de Tunis, Abraham Benmoussa (Tunisien) et Moïse Darmon (Livournais) sont enterrés côte à côte. On retrouve aussi, au milieu des sépultures, des lettrés indigènes, comme celle d’Isaac Lumbroso, également Livournais. Il n’y avait donc, au XVIIIème siècle, qu’un seul cimetière.
Il faudra attendre 1851 pour voir se créer un second cimetière. Débordés par le nombre de décès, lors de l’épidémie de choléra de 1850-1851, les Livournais demandent au caïd des Juifs, Joseph Bellaïche, l’autorisation d’acheter un terrain pour y ensevelir leurs morts. Ils se heurtèrent à un refus. Le caïd, toujours choisi chez les Twânsa, craignant peut-être la mise en place d’un cimetière séparé. C’est ce qui se produisit. Les Livournais, disposant sans doute d’appuis à la cour, passèrent outre et firent l’acquisition d’une pièce de terre située au sud-est de la nécropole, adjacente à ce qui deviendra sous le Protectorat la rue Navarin (voir carte de P. Sebag, p. 79). Cet épisode aggravait donc la séparation des deux communautés ( vi ) , bien qu’il n’y eût aucune clôture entre les deux espaces.
L’instauration du Protectorat français, le 12 mai 1881, allait ouvrir un nouvel et long épisode de nature différente de tout ce qui précède. La municipalité de Tunis, probablement après 1884, clôtura la nécropole du XIXème siècle encore fonctionnelle, expropriant, de facto, la communauté de tout le reste, pour cause d’utilité publique. Là s’élevèrent, par la suite, les immeubles dont nous avons parlé (Avenue de Londres, de Madrid, etc).
Pendant toute la durée du Protectorat (1881-1956), la municipalité tenta, sans succès, d’acheter le cimetière du XIXème siècle à la communauté qui s’y refusa, ne voulant aliéner le lieu de crainte (crainte fondée) que les cadavres ne fussent exhumés, acte interdit par la loi juive. En fait, la nécropole ne pouvait qu’attirer les convoitises, car située entre la médina et le lac de Tunis dans l’espace qui, dès 1884-1885, deviendra la ville européenne, de part et d’autre des avenues de France et Jules Ferry, la partie sud étant le domaine des Européens, la partie nord celui des Juifs évadés de la Ḥâra et de ses dépendances.
L’article de Rodolphe Arditti sur les épitaphes rabbiniques ( vii ) apporte encore quelques lumières. Rodolphe Arditti ou Raphaël de son nom hébraïque, d’origine bulgare, était un rabbin issu du Séminaire israélite de Paris. Il s’installa en Tunisie fin 1898 et sans doute commença-t-il ses recherches autour de 1900-1910, ne retenant, bien sûr, que les tombes des docteurs de la loi. Toutes ces tombes visitées dataient des XVIIIème et XIXème siècles. Il y avait donc un énorme trou pour les périodes antérieures. À cela plusieurs raisons, pas nécessairement opposées ; les lettrés étaient rares à Tunis avant la renaissance des études hébraïques au XVIIIème siècle. Dans ces espaces mal clôturés où plus personne ne venait visiter les tombes depuis des générations, des vandales ou des voyous s’étaient sans doute approprié les pierres tombales comme matériaux de construction. On dit enfin que le Bey Hamouda Pacha, qui régna de 1782 à 1814, aurait confisqué des pierres tombales. Peut-être eut-il l’élégance de ne pas toucher à celles du XVIIIème siècle, encore visitées, et se contenta-t-il des sépultures du XVIIème siècle, voire du XVIème siècle, depuis longtemps à l’abandon. Episode qui, a priori, ne paraît pas irrecevable dans l’exacte mesure où, au delà des pillages privés, des confiscations publiques eurent probablement lieu.
Ce cimetière eut une fin assez triste. Deux ans après l’indépendance, le 26 février 1958, la municipalité de Tunis expropria la communauté sans indemnité aucune, et dans les mois qui suivirent le cimetière devint un jardin public. De toute manière, pour les raisons signalées plus haut, la communauté ne pouvait accepter aucune indemnité. On parvint, après de longues négociations, à inhumer, dans le nouveau cimetière, les dépouilles de plusieurs lettrés, exhumés de cet espace. Autoritaire, ô combien, cet épisode laissa chez les Juifs de la ville des traces évidentes.
II – LE SITE MORTUAIRE. DÉPOUILLEMENT ET EXTRAVAGANCES
Comment se présentait la nécropole, forte de près de 22 hectares, située extramuros et inaugurée de longs siècles plus tôt, vers 1881-1890, au début du Protectorat français ? Il s’agissait de terrains humides et salés à cause de la proximité du lac de Tunis. Terrains médiocres et gorgés d’eau en hiver, à l’herbe desséchée et squelettique en saison chaude. Cet espace, d’une grande platitude, n’était égayé par aucun arbre, aucune fleur. Seuls couraient les rongeurs dont de nombreux lièvres. Il en restait quelques-uns encore, en 1945, dans le cimetière-croupion du XIXème siècle. Désaffecté vers 1890-1891, ce cimetière du XIXème siècle n’en devint pas pour autant un lieu désert, contrairement à ce qui s’était passé aux siècles précédents. Clôturé, encore que de manière rudimentaire, le cimetière fut bien moins qu’auparavant la proie des pillards. Surtout, il conserva quelques activités bien précises. Il connut quelques épisodes folkloriques ou tristes, resta fréquenté par les visites aux tombes antérieures à 1890-1891, et ce jusqu’aux années 1920, et plus encore par les pèlerinages sur les sépultures de deux rabbins fameux.
À partir de 1887, la communauté érigea avenue de Londres le dépositoire des Twânsa où les corps des défunts étaient déposés au moment des prières d’usage, avant d’être transportés par voiture hippomobile au nouveau cimetière. Rue Navarin on construisit celui des Livournais. Innovation que ces voitures tirées par des chevaux robustes à la belle prestance, esthétiquement harnachés, tranchant sur les humbles cortèges du temps jadis où les cercueils étaient portés par des hommes. Se répandit aussi à cette époque, ou un peu plus tôt, l’usage, très italien, des avis mortuaires placardés sur les murs de la ville, et surtout sur ceux du cimetière.
Les pèlerinages animèrent surtout la nécropole jusque vers 1958, pèlerinages presque strictement locaux, quasiment limités aux habitants de Tunis et un peu plus tard de ses banlieues, lorsque, après 1914-1918, des Juifs commencèrent à y habiter. Pèlerinages sur les tombes de deux rabbins : Josué Bessis, lettré connu et cabaliste, perçu par le petit peuple comme intercesseur auprès de Dieu et occultiste, voire thaumaturge ; et surtout Ḥay Taïeb, personnage étrange, très porté sur l’eau de vie de figue (la bûkha en arabe), tenu en piètre estime par les clercs de son temps dont la production littéraire nous est globalement inconnue. Il paraît avoir écrit un traité dit Ḥelev ḥi Ḥiṭṭâm (« suc de froment » en hébreu) mais la sottise d’une servante en fit disparaître la plus grande partie.
Sa tombe, surélevée de 15 ou 20 cm au-dessus du sol, surélévation pompeusement appelée, en arabe, El jbel, la montagne, était entourée d’une petite foule, canalisée par le dénommé ‘Anîba (« petit raisin » en arabe), personnage atypique, sombre comme Othello, sec et noueux comme un sarment de vigne, descendant d’un collatéral du rabbin et qui réclamait quelque argent à l’issue de la cérémonie. Il est à noter que le cimetière du XIXème siècle abritait les sépultures, jamais visitées, de bien d’autres savants, car trop intellectualisés, trop distants, incapables de faire des miracles ou de jouer le rôle d’intercesseur, ils étaient boudés, donc, par le petit peuple. Notons enfin que les tombes des rabbins du XVIIIème siècle, hors cimetière, étaient aussi visitées mais de manière moins fournie et plus discrète.
Deux épisodes très dissemblables émaillèrent la vie du cimetière après sa désaffection. Celui courant de novembre 1942 à mai 1943, lors de l’occupation allemande, où l’on creusa des tranchées pour permettre à la population des immeubles voisins de se mettre à l’abri lors des bombardements alliés. Celui, plus haut en couleurs, dit de la « guerre du cimetière », opposant, au cours de l’année scolaire 1943-1944, des enfants juifs à des enfants musulmans, à coups de pierres, qui dura de longs mois, jusqu’à ce que le Conseil de la communauté israélite de Tunis qui n’avait aucun goût pour le folklore, ne mette fin à cette guerre « picrocholine », selon l’expression de François Rabelais, en colmatant les brèches des murs. Le combat cessa alors, faute de combattants.
L’aspect de la grande nécropole (le cimetière du XIXème siècle mais aussi ceux des siècles passés) au niveau des pierres tombales était, encore que de manière complexe et contradictoire, intriqué avec les rites mortuaires de la population juive de la cité. Ces pierres tombales du XVIème au XIXème siècles étaient de simples dalles, posées à même le sol, sans aucune ostentation et dépourvues de surcharges ornementales. Or ce dépouillement, cette simplicité, contrastait violemment avec l’exubérance des cérémonies mortuaires dont il faudrait maintenant parler.
Avant les funérailles, les cris et les pleurs des femmes, accompagnés des hurlements des pleureuses qui souvent se laceraient les joues, composaient un étrange tableau contrastant avec les visages fermés des hommes et leur pesant silence ( viii ). Les cortèges funèbres se composaient la plupart du temps d’hommes. Les femmes apparaissaient, en force, lors des visites au cimetière, en règle générale, les vendredis matins. Là, assises près des sépulcres ou couchées sur eux, elles reprochaient amèrement au défunt, ou à la défunte, leur absence, les tenaient au courant des menus événements de la chronique, réclamaient leur retour. Ces manifestations, le plus souvent, duraient quelques mois ou un peu plus. Puis s’installait le silence et l’opacité. Ainsi au dépouillement, à l’humilité des lieux, à la modestie des pierres tombales, s’opposaient la violence de la gestuelle, l’extravagance, et l’excentricité du discours. Mort baroque, dirions-nous, selon l’expression de l’historien français Michel Vovelle, mais à la différence que le baroque d’Occident comportait une surcharge ornementale des monuments funéraires, ici absente.
III – EPITAPHES, ANTHROPONYMIE
Les sources concernant les épitaphes et leurs retombées anthroponymiques se trouvent, bien sûr, dans l’article de Rodolphe Arditti déjà cité. Cependant, la liste des patronymes que nous pourrions y découvrir est loin d’être exhaustive. Il faut donc recourir à deux ouvrages récents. Celui de Paul Sebag sur les noms des Juifs de Tunisie, paru en 2002, et celui que nous avons nous-mêmes commis en 2004 sous l’égide du Cercle de généalogie juive concernant tout le Maghreb .( ix )
Nous nous bornerons dans cette étude anthroponymique à la communauté des Twânsa, celle des Grâna ayant déjà été traitée dans les pages de la Revue du Cercle de généalogie juive ( x ). Le livre de Paul Sebag et le nôtre ayant déjà, dans une large mesure, élucidé le sens des patronymes et leur date d’apparition, il ne sera pas question d’y revenir. On recensera donc simplement les noms de famille, on cherchera à déterminer leur fréquence ( xi ) ou leur rareté. On se livrera, enfin, à quelques considérations sur les caractéristiques anthroponymiques de la population juive de la cité.
L’article de Rodolphe Arditti recense, pour les XVIIIème et XIXème siècles, plusieurs dizaines de patronymes appartenant surtout à la communauté des Twânsa. Il s’agit le plus souvent de familles patriciennes, de lignées rabbiniques. Nous en citons ici simplement quelques-uns comme les Borgel, les Cohen-Tanugi, les Cohen-Solal, mais également les Scemama, les Nataf, les Bessis qui, elles, avaient des homonymes, en revanche, dont il fallait se distinguer.
Au-delà, vient la masse des noms de famille. Mais là encore il ne saurait être question de recenser tous les noms de famille de la capitale tunisienne au temps du Protectorat. On se contentera des Tunisois de souche, c’est-à-dire de ceux qui y vivaient avant le Protectorat. Car eux, et eux seuls, s’inscrivaient dans la longue durée. Quant un nom, selon la mémoire collective, provenait d’une autre ville ou d’une autre région, nous en avons mentionné l’origine entre parenthèse et parfois, approximativement, la date d’installation à Tunis.
Nous commencerons, dans le tableau ci-après, par présenter les noms de famille les plus courants. Comme pour le second tableau qui suivra, nous retiendrons les orthographes les plus fréquentes.
NOMS DE FAMILLE FRÉQUENTS
Abitbol ou Boutboul Gozlan Nadjar ou Nizard
Ankri Guetta (Libye ?) Nahum ou Nahoum
Assous Guez ou Ghez Nataf
Attal Haddad (Djerba) Pariente
Azoulay Haouzi Perez
Barouch Hayoun Saada
Bellaïche Jami Samama ou Scemama
Berrebi Jaoui Sarfati
Bessis Journo (Sicile ou Italie du Sud ?) Sebag
Bijaoui ou Bigiaoui Junès ou Younès Sfez
Bocobza ou Bokobza Kalfon ou Halfon Sitbon ou Setbon
Boubli ou Boublil Kayat ou Hayat Sitruk
Bramli ou Brami* Koskas ou Coscas Slama
Chikly ou Chikli Krief Smadja ou Smaja
Chemla ou Chmila Ktorza ou Ctorza Taïeb
Cohen (Djerba pour partie) Lellouche
(Testour S.O de Tunis pour partie)
Uzan
Cohen-Tanugi (Sicile, 1493 ?) Lévi ou Lévy Zarka
Dana Maarek Zerah
Fellous Madar (Djerba) Zeitoun ou Zitoun
Fitoussi Marouani Zuili (Mahdia, centre est
de la Tunisie ?)
Gabison Meimoun et Meïmouni**
Gablula (Libye ?) Moati
Ganem ou Ghanem Naccache
*Les deux patronymes Brami et Bramli n’appartiennent pas à la même souche. Le premier signifie en hébreu « appartenant à la famille » d’un certain Abrahami ou Brahami. Le second signifie en arabe « tonnelier ». Il était plus fréquent que l’autre vers 1880. Pour des raisons qui nous échappent, la municipalité de Tunis transforma, pour l’état-civil, beaucoup de Bramli en Brami, créant une certaine confusion.
**Le second patronyme, assez rare, appartient à la même souche que le premier et serait originaire de Testour, S.O. de Tunis.
Nous chercherons donc d’abord à déterminer la fréquence de ces patronymes et à nous livrer à quelques exercices statistiques. La mémoire collective, souvent fidèle dans ces sociétés traditionnelles, retient aisément l’origine géographique des porteurs de patronymes, connaît les noms les plus fréquents mais sans fournir, bien entendu, la moindre donnée statistique. Essayer de démêler quelque chose dans le précédent tableau commanderait de connaître, même approximativement, le nombre des Juifs de la capitale à différentes époques. En nous basant sur les premiers recensements effectués la Tunisie, après la Grande Guerre et plus encore sur des estimations communautaires sérieuses datant de 1895, on peut raisonnablement penser que vers 1880 il y avait à Tunis 14 000 Juifs dont quelque 2 000 Livournais. La population à cerner s’élèverait donc à quelque 12 000. Pour la plupart des patronymes du tableau il y avait une grosse centaine de porteurs, mais certains en comptaient davantage.
Ces patronymes plus fréquents étaient les suivants : Assous, Attal, Bellaïche, Bismuth, Brami et Bramli, Chemla et son diminutif Chmila, Cohen, Fellous, Guez, Haddad, Maarek, Najjar ou Nizard, Saada, Samama ou Scemama, Serfati, Sitbon, Sitruk, Slama, Smadja, Taïeb, Uzan, Zeïtoun.
Le tableau ci-après comptait donc probablement plus de 10 000 porteurs, c’est-à-dire près de 85 % de la population. L’anthroponymie était donc relativement resserrée et également probablement ancienne. Une partie de la population descendait de gens vivant dans la ville avant la présence ottomane (fin du XVIème siècle). Une partie s’y était installée après cette date, tout au long des XVIIème et XVIIIème siècles, avec le développement économique dont bénéficiaient la cité et son avant-port de la Goulette.
Tous ces noms, sauf Cohen-Tanugi, correspondaient à plusieurs familles homonymes. Ces familles appartenaient à des strates sociales différentes, séparées qu’elles étaient par le revenu et le niveau de dignité urbaine. Quelques-uns étaient, en ce temps, considérés comme plébéiens : Haouzi, Journo, Krief.
NOMS DE FAMILLES RARES*
Adda Cohen-Boulakia
(Levant ottoman) Raccah (Libye)
Addaoui
Cohen-Hadria** Riahi ou Yarhi*** (Languedoc,
Provence ?)
Allal
Cohen-Jonathan
(Alger ?) Ruben, Rubens
Allouche (Sud tunisien)
Cohen-Solal
(Baléares, Alger ?) Saadoun (Sud tunisien)
Assal Cohen-Zardi Saal
Baranès Constantini
Sabban (Djerba ?)
Belhassen (Maroc) Diens ou Dian
Sberro ou Zbirou
(Libye ?)
Benaïnous (Alger 1800 ?) Douieb (Djerba) Secnazi
Benmoussa
El Malih (Maroc) Senouf
Benattar
(Gibraltar fin XVIIIème) Fargeon (Djerba) Slakmon (Djerba)
Benisti Farhi (Levant ottoman)
Stioui (Libye ?)
Bennéro Fassi, Elfassi (Maroc)
Taji et Bismuth-Taji
Berda (Lybie)
Hababou (Sousse, Tunisie ?)
Tartour
Besnaïnou Haccoun (Alger) Temam
Bijaoui-Bellham Hassan Temim
Bissor Hassid
Tibi
Bittan Houbani Touitou (Tozeur S.O Tunisie)
Borgel
Jarmon (Tripoli de
Barbarie, Libye) Tubiana (Alger ?)
Cacoub
Jerusalmi (Levant ottoman) Tuil
Caroubi
Krissi
Tuil-Tartour
Castro (Espagne)
Nataf-Tartour
Wakil ou Ouakil ou Ouaki
Cattan (Levant ottoman)
Lahmi
Zakine
Chaltiel
(Testour S.O de Tunis)
Marzouk
Zarhi
Chaouat
Melloul Zouari
Chiche (Alger 1800 ?)
Messas ou Mechach
Messica (nord de la
Tunisie)
*On pourrait y rajouter le patronyme de Freva. Mais sa naissance serait récente (à quelle date ?). Il semble en tout cas extérieur à notre horizon temporel à long terme.
**Les Cohen-Hadria ne seraient qu’une branche des Cohen-Tanugi.
***Riahi peut bien être la metathèse (inversion de lettres) de Yarhi. Ou encore il pourrait s’agir de deux noms différents :
Riahi, en arabe, désigne un membre d’une tribu bédouine, celle des Riyâh, du nord de la Tunisie. Yarèaḥ, qui signifie “lune” en araméen. Les Riahi ou Yarhi se disent originaires de la cité de Lunel en Languedoc qui, avant l’expulsion des Juifs de France au XIVème siècle, abritait une importante communauté
Le nombre de porteurs par patronymes (un peu plus de vingt ?) est ici sensiblement plus bas que précédemment, mais certains noms comme Assal, Baranès, Chaouat, Hababou, Raccah, Temam, Tuil, Zakine, Zouari étaient sans doute un peu moins rares. Peut-être avons-nous affaire à l’existence de deux familles homonymes dans ces cas précis ?
La faible fréquence correspondait à l’existence de surnoms, par essence, typiques et limités. Un cas paradigmatique nous est donné par l’existence du patronyme Tartour (un couvre-chef turc) donné (vers 1800 ?) à une famille Nataf et à une famille Tuil avec création de deux noms composés ou à une véritable substitution, Tartour tout court.
Une autre cause de ces faibles moyennes de fréquence est, peut-être, à chercher dans l’arrivée au cours des siècles de familles nucléaires, par essence, peu nombreuses, surtout avec les ravages de la mortalité d’alors. Le phénomène paraît moins se retrouver dans le précédent tableau. En particulier, les immigrés venus nombreux de Djerba, surpeuplée et pauvre, appartenaient souvent à des familles homonymes installées dans la capitale à différentes époques (Cohen, Haddad, Madar). Conséquence de cette faiblesse statistique, le fait probable que les patronymes du second tableau, globalement, étaient des familles uniques sans homonymes.
Mentionnons, comme pour le premier tableau, que certains noms, à l’époque, étaient perçus comme plébéiens, tels Assal, Benisti, Bissor, El Malih, Haccoun, Hasson, Melloul, Tuil, Wakil, Zarhi, Zouari. Les Krissi, enfin, « petite chaise » en arabe, se seraient jadis appelés Bonan (une vieille famille de Tunis considérée comme livournaise), tout au moins à l’origine.
* *
*
Situé en plein cœur de la ville coloniale, de 1900 à 1958, le vieux cimetière fut jadis en position périphérique, extramuros. En fait, au fil des siècles, il ne cessa de glisser du Septentrion vers le Midi au fur et à mesure des mises à sac ou des abandons des vieilles nécropoles, surtout celles du XVIème et du XVIIème siècles, plus jamais visitées, l’oubli des décès les plus anciens ayant fait son œuvre.
Au début du Protectorat, les autorités communautaires n’oseront s’opposer à ce qui ressemblait à une expropriation pour les parties les plus anciennes du cimetière (XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles). Par la suite, la découverte de l’état de droit permit de sauvegarder l’espace du XIXème siècle avant l’éviction rapide de 1958. Demeuré plus ou moins un musée, cet espace frappait par sa pauvreté et son austérité, à l’image des usages du pays où les nécropoles musulmanes présentaient le même aspect. Le cimetière résiduel fut aussi un livre d’histoire. L’anthroponymie qu’il livra fut, durant quatre siècles, celle de la communauté des vivants, de leur foi et de leurs peines ; mais elle peupla massivement, aux mêmes époques, les stèles funéraires d’une cité qui, du début du XVIIIème siècle à la Grande Guerre, voire au-delà, abrita la plus grande collectivité juive du Maghreb, avant d’être devancée par l’agglomération de Casablanca, probablement dès avant 1940, puisque, en 1947, la cité marocaine et ses banlieues dépassaient vraisemblablement 86 000 Juifs au-delà de ce que disaient les annuaires statistiques.
La fin du cimetière inaugura la fin des lieux de mémoire. En 1958 on expropria les morts. En 1960-1961 fut détruit le vieux cimetière historique de la Ḥâra et de sa vénérable grande synagogue, le tout, quelques années avant que les vivants ne quittent à jamais les rives de Carthage. Demeuré en l’état, le nouveau cimetière de Borgel, inscrit dans la modernité, mais dépourvu de légitimité faute d’enracinement dans le temps long. Survivra-t-il d’ailleurs devant l’extension urbaine de la ville de Tunis ? Rien n’est moins sûr.
i Cf. Paul Sebag, Tunis, Histoire d’une ville, Paris, L’Harmattan, Histoire et Perspectives Méditerranéennes, 1998, pp. 131, 175, 235, 277.
ii Charles Haddad de Paz, Les Juifs de Tunisie, à bible vécue, Paris, sans mention d’éditeur ?, 1988, pp. 312-313.
iii Cf. Paul Sebag avec la collaboration de Robert Attal, La Ḥara de Tunis, Evolution d’un ghetto nord-africain, Paris, PUF, 1959, p. 79.
iv H.Z. Hirschberg, A History of the Jews in north Africa, Leiden, E.J. Brill, 1974, From Antiquity to the sixteenth century, tome I, pp. 458-480.
Encore que la présence juive dans la capitale soit sans doute très antérieure à cette date, puisqu’il y est dit que jadis les Juifs habitaient un fondouk, type d’habitat précaire, près de Bâb el kḥar, « la porte de la mer » en arabe. Ce n’est que bien plus tard qu’ils s’installèrent dans un autre quartier, car sans doute devenus plus nombreux. Ce nouveau quartier était vraisemblablement la Ḥara de Tunis.
v Cf. Avraham Attal, Bate kenesiyot betunis bechana 1956 (en hébreu), Les synagogues de Tunis dans l’année 1956, in Tarchich (Carthage en Hébreu), direction Ephraïm Hazan, Haïm Saadoun, Ramat Gan (Israël), Université Bar Ilan, 1987 ?
Voir aussi Benjamin Raphaël Cohen, Malké Tarchich (en hébreu), Les rois de Carthage, Israël, pas de mention d’éditeur, 1984 ou 1985. Ce temple que nous avons connu dans notre jeunesse, semblait, à première vue, bien moins ancien, mais au fil des siècles des restaurations eurent lieu, la dernière en date se situant autour de 1910. Sur ce dernier point voir Jacques Revault, La grande synagogue de la Ḥara de Tunis, Cahiers de Tunisie, n° 41-42, 1968.
vi Cf. Itshaq Avrahami, Qehilat Portuguesim betûnîs upinquasah (en hébreu), La communauté portuguaise de Tunis et son mémorial, Ramat Gan (Israël), Université Bar Ilan, 1982, tome 1, p. 149 et sq.
vii Cf. Rodolphe Arditti, Epitaphes rabbiniques de l’ancien cimetière israélite de Tunis, Revue tunisienne, 1931, pp. 105-119 et 405-411 et 1932 pp. 99-111.
viii Le souci de l’exactitude amène à légèrement nuancer ce tableau car les familles patriciennes, les lignées rabbiniques, les lettrés avaient en règle générale une attitude plus discrète. Les Livournais de leur côté étaient extérieurs à ces « extravagances ». Plus précisément, les Livournais, venus au XIXème siècle, de langue et de culture italiennes, Garibaldiens, bourgeois libéraux adeptes des lumières et très loin de l’orthopraxie en matière religieuse, alors que ceux, plus anciennement installés, surtout chez les pauvres, devenus de langue et de culture arabes, avaient adopté les us et coutumes des indigènes en la matière. Un amusant dicton chez les Twânsa qualifie de meṭṭa met’a Gwâna (un enterrement livournais), une assemblée discrète et silencieuse. Le mot meṭṭa de l’hébreu miṭṭa (lit.) désigne un enterrement comme son équivalent arabe, dafîna.
ix Cf. Paul Sebag, Les noms des Juifs de Tunisie, origines et significations, Paris, L’Harmattan, 2002, passim. Jacques Taïeb, Juifs du Maghreb, noms de familles et société, Paris, Cercle de généalogie juive, 2004, passim.
x Cf. Jacques Taïeb, Les Juifs livournais de Tunis : démographie et anthroponymie historiques, Revue du Cercle de Généalogie juive, n° 95, tome 24, juillet-septembre 2008,
pp. 14-19.
Sur ces questions de fréquence des patronymes voir Jacques Taïeb, Juifs du Maghreb… op. cit., pp. 184-189. Voir aussi Joseph Tolédano, Une histoire de familles. Les noms de famille des Juifs d’Afrique du Nord des origines à nos jours, Jérusalem, Editions Rambol), 1998, p. 862.
xi Cf. André Chouraqui, La condition juridique de l’Israélite marocain, Paris, AIU, Presse du Livre français, p. 211. Tunis et ses banlieues, en 1947-1948, comptaient sans doute 63 000 Juifs.
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 08 mai 2011, 11:51 |
Modérateur Membre depuis : 20 ans Messages: 3 103 |
vous remercie des marques de sympathie que vous avez bien voulu manifester
lors du décès de son co-fondateur
Jacques Taieb
Agrégé de Sciences Sociales
Ancien chargé de cours à Paris I
Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire des Juifs du Maghreb
Arrière petit-fils du Grand Rabbin de Tunisie Eliaou Borgel
survenu le 2 mai 2011
L’office des chiva aura lieu le mardi 10 mai 2011 à 19 heures 30 au Centre Communautaire de Paris
119, rue La Fayette 75009 PARIS (Métro : Poissonnière ou Gare du Nord – Parking Frantz Listz)
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 08 mai 2011, 13:54 |
Modérateur Membre depuis : 20 ans Messages: 3 103 |
par Claude Nataf, Président de la SHJT
J’ai le triste devoir d’adresser à Jacques Taieb, le dernier adieu de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie que nous avions fondée ensemble et à laquelle il apporta pendant quinze années sans discontinuer, les ressources de son intelligence, de son érudition, de son énergie et de son cœur.
C’est l’âme bien pesante que j’assume cette mission, car j’étais lié à Celui que nous pleurons aujourd’hui, par des liens de famille, par des liens d’affection profonde, nourris par des réflexions et des recherches communes, des liens de complicité intellectuelle, et il m’est difficile de ne pas céder à l’émotion qui m’étreint.
Petit-fils du Rabbin Yossef Borgel, il descendait par sa mère de cette illustre famille rabbinique qui a donné au judaïsme tunisien tant d’érudits et d’ouvres philosophiques et dont quatre membres se succédèrent durant deux siècles aux fonctions de Grand Rabbin de Tunisie. Dans son enfance, sa mère et ses oncles Etienne et Léon Borgel, évoquaient devant lui le Grand Rabbin Eliaou Borgel, dernier Caïd des Juifs, Grand Rabbin de Tunisie au début du Protectorat, Président du Comité de bienfaisance et Président du Comité régional de l’Alliance Israélite Universelle, qui ouvrit par son action en faveur de l’instruction profane et de la modernité, les voies de l’émancipation du judaïsme tunisien.
C’est la leçon de l’arrière grand-père et des aïeux qu’il apprit à connaître dans les histoires du passé, c’est cette leçon qui l’amena à toujours s’engager en faveur de l’éducation et de l’enseignement, et à s’intéresser à l’Histoire des Juifs de Tunisie.
S’intéresser le mot est impropre ; disons plutôt se passionner, se donner tout entier, fouiller les archives, interroger les derniers témoins, accumuler les données, se mettre à l’étude de la démographie et de l’économie, car il comprit très vite que sans la connaissance des contingences démographiques et économiques, l’Histoire ne pouvait ni être comprise ni être expliquée.
Après de brillantes études, après avoir enseigné l’histoire et la géographie à l’école de l’ORT à l’Ariana puis au Lycée Carnot et à Paris au Lycée La Fontaine, il reprit le chemin de l’Université le temps de passer une agrégation qui lui ouvrit les portes de l’enseignement supérieur. Mais à côté de son activité d’enseignant, reconnu pour ses qualités pédagogiques et sa clarté d’exposition, par sa sévérité intellectuelle qui n’excluait pas la bienveillance, il fut aux côtés de Robert Attal, d’Itzak Abrahami, de Paul Sebag, de Lucette Valensi et de Claude Tapia, l’un des pionniers de l’étude scientifique de l’histoire des Juifs de Tunisie.
C’est en 1994 qu’il publia son premier livre Etre Juif au Maghreb à la vieille de la colonisation, livre que l’on rêverait d’avoir écrit, dont la concision n’exclut pas l’érudition et la richesse des informations mais où apparaît l’un des mérites essentiels de Jacques Taieb : avoir été l’un des premiers sinon le premier à saisir l’existence d’éléments communs aux communautés juives du Maghreb et donner à ses travaux une orientation comparatiste. En même temps il montrait que l’attrait de la modernité occidentale préexistait à la colonisation dans ces communautés et que la marche vers l’Occident avait en fait commencé dès la Révolution Française.
Depuis, ses articles, ses interventions dans des colloques, ses œuvres se sont multipliées à la fois sur l’histoire du judaïsme tunisien mais également sur les communautés d’Algérie, du Maroc, de Libye, sur la généalogie, sur l’onomastique, sur l’économie, car il était d’une curiosité intellectuelle peu commune. S’il était devenu avec Abdelhamid Larguèche l’un des rares spécialistes du judaïsme tunisien durant le XVIIIème siècle et la période précoloniale, aucun domaine du judaïsme maghrébin ne lui était étranger.
Je me souviens de nos longues conversations au moment où l’Université tunisienne et l’Université israélienne devenues l’une et l’autre et pour des raisons différentes friandes de l’histoire des minorités, commençaient à s’intéresser au judaïsme de Tunisie où apparurent les premières thèses, celle de Yaron Tsur à Jérusalem, celle d’Abdelkrim Allagui à Tunis. Nous déplorions ensemble le manque d’intérêt de l’Université française alors que les études juives y prospéraient. Nous regrettions que les romanciers et les collectionneurs, donnent de ce judaïsme une histoire déformée, nourrie de traits grossis et de folklore. C’est ainsi qu’est née l’idée en avril 1997 à notre initiative commune la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie dont Jacques voulut plus que d’autres qu’elle soit un pont entre les chercheurs du Ponant et du Levant en même temps qu’une impulsion à l’étude scientifique à l’histoire des Juifs de Tunisie. Depuis ce moment là s’est installée entre nous une habitude de contacts quotidiens : nous échangions des idées, nous nous tenions informés des publications et des travaux récents, des archives à découvrir … Un travail de quinze ans marqué par l’organisation en Sorbonne de quatre colloques internationaux, de plus d’une centaine de conférences, le sauvetage d’archives et de nombreuses thèses dont l’idée était née dans les réunions de la Société d’Histoire de Tunisie. Cette Société d’histoire il l’aimait ; il s’inquiétait des jalousies que sa réussite indéniable lui valait, il souhaitait que sa pérennité soit assurée.
Alors aujourd’hui je me demande pourquoi ? Pourquoi lui, alors que tant de chantiers restent ouverts, que des archives perdues sont retrouvées et que la recherche universitaire en ce domaine de l’histoire des juifs du Maghreb a besoin d’un nouveau souffle, pourquoi va-t-il nous manquer. Je ne suis pas rabbin pour répondre à cette question, mais du plus profond de moi, du plus profond de mon cœur de Juif croyant, je suis persuadé que le Saint-Béni-Soit-il l’accueille en cet instant au Gan Eden avec les Saints Patriarches et les rabbanim nos ancêtres afin qu’il nous éclaire de ses lumières et nous permette de donner une impulsion nouvelle.
J’ai reçu ce matin même un message de nos amis Kazdaghli, Larguèche et Allagui, de l’Université tunisienne dont je souhaite vous donner lecture :
L’annonce du décès de notre ami Jacques Taieb nous a durement touchés. Depuis de longues années nous avons collaboré dans la joie, le sérieux et la confiance avec Jacques Taieb. En Tunisie, nous garderons de lui l’image du chercheur humble, sérieux, objectif et dévoué pour l’écriture de l’histoire des juifs de Tunisie et du Maghreb. Ses articles, ses livres sont bien connus de tous et sont tous utilisés dans les études relatives à l’histoire des juifs de Tunisie et du Maghreb. Les jeunes chercheurs tunisiens garderont de lui l’image du grand frère généreux qui les a guidé, au cours de leurs passages en France, à trouver articles ouvrages, sources inédites…
En ces moments de douleur qui nous frappent tous et toutes suite au départ de Jacques, au nom du Laboratoire : Régions et ressources patrimoniales de Tunisie, nous exprimons à nos amis de la SHJT et à la famille de Jacques nos plus sincères condoléances et nous les assurons toute notre sympathie et notre amitié. Nous nous engageons à continuer la collaboration et la coopération avec nos amis de la SJHT pour une écriture en partage de l’histoire des juifs de Tunisie, œuvre à laquelle notre cher Jacques a grandement contribué.
Jacques était rigoureux, implacable avec l’à peu près, les erreurs communes. Il avait consacré plusieurs travaux à l’histoire des Borgel. Il aimait la discrétion de ses ancêtres qui ont laissé des œuvres considérables connues des seuls érudits, et qu’il comparait souvent avec la notoriété posthumes de certains rabbins prétendus miraculeux. La vénération qu’ils trouvaient de nos jours l’irritait de plus en plus lorsqu’elles venaient de responsables religieux desquels on attendait moins de démagogie et de rigueur intellectuelle.
Ce n’est pas sans raison qu’il consacrât son dernier article à la généalogie du Grand Rabbin Eliaou Borgel. J’y vois là un message destiné à nous tous mais surtout à son fils Emmanuel, , l’obéissance au soir de sa vie au commandement biblique de la transmission, car lui qui se refusait à répondre à toutes les sollicitations de fonctions communautaires, considérait que la fidélité à ses origines familiales lui commandait de ne pas de désintéresser de la Communauté, d’être fidèle au message moderniste de l’arrière grand-père, et c’est tout naturellement qu’il soutint avec vigueur la candidature de Gilles Bernheim aux fonctions de Grand Rabbin de France parce qu’il lui semblait le plus même de réhabiliter dans le corps rabbinique et au Séminaire l’enseignement de l’histoire et de la philosophie.
Il y a un an, il fut frappé par la maladie, brisé au milieu de ses recherches. Ce fut pour lui une année difficile, partagée par son épouse, la compagne de sa vie vers qui va notre respect et notre affection. Mais malgré les atteintes du mal de plus en plus difficiles à supporter nous avions nos conversations quotidiennes, et il continuait à suivre, à conseiller, à diriger, à impulser des travaux toujours avec la même lucidité, la même vigueur intellectuelle. Seule sa voix révélait parfois sa fatigue et son affaiblissement mais sa plume était toujours là et il donna différents articles avant sa disparition.
Croyant mais non orthodoxe, libéral mais respectueux des traditions, il était profondément Juif et profondément universel. Attaché à Israël il militait pour une entente judéo-musulmane et favorisait les contacts intellectuels entre chercheurs israéliens et maghrébins qu’il estimait indispensable à la création d’un esprit de paix. Juif et Français, il était très attaché aux valeurs républicaines et à l’intégration hors de tout esprit communautariste qui excluait l’universel vers lequel il voulait tendre.
Jacques était bon, et s’il était sévère et implacable dans ses jugements, s’il savait dans nos réunions défendre son point de vue avec vigueur, lorsqu’il sentait qu’il avait mis à mal son interlocuteur, il allait après coup le voir en tête à tête, lui témoigner de l’amitié et panser la plaie qu’il pensait avoir causée.
En présence de la mort d’un homme nous perdons contact avec son enveloppe charnelle, mais l’âme immortelle demeure, ne serait-ce que par le souvenir.
Avec le savant que fut Jacques Taieb, si cruelle que soit la séparation, par delà le tombeau, demeure l’exemple et dans cet adieu que je lui adresse au nom de tous et particulièrement au nom de la Société d’Histoire des Juifs de Tunisie est exprimé l’hommage de notre reconnaissance et qu’il me soit permis d’évoquer la phrase de l’Ecriture :
« Celui qui poursuit la Justice et la Bonté trouve la paix, la justice et la gloire ».
En cet instant qui est celui de la séparation terrestre, Jacques, je ne te dis pas Adieu, mais Au Revoir.
Claude Nataf
5 mai 2011
|
Re: Décès de Jacques Taieb - Historien 16 mai 2012, 06:24 |
Modérateur Membre depuis : 20 ans Messages: 3 103 |
|
Jacques Taieb - Soirée du livre à sa mémoire le 6 février 01 février 2014, 13:22 |
Modérateur Membre depuis : 20 ans Messages: 3 103 |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.