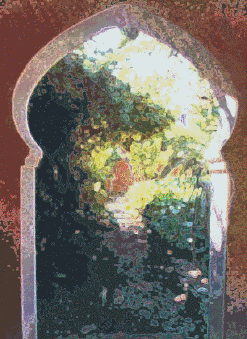|
|
Accueil des forums
>
ADRA - COMMENTAIRES
>
Discussion
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Géopolitique 14 septembre 2009, 08:34 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La confiance d'un quotidien
Le Haaretz se montrait, hier, particulièrement optimiste. Sous la signature de l’un de ses meilleurs journalistes, Akiva Eldar, le quotidien israélien de référence annonçait l’ouverture, sous un mois, de nouveaux pourparlers de paix israélo-palestiniens fondés sur un accord prévoyant la proclamation d’un Etat palestinien dans un délai de deux ans.
Citant des sources palestiniennes et européennes non identifiées, s’appuyant aussi sur des propos prêtés au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le quotidien affirmait qu’Israël et les Etats-Unis seraient sur le point d’arriver à un compromis sur la durée – entre neuf et douze mois – d’un gel temporaire de la colonisation des Territoires occupés qui ouvrirait la voie, dans une dizaine de jours, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, à un sommet tripartite entre Barack Obama, Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas, le président palestinien.
Selon le Haaretz, ces futures négociations porteraient en premier lieu sur le tracé de la frontière entre les deux Etats et, comme l’avait suggéré, avant l’été, le responsable de la diplomatie européenne, Javier Solana, l’Onu pourrait admettre la future Palestine en son sein dans ce délai de deux ans, avant même, le cas échéant, qu’un accord de paix ne soit entièrement conclu.
Une très grande prudence s’impose. Beaucoup des diplomates en poste à Tel Aviv considéraient, dimanche, que le Haaretz prenait, là, ses désirs pour des réalités. En admettant même que tout cela soit réellement envisagé par l’Autorité palestinienne et Israël, ces perspectives pourraient être vite, et comme tant de fois, remises en question par un développement ou l’autre. Cet article n’est pas à déjà prendre pour argent comptant, mais il est, au moins, le signe que les choses bougent plus qu’on ne le croit sur le front israélo-palestinien.
Ce n’est pas seulement que Georges Mitchell, le représentant spécial de Barack Obama pour le Proche-Orient, soit de retour dans la région et que Benjamin Netanyahu se soit entretenu, hier, au Caire, avec Hosni Moubarak, le chef de l’Etat égyptien. Cinq éléments de fond sont à prendre en considération.
Le premier est que les dirigeants palestiniens sont fermement décidés à faciliter les efforts de paix de Barack Obama tant ils sont convaincus qu’ils ne retrouveront pas de sitôt de tels appuis à la Maison-Blanche et qu’ils pourraient donc se montrer souples sur les conditions d’un gel de la colonisation. Le deuxième est que le gouvernement palestinien s’est lancé, en août, dans un programme de construction d’un Etat en deux ans.
Le troisième est que Barack Obama a besoin d’une amorce de succès diplomatique pour consolider sa position et que ses pressions sur Israël ne se relâchent pas. Le quatrième est que les régimes arabes veulent en finir avec ce conflit pour priver les islamistes de leur meilleur terreau. Quant au cinquième, il est qu’il n’y a plus de grande force politique israélienne, même le Likoud de Benjamin Netanyahu, pour refuser le principe d’un Etat palestinien. Reste les détails, quand, comment, dans quelles frontières – là où le diable se loge.
|
Re: Géopolitique 15 septembre 2009, 01:32 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Ils ont inversé les rôles. Hier, sous Georges Bush, les Américains refusaient tout contact avec l’Iran tandis que les Européens plaidaient en faveur d’un dialogue qu’ils ont, d’ailleurs, longtemps mené sans le moindre succès. Désormais, c’est le contraire. Sous Barack Obama, ce sont les Américains qui souhaitent le contact avec Téhéran pendant que les Européens cachent à peine, et disent en privé, qu’ils ne voient plus, là, qu’une perte de temps dont la République islamique saura, elle, profiter pour poursuive sa marche vers la maîtrise de l’arme atomique.
Cette différence d’appréciation, cette divergence plutôt, s’était clairement entendue, fin août, lorsque Nicolas Sarkozy s’en était vivement pris aux dirigeants iraniens, devant l’ensemble des ambassadeurs français, en expliquant que c’était les mêmes qui avaient truqué leurs élections et qui assuraient que leur programme nucléaire n’avaient qu’une vocation civile et non pas militaire. En contrepoint de la « main tendue » de Barack Obama, le président de la République s’était posé en homme qui n’avait pas peur d’un bras de fer avec Téhéran, en partisan de la manière forte, de nouvelles et dures sanctions économiques, mais les Iraniens ont répondu, depuis, aux offres de dialogue américaines.
Par un texte remis aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus l’Allemagne, première des puissances européennes, ils ont proposé de débattre d’à peu près tous les problèmes du monde, mais pas de leurs ambitions nucléaires. Des deux côtés de l’Atlantique, la réaction a, d’abord, été, la même – rien de neuf, ils nous mènent en bateau – puis les Européens ont vite senti que les Américains ne voulaient pour autant pas rompre avec Téhéran, constater une impasse iranienne qui se serait alors ajoutée aux autres difficultés, diplomatiques et intérieures, de la Maison-Blanche. Les Occidentaux s’étaient donc mis d’accord sur une double réaction, un compromis ambigu aux termes duquel ils se diraient insatisfaits des propositions de l’Iran mais demanderaient à rencontrer ses négociateurs pour un rendez-vous de la dernière chance. Russes et Chinois ont avalisé ce compromis car ils ne voulaient pas plus que les Américains d’épreuve de force immédiate.
Depuis hier, rendez-vous est pris pour le 1ier octobre mais Bernard Kouchner a exprimé l’état d’esprit européen en lançant : « Je n’en attends pas grand-chose, hélas ! » alors que le secrétaire américain à l’énergie déclarait, lui, qu’il s’agissait, là, d’un « pas important » et qu’il « croisait les doigts ».
On verra qui a raison dans quinze jours mais le débat est simple. Ou bien l’on considère, comme les Américains, que les Iraniens cherchent à sauver la face et acceptent sans le dire une négociation sur le nucléaire qui serait noyée dans une négociation tous azimuts. Ou bien l’on pense, comme les Européens, que l’Iran ne veut que gagner du temps, faire durer de fausses négociations qui leur permettront de poursuivre leur programme, sans nouvelles sanctions. Ces deux lectures sont possibles et mettent aux prises l’Europe et l’Amérique.
|
Re: Géopolitique 16 septembre 2009, 04:49 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
mercredi 16 septembre 2009
La taxe Tobin et le retour de l'Etat
Promesse de campagne, dira-t-on, et ce n’est pas faux. José Manuel Barroso avait bien évidemment en tête le vote par lequel les députés européens doivent se prononcer aujourd’hui sur sa reconduction à la présidence de la Commission de Bruxelles lorsqu’il s’est dit, hier, en faveur de la taxe Tobin, de cette taxe sur les transactions financières dont les altermondialistes réclament l’établissement depuis bientôt dix ans.
Cela ne peut que l’aider à gagner des voix. Bruxelles valait bien une messe pour cet homme qui était si libéral il y a encore si peu de temps mais on aurait, pourtant, tort de ne voir, là, qu’une habileté électorale car cette conversion a un contexte. La révolution ne monte pas, nulle part. Ceux qui sont frappés par le chômage, le blocage des salaires ou leur baisse, la précarisation de l’emploi et la dégradation des conditions de travail, par cette insécurité sociale que la crise vient d’encore augmenter, sont plus assommés que prêts à descendre sur le pavé mais une colère n’en gronde pas moins.
Il n’y a plus un pays, pas même les Etats-Unis, où l’obscénité de certains revenus patronaux et l’arrogance avec laquelle les banques recommencent à distribuer ces bonus abracadabrants ne suscitent pas une indignation, ni de gauche ni de droite mais générale et que les dirigeants politiques ne peuvent plus ne pas prendre en compte.
Tout les pousse, désormais, à tenter de moraliser l’économie et rétablir ces règles que les libéraux avaient défaites l’une après l’autre depuis les années 80. Comme pour José Manuel Barroso, c’est beaucoup là-dessus que les uns et les autres joueront leurs réélections et ils sont d’autant plus décidés à agir que la crainte de nouvelles crises les conduit à vouloir redonner aux Etats une parcelle au moins de la toute-puissance que les marchés s’étaient arrogé.
Depuis un an, une bataille s’est ouverte entre les Etats et les marchés, entre les hommes politiques et le monde financier. Elle est beaucoup plus dure qu’on ne le croit et les signes ne cessent plus de s’en multiplier.
Lundi, c’était Barack Obama qui tançait durement les banques américaines. Avant, on avait entendu le ministre allemand des Finances demander – taxe Tobin, déjà – qu’on fasse payer aux financiers les dégâts qu’ils avaient causés. Hier, c’était le Premier ministre suédois qui appelait à la fin de la « culture des bonus » et maintenant, dès demain peut-être, c’est la France qui pourrait se prononcer par la voix de son ministre des Affaires étrangères en faveur d’une taxation internationale de 0,005% – symbolique mais tout de même – des transactions financières. José Manuel Barroso vient en fait de sauter dans un train en partance et c’est ce train qui est important, pas sa campagne.
Rien ne se fera d’un coup. Les libéraux avaient mis quarante ans à imposer la déréglementation. Il avait fallu au monde vingt ans et une guerre pour tirer les leçons de 29. Le monde est un lourd paquebot dont les virages se négocient lentement mais, pas à pas et plutôt vite, l’Etat, la puissance publique, renaît de ses cendres, porté par l’évidence de sa nécessité.
|
Re: Géopolitique 17 septembre 2009, 12:15 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Jeudi 17 septembre 2009
Medvedev, 1er opposant à Poutine
Tout commence il y a une semaine, jeudi dernier. Ce jour-là, Dmitri Medvedev, le président russe, publie sur le journal en ligne Gazeta.ru une critique de l’état de son pays comme aucun opposant n’en a jamais faite. A le lire, l’économie y est « primitive », la démocratie « faible », le Caucase « instable ». La crise économique mondiale a montré, écrit-il, que « les choses ne vont franchement pas très bien » dans une Russie qui n’a pas réussi,à « se débarrasser d’une dépendance humiliante à l’égard des matières premières » et qui demeure « arriérée » et « corrompue ». « Cela prouve, conclue-t-il, que nous n’avons pas fait tout le nécessaire dans les années passées »
On ne saurait mieux dire. Tout cela est parfaitement juste. La Russie est bien celle que décrit, là, Dmitri Medvedev mais, à le lire, on en oublierait presque qu’il la préside depuis le printemps 2008 et que son prédécesseur, Vladimir Poutine, l’homme qui l’avait mis en place parce que la Constitution lui interdisait de briguer un troisième mandat consécutif, avait auparavant dirigé le pays pendant huit ans. Ce que Dmitri Medvedev dénonce dans cet article, c’est la politique menée par Vladimir Poutine, aujourd’hui devenu son Premier ministre, et la réponse ne se fait pas attendre.
Devant un parterre de spécialistes étrangers de la Russie, Vladimir Poutine assure dès le lendemain, vendredi, qu’il n’y aura pas de concurrence entre Medvedev et lui à la présidentielle de 2012 puisqu’il n’y en avait pas eu en 2008 et que nous nous mettrons d’accord car nous sommes, dit-il, du même sang et sur la même longueur d’onde ». En clair, Poutine décidera en 2012 comme il l’avait fait en 2008. Il est le patron et se présentera dans deux ans et demi mais, mardi, Dmitri Medvedev repart à l’assaut.
Venu répondre aux questions du même parterre de russologues, il commence par se démarquer de Vladimir Poutine sur l’Iran en expliquant que les sanctions sont, certes « peu efficaces » mais « parfois inévitables », dénonce à nouveau la corruption et lance : « Il y a encore peu, je n’envisageais pas de me présenter à une présidentielle mais tel est le destin. C’est pourquoi je n’anticipe rien pour moi-même mais n’exclus rien non plus ». Autrement dit, je n’aurais aucune raison de ne pas me représenter et le destin décidera.
On appellera cela les mystères de Moscou mais, plutôt que de céder aux délices surannés de la kremlinologie, tenons-nous en aux faits. Si Vladimir Poutine n’avait pas fait modifier la Constitution pour se représenter en 2008, c’est tout simplement qu’il ne détenait pas seul le pouvoir mais l’exerçait au nom d’un groupe dirigeant composé de plusieurs courants et qui ne voulait pas le laisser devenir président à vie. Après avoir cherché un successeur venu, comme lui, des forces de sécurité, il avait dû accepter le candidat des jeunes générations du groupe dirigeant, Dmitri Medvedev, qui plaident pour l’instauration rapide d’un Etat de droit. Il y avait eu bataille en 2008 et elle repart de plus belle, ouvrant avec deux et demi d’avance, la prochaine campagne présidentielle.
|
Re: Géopolitique 18 septembre 2009, 03:02 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Vendredi 18 septembre 2009
Vers un rapprochement americano-russe?
Cela avait été sa dernière décision d’importance. En août 2008, trois mois avant la victoire de Barack Obama, Georges Bush avait finalisé l’accord aux termes duquel les Etats-Unis allaient installer en Pologne et en République tchèque un système de défense anti-missiles qui devait être déployé en 2012. Officiellement, ce radar et ces intercepteurs étaient destinés à parer l’éventualité d’une attaque nucléaire iranienne mais le Kremlin avait vu, là, non sans raisons, la fin de l’équilibre stratégique entre l’Amérique et la Russie, un abaissement de la puissance russe qu’il n’était pas disposé à admettre et les relations entre les deux pays s’en étaient considérablement dégradées.
Ce système anti-missiles, Barack Obama l’a enterré hier. Pour la forme, il y a substitué des mesures, navales et terrestres, contre les missiles de courte et moyenne portée qui, elles, ne changeront rien à l’équilibre militaire entre Washington et Moscou. Son administration a fait valoir que de nouvelles évaluations des services de renseignement ne laissaient plus craindre que l’Iran puisse procéder à des tirs de longue portée dans un avenir prévisible. Peut-être. Sans doute. Probablement, mais le fait est que cette décision a été aussitôt saluée par le président russe, Dmitri Medvedev, comme « responsable » et prometteuse pour l’avenir de la coopération entre les deux pays.
Rien n’est acquis mais ce revirement des Etats-Unis pourrait ouvrir la voie à de nombreuses évolutions de la scène internationale. Il pourrait favoriser, d’abord, une plus grande connivence entre Washington et les grandes capitales européennes qui n’appréciaient pas plus ce projet que celui de faire entrer l’Ukraine et la Géorgie dans l’Otan car elles sont soucieuses de parvenir à définir avec Moscou les grandes lignes d’une coopération économique et stratégique entre l’Union européenne et la Russie.
Ce revirement américain pourrait achever, en deuxième lieu, de convaincre les pays d’Europe centrale que leur sécurité à long terme dépend moins des Etats-Unis que de l’Union européenne et les conduire ainsi à se rallier à l’idée d’une Europe politique, acteur de la scène internationale, dans laquelle ils avaient longtemps vue une simple ambition française de faire de l’Europe un rival de l’Amérique. Hier, Washington a profondément déçu Polonais et Tchèques et ce n’est pas forcément une mauvaise chose pour l’Union.
La décision de Barack Obama pourrait bien, en troisième lieu, renforcer les courants les plus occidentalistes et modernisateurs des cercles dirigeants russes, ceux qu’incarnent Dmitri Medvedev contre Vladimir Poutine. En quatrième lieu, cette décision que tout laissait prévoir depuis novembre devrait faciliter un rapprochement américano-russe sur deux dossiers brûlants, l’Iran avec lequel les grandes puissances tenteront d’ouvrir des négociations le 1er octobre prochain et l’Afghanistan où la Russie ne souhaite pas plus que les Etats-Unis une victoire des taliban. Beaucoup de choses pourraient avoir changé hier mais ce n’est encore qu’en pointillés.
|
Re: Géopolitique 21 septembre 2009, 10:53 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le dissensus international
Causes et conséquences, la chute du mur de Berlin était le thème, ce week-end, à Lyon, du dernier forum de Libération. Passionnés, passionnants, les débats ont été incroyablement riches mais, s’il faut n’en retenir qu’un, ce sera celui qui réunissait Adam Michnik et Pascal Bruckner sur cette idée de la « fin de l’histoire » qu’avait avancée, à l’été 1989, avant même que le Mur ne tombe, l’universitaire américain Francis Fukuyama.
Plus personne ne la défendrait aujourd’hui. A la seule lumière des guerres de Yougoslavie et du 11 septembre, à cette seule lumière-là, elle parait relever, vingt ans plus tard, d’un numéro comique mais Bruno Patino, directeur de France Culture et modérateur de ce débat, avait raison de rappeler que Fukuyama n’avait jamais parlé, d’une fin des conflits.
Il s’était seulement interrogé sur une fin des affrontements idéologiques et l’instauration d’un consensus international sur l’économie de marché et la démocratie occidentale, mais, même ramenée à ce double consensus, peut-on parler d’une fin de l’histoire à laquelle la fin du communisme aurait ouvert la voie ? Rien n’est moins sûr car, comme l’a rappelé Adam Michnik, ancienne tête pensante de l’opposition polonaise, la démocratie n’est pas plus devenue universelle qu’immortelle.
Elle est inexistante dans le plus peuplé des pays, la Chine, bientôt deuxième économie du monde. Elle n’est pas plus dominante en Afrique qu’en Asie. Elle est vite redevenue une moquerie en Russie, le plus étendu des pays du monde, où le poutinisme a inventé une oligarchie drapée dans un faux-semblant d’élections, sans véritable opposition ni liberté de la presse. Elle a subi de terribles coups jusque dans la plus puissante des démocraties, les Etats-Unis, où Georges Bush avait pu réinventer les oubliettes en s’asseyant sur l’habeas corpus, premier fondement des libertés publiques.
L’état de la démocratie devient inquiétant dans un pays fondateur de l’Union européenne, l’Italie, où un Premier ministre peut posséder les télévisions privées et contrôler les publiques, s’attaquer aux magistrats et aux journalistes et transformer la politique en show de série B. L’énorme puissance, enfin, que l’argent a prise depuis vingt ans menace la démocratie jusque dans les plus solides des démocraties en y relativisant le pouvoir des Etats, instruments de la volonté populaire partout où elle est librement exprimée. Chute du Mur ou pas, la démocratie reste une bataille, toujours incertaine.
Quant à l’économie de marché, oui, cela semble plus vrai. Plus personne ne lui oppose l’économie dirigée du modèle soviétique mais ce consensus n’est qu’apparent car comment la définir ? Est-elle la loi de la jungle, comme en Chine ? Le droit du plus fort ? Est-ce le modèle européen dans lequel la redistribution et la réglementation pèsent plus que partout ailleurs ? Est-ce le mi-chemin américain ? Depuis la faillite de Wall Street, le débat fait rage mais il montait, en fait, depuis la chute du Mur, depuis que l’économie de marché ne peut plus se définir par simple opposition à l’économie dirigée. Il n’y a pas de consensus post-communiste.
|
Re: Géopolitique 23 septembre 2009, 01:16 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les deux paradoxes allemands
Tout était dit. Après quatre ans de Grande coalition, de gouvernement commun entre la droite démocrate-chrétienne de la CSU et la gauche social-démocrate du SPD, l’Allemagne allait passer à droite. Depuis de longs mois, les sondages donnaient une si large avance à la CSU qu’on la voyait déjà gouverner, à coup sûr, avec les libéraux du FDP mais soudain, comme lors des deux précédentes législatives, la gauche frémit, à quatre jours du vote.
Ce n’est pas que les sociaux-démocrates soient en passe de gagner, loin de là. Ils ne se remettent pa des politiques d'austérité menés au début de la décennie. Mais ils remontent, un peu, un tout petit peu mais assez, pourtant, pour que l’ensemble des gauches, le SPD et Die Linke, la gauche de la gauche, se retrouve quasiment à égalité dans les intentions de vote, 47% contre 48%, avec l’ensemble des droites, démocrates-chrétiens et libéraux.
L’Allemagne est partagée, en deux blocs. Il n’est plus totalement exclu que les gauches arrivent, dimanche, devant les droites mais, même si c’était bien le cas, ce n’est pas une coalition de gauche qui prendrait les rênes. Premier paradoxe allemand, les sociaux-démocrates ne le voudraient pas car, autant ils n’ont plus d’objection de principe à des alliances régionales avec Die Linke, dans les länder, les Etats fédérés, autant ils se refusent à gouverner avec la gauche de la gauche, parti formé par des déçus du SPD, des syndicalistes et d’anciens communistes de l’ex-Allemagne de l’Est.
Entre ces deux partis, les différences sont trop grandes, sur le niveau de protection sociale et la politique étrangère notamment, pour qu’ils puissent se mettre d’accord sur un programme de gouvernement. Tous courants confondus, la gauche est forte en Allemagne. Les idées de gauche y sont si présentes que les syndicats recrutent à tour de bras dans la jeune génération, que Die Linke siège dans les Parlements de onze des seize länder et recueille 10% des intentions de vote. Sur le papier, la gauche pourrait être portée au pouvoir mais deux cultures la divisent, culture de gouvernement et culture de contestation. Si les droites ne l’emportent pas, le plus probable est que la coalition sortante, la Grande coalition CSU-SPD, soit reconduite.
On touche, là, au second paradoxe allemand. Officiellement, Angela Merkel souhaite se retrouver en famille, gouverner avec les libéraux, mais il y a, en fait, tout autant de différences entre les droites de la République fédérale qu’entre ses gauches. Parti démocrate-chrétien, la CSU a une forte dimension sociale dans ses gênes. Angela Merkel n’aime ni l’arrogance de l’argent, ni les paradis fiscaux, ni l’obscénité de certains salaires patronaux. Comme Nicolas Sarkozy, elle considère aussi que la régulation du marché est une nécessité politique car les opinions la réclament. Elle y pousse sur la scène internationale alors que le FDP est, lui, d’une parfaite orthodoxie libérale, moins d’impôts, moins d’Etat, pas de régulations. Angela Merkel est, au fond, beaucoup plus proche du SPD que des libéraux. Elle aurait beaucoup plus de mal à gouverner avec les seconds qu’avec le premier mais ce n’est pas elle qui décidera. Ce sera les électeurs.
|
Re: Géopolitique 26 septembre 2009, 13:50 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les vertus de l'hypocrisie
Tout le laisse penser mais ce n’est pas si simple. Lorsque le Conseil de sécurité dont les cinq membres permanents, ceux qui comptent vraiment, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la France et la Grande-Bretagne, sont tous des puissances nucléaires adopte à l’unanimité une résolution appelant à l’instauration d’un monde dénucléarisé, on ne peut que penser, irrésistiblement, que ce n’est pas à un club de fumeurs de cigares d’appeler à bannir le tabac. Summum de tartufferie, se dit-on. « Mais allez-y ! Commencez donc ! », avait on envie de leur crier hier mais il n’y avait pourtant pas là qu’hypocrisie.
Proposée par les Etats-Unis, cette résolution a directement été inspirée par leur président, Barack Obama, qui est venu la défendre en personne et qui pense, réellement, qu’il y a urgence à faire baisser les tensions internationales et que les négociations qui ouvriraient la voie à une réduction progressive des arsenaux nucléaires favoriseraient cet objectif. Non seulement l’ambition est noble, et nécessaire, mais les moyens choisis pour y parvenir sont éprouvés car, après tout, c’est ainsi que la Guerre froide s’était transformée en coexistence pacifique puis en détente.
Concrètement parlant, maintenant, Barack Obama poursuit, là, trois buts immédiats. Le premier est de marquer le sérieux et la détermination avec lesquels il envisage la reprise prochaine des négociations américano-russes visant à la réduction de leurs arsenaux atomiques. Il veut tout à la fois les inscrire dans une vision globale de réduction des tensions, y faire adhérer, par là même, la Russie et sceller, surtout, ce rapprochement diplomatique avec Moscou qu’il avait amorcé la semaine dernière en enterrant le projet de déploiement d’un bouclier anti-missiles en Europe centrale qui aurait infléchi l’équilibre stratégique hérité de la Guerre froide à l’avantage des Etats-Unis et au détriment de la Russie.
Il souhaite par là, deuxième but, s’assurer l’appui du Kremlin face à l’Iran, faire comprendre à la République islamique qu’elle ne pourra plus compter sur une division des grandes puissances. Cette préoccupation tactique de Barack Obama est parfaitement claire à la veille du rendez-vous du 1ier octobre avec les négociateurs iraniens mais, bien au-delà de l’instauration de ce rapport de forces diplomatique, Barack Obama vise également, troisième but, à une fonction d’exemplarité.
Etats-Unis en tête, les puissances nucléaires ne peuvent pas éternellement continuer à dire faites ce que je dis pas ce que je fais, et en même temps, moderniser et augmenter leurs capacités nucléaires et lutter efficacement contre la prolifération de l’arme atomique. Il y a un moment où cette bataille devra devenir universelle et l’on retrouve à nouveau, là, l’Iran, dans la mesure où la plus grave inquiétude suscitée par son programme nucléaire est qu’il risque vite d’amener l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Egypte et la Jordanie à se doter à leur tour de la bombe ce qui donnerait, compte tenu d’Israël, six pays nucléaires dans le Proche-Orient de tous les dangers. Hypocrisie si l’on veut, oui, mais il faut alors reconnaître quelque chose de vertueux à cette hypocrisie.
|
Re: Géopolitique 29 septembre 2009, 01:55 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les cinq questions iraniennes
Partisans, hier encore, d’explorer toutes les possibilités de dialogue avec Téhéran, les Etats-Unis brandissent désormais de nouvelles menaces de sanctions « dures ». Ces mêmes sanctions ont, à l’inverse, suscité des réserves de Bernard Kouchner, pourtant ministre des Affaires étrangères d’un président, Nicolas Sarkozy, qui pense et dit que le tentatives de négociations avec l’Iran ne feront que lui donner le temps de progresser vers la bombe.
En un mot comme en cent, et sans même parler des ambiguïtés russes, le dossier iranien sème plus que jamais la confusion dans les capitales occidentales mais c’est le contraire qui serait étonnant car tout, dans cette affaire, n’est que question sans réponse.
On ne sait pas, et les dirigeants iraniens ne le savent sans doute pas eux-mêmes, ce qu’est la réalité des rapports de force entre courants et sous-courants de ce régime. Tout bouge, sans cesse et très vite, à Téhéran non seulement parce que toutes les figures de cette théocratie, dirigeants en place et oppositionnels, craignent une explosion populaire qui mènerait à l’aventure et se gardent donc tous d’aller trop loin mais aussi, surtout, parce que la nature même du régime est en train d’évoluer. C’était une République mais sous étroit contrôle des instances religieuses, un double pouvoir dans lequel les religieux comptaient beaucoup plus que les élus sans que les élus ne comptent pour rien mais, depuis les manifestations qui avaient suivi les élections truquées de juin dernier, un troisième pouvoir paraît s’imposer aux deux premiers.
Bras armé du régime et bénéficiaires de grands monopoles économiques, les Gardiens de la révolution, ceux-là même qui viennent de tester les nouveaux missiles, semblent de plus en plus tirer les ficelles à l’ombre de Mahmoud Ahmadinejad dont ils ont largement organisé la réélection. Que veulent-ils, en dehors de affirmation de leur prééminence ?
Personne ne le sait vraiment et on ne sait pas non plus quel but poursuit ce régime, globalement parlant, avec son programme nucléaire. Veut-il vraiment se doter de la bombe pour devenir incontournable et assurer sa pérennité en flattant un orgueil national ? Ne veut-il qu’aller jusqu’au point où il pourrait s’en doter et négocier alors en position de force ? En admettant même que ce choix ait été déjà fait à Téhéran, ce n’est clair ni pour les Occidentaux, ni pour Israël, ni pour les pays arabes sunnites qui craignent comme la peste l’Iran chiite et perse. Et puis, enfin, il y a toute la question des moyens de pression sur Téhéran.
On ne sait pas, pas avec certitude en tout cas, si des sanctions dures, mettant vraiment à mal l’économie iranienne, seraient ou non applicables puisqu’il n’y a pas d’embargo incontournable. On ne sait pas si leur effet rallierait la population au régime ou l’en détournerait plus encore. On ne sait enfin pas si le très hypothétique bombardement des sites nucléaires iraniens précipiterait l’écroulement de la théocratie ou susciterait, au contraire, une union nationale dont elle bénéficierait alors. Jeudi, à Genève, les grandes puissances ont rendez-vous avec l’Iran mais, quand on ne sait rien ou presque, il est aussi difficile de savoir quoi dire que de savoir quoi faire.
|
Re: Géopolitique 30 septembre 2009, 02:14 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'automne des gauches
« Une Europe sans gauche », titrait, lundi, un grand quotidien d’Italie. « Le socialisme se meurt-il en Europe ? », se demandait le lendemain le New York Times et ces interrogations sont loin d’être infondées.
Le plus vieux des partis sociaux-démocrates européens, le SPD allemand, n’a pas seulement essuyé une cinglante défaite aux élections de dimanche. Il a aussi enregistré son plus bas score de tout l’après-guerre, 23% des voix, et paraît, aujourd’hui, en plein désarroi, hésitant entre un virage à gauche et un ancrage au centre. Au Portugal, qui votait ce même dimanche, les socialistes restent le premier parti du pays mais ont perdu leur majorité absolue et se retrouvent sur la défensive, comme le sont les socialistes espagnols et, surtout, les Travaillistes britanniques qui ne croient plus guère en leurs chances de gagner les législatives de 2010.
En Italie, la gauche ne parvient pas à reprendre pied, même contre un Silvio Berlusconi et, en France, on sait. Empêtré dans ses divisions internes, incapable de se doter d’un programme clair et de choisir ses alliés, le PS semble avoir amorcé un déclin que beaucoup de ses dirigeants n’hésitent pas à qualifier, en privé, de mort politique.
La première raison de ce recul des grands partis de gauche est leur triomphe historique. C’est eux qui ont inventé la protection sociale. Ce sont leurs batailles qui ont fini par faire de l’assurance maladie, des caisses de retraite, des indemnités de chômage et des conventions collectives ce qu’on appelle le « modèle européen ». La gauche a gagné mais si bien gagné que les électeurs ont largement oublié qu’ils lui doivent ce qui est devenu une norme, un bien commun de l’Europe dont les droites ne contestent plus le bien fondé, même quand elles veulent revoir cette norme à la baisse.
Le deuxième problème des gauches, apparu dès les années 70, est que cette protection sociale coûte cher. Elle a si bien alourdi les impôts et pèse tant sur les comptes des PME que toute une partie des classes moyennes a rompu avec les gauches en se révoltant contre les prélèvements obligatoires.
Troisième problème, depuis l’écroulement du bloc soviétique et la mondialisation économique, les gauches se trouvent confrontées à un pouvoir de l’argent qui ne craint si peu les révolutions et se rie tant des frontières – donc des Etats et de leurs gouvernements – que les gauches ne peuvent plus lui imposer grand-chose, même quand elles sont aux commandes. Dépossédée de ses droits de propriété sur une protection sociale qu’elle ne peut plus développer, la social-démocratie, quatrième problème, se retrouve ainsi concurrencée par des gauches de la gauche qui, partout, l’affaiblissent et, bien sûr, par des écologistes dont le combat paraît plus concret, plus consensuel, plus contemporain.
La gauche aurait, aujourd’hui, une nouvelle bataille à mener, refondatrice et incontournable, celle de la recréation d’une puissance publique à l’échelle continentale, d’un Etat européen capable d’en imposer à l’argent, mais cette bataille-là, elle ne parvient pas plus à la faire comprendre qu’à la mener.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.