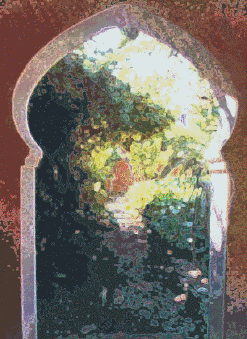|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 10 mars 2010, 13:37 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les travaillistes relèvent la tête
La cause était entendue. Avec, depuis deux ans, une avance de plus de dix points dans les sondages, les conservateurs britanniques devaient l’emporter aux prochaines élections qui auront lieu d’ici l’été, vraisemblablement début mai. Au pouvoir depuis 1997, les travaillistes en étaient eux-mêmes si convaincus que, tout récemment encore, ils annonçaient leur défaite comme un fait acquis à leurs camarades de la social-démocratie européenne mais, depuis un mois, patatras, tout change en Grande-Bretagne.
Depuis un mois, les uns après les autres, les sondages enregistrent une baisse constante des intentions de vote en faveur des conservateurs dont l’avance est repassée au-dessous de la barre des 10%. Ils n’auraient plus que cinq points d’avance sur les travaillistes, selon le Sun ; sept, selon le Daily Express ou même seulement deux selon le Mail on Sunday. Les instituts britanniques ont une longue histoire d’erreurs spectaculaires derrière eux mais la tendance est là et s’il y a un point sur lequel les sondeurs convergent, c’est la montée en puissance du troisième parti, les libéraux-démocrates, un Modem local qui pourrait recueillir quelques 16% des suffrages et empêcher ainsi l’une et l’autre des deux grandes formations de gouverner seule.
La gauche, en un mot, n’est toujours pas partie pour une reconduction, mais la victoire pourrait bien échapper à la droite, ce qui créerait une situation difficile, dont la Livre se ressent déjà, car la tradition britannique n’est pas du tout aux gouvernements de coalition.
Il est toujours risqué d’expliquer ce qui ne s’est pas déjà produit mais ce flottement – le mot est prudent – n’est pas vraiment surprenant. Un temps, les travaillistes semblaient condamnés à la fois par l’usure du pouvoir et les séquelles du soutien tellement actif que Tony Blair avait apporté à l’aventure irakienne. Entre le simple désir d’alternance et les déceptions de la gauche de la gauche, un boulevard s’était ouvert aux conservateurs, d’autant plus large qu’ils s’étaient trouvé un jeune chef de file, David Cameron, qui avait le triple avantage d’être un homme totalement neuf et pas un revenant de la préhistoire conservatrice, d’incarner le gendre parfait et de plaider, en même temps, pour plus de justice sociale et encore plus de libéralisme économique, idéologie dominante et incontestée en Grande-Bretagne depuis que les travaillistes s’y étaient convertis après les années Thatcher.
De surcroît bien né, cet homme semblait façonné pour la relève mais vint le krach de Wall Street, la mise en question des dogmes libéraux et la célérité avec laquelle Gordon Brown, successeur travailliste de Tony Blair, a su y réagir. Brûlant tout ce qu’il avait adoré, Gordon Brown a nationalisé des banques, largement inspiré l’interventionnisme régulateur auquel l’Union européenne a recouru durant l’hiver 2009 et s’est ainsi réimposé en homme d’expérience, pragmatique, revenu aux fondamentaux de la gauche et sur lequel son pays pouvait compter. D’un coup, David Cameron en a semblé léger, moins à la hauteur et plus gosse de riches. La donne a changé. On va voir…
|
Re: Géopolitique 12 mars 2010, 13:53 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Par David Ruzié, professeur émérite des universités, spécialiste de droit international
Le gouvernement français, notamment, n’a pas manqué l’occasion de faire valoir qu’Israël violait le droit international en décidant d’autoriser de nouvelles constructions, à Ramat Shlomo (v. le point de presse du porte-parole du Quai d’Orsay du 10 mars).
Or, n’en déplaise aux « légistes du roi », il n’existe aucune règle de droit international en la matière, car, depuis l’effondrement de l’Empire ottoman, la question de la redistribution des territoires, au Moyen Orient, est loin d’être pleinement réalisée et reconnue.
Vainement, mettra-t-on en avant l’avis consultatif émis par la Cour internationale de justice, en 2004, à propos de ce qui officiellement s’appelle l’affaire du « Mur » (mais qu’il serait plus objectif d’appeler l’affaire de la « barrière de sécurité).
Les juges de La Haye ont, en ignorant la lettre et l’esprit des accords d’armistice de 1949, considéré qu’il existait des frontières, au delà desquelles Israël n’avait pas le droit d’édifier cette construction, s’agissant du territoire palestinien.
Or, la « Ligne verte », adoptée, en 1949, ne constitue qu’une ligne de cessez-le-feu et la situation découlant de la Guerre de Six Jours n’est qu’une situation de fait (nous regrettons la formule ambiguë utilisée, par le président de l’Etat d’Israël, dans une interview accordée au correspondant du Monde à Jérusalem, dans le numéro daté du 10 mars, selon laquelle : « Les frontières de 1967 demeurent la référence de base).
Le « raisonnement » (sic) tenu par les juges internationaux est d’autant moins convaincant que, du même coup, ils se sont permis de contester le droit naturel de légitime défense d’Israël, au motif – arbitraire – que la menace ne venait pas de l’extérieur de la part d’un Etat étranger (comme si le droit international, qui doit s’adapter à l’évolution des rapports internationaux, pouvait ignorer le rôle d’acteurs non étatiques).
Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, de prime abord, cela ne signifie pas pour autant que la décision du gouvernement israélien (peu importe que, de fait, c’est le ministre de l’intérieur qui l’a annoncée) soit conforme au droit international.
Car, dans la société internationale, qui est loin d’être une société parfaite, tout ce qui n’est pas interdit, n’est pas nécessairement permis, cela, à la différence, en principe, de la situation dans le cadre d’une société étatique, dont le système juridique est régi par le législateur.
En effet, en l’absence de législateur à l’échelle mondiale, les règles de droit international, qui régissent la société internationale, s’élaborent progressivement au gré d’accords internationaux, de règles coutumières et de principes généraux de droit.
Certes, Il existe des règles bien précises, s’agissant de l’établissement des compétences, suivant qu’il s’agit (ou plutôt qu’il s’agissait) de « territoires non appropriés » (dits « sans maître » – pratiquement disparus, à l’exception des régions polaires) ou de « territoires déjà appropriés » (v. sur ce point D. Ruzié et G. Teboul, Droit international public, 21ème éd., Dalloz, 2010, p. 94 et s.).
Mais, la difficulté s’agissant des territoires faisant l’objet d’un contentieux entre Israël et le peuple palestinien (que celui-ci soit, « officiellement, » de création ou plutôt de revendication récente, n’occulte en rien son existence) provient de ce qu’ils ne relèvent d’aucune de ces deux catégories.
Mais, en attendant, le règlement de cette question, soit par voie d’accord entre les deux Parties, soit à la suite d’une décision d’une Organisation internationale, tenant compte du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (pour les Juifs comme pour les Arabes), il faut se garder de décisions abruptes unilatérales.
C’est la raison pour laquelle, fort opportunément – de notre point de vue – le gouvernement israélien avait décidé, à l’automne dernier, un « moratoire » de 10 mois dans les constructions en Cisjordanie (Jérusalem étant exclu, avec, pourtant, la difficulté majeure de délimiter les contours de la ville, eu égard au développement continu des constructions depuis 1967, comme en témoigne la controverse quant à la « localisation » de Ramat Shlomo….).
Ce «gel » des constructions, geste de bonne volonté, devait favoriser l’ouverture de négociations devant porter, essentiellement, dans un premier temps sur la délimitation des frontières de l’Etat d’Israël (qui depuis près de 62 ans d’existence ne dispose pas de frontières entièrement définies) et le futur Etat palestinien (dont l’existence est précisément conditionné par l’établissement de frontières le délimitant).
Et s’il n’y a qu’un seul point, sur lequel nous serons d’accord avec les critiques de la récente décision israélienne c’est sur son caractère inopportun, caractère reconnu d’ailleurs même par le ministre de la défense Ehoud Barak et la majeure partie de la presse israélienne.
|
Re: Géopolitique 12 mars 2010, 13:59 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le petit matin d'une nouvelle époque
C’est le dernier signe en date du changement de donne suscité par la crise financière. Dans une lettre adressée à la Commission européenne, le président français, la chancelière allemande et les Premiers ministres grec et luxembourgeois lui ont demandé, hier, d’ouvrir une « enquête » sur « l’impact des CDS sur les obligations des Etats européens ».
Ce n'est pas d'une totale limpidité, mais décryptons. Les « CDS », ce sont ces contrats d’assurance que les organismes financiers prennent aujourd’hui sur les prêts qu’ils font à des Etats ou de grandes entreprises. Les « obligations des Etats », ce sont les emprunts qu’ils font pour financer leurs déficits. Jusqu’au milieu des années 90, ces CDS n’existaient pratiquement pas mais non seulement ces contrats d’assurance sont maintenant devenus une quasi règle mais leur multiplication a fait naître un nouveau type de spéculation, particulièrement pernicieux.
Premier problème, le montant de ces primes dépend naturellement de l’estimation du risque pris. Moins les finances d’un Etat paraissent solides, plus les primes sont élevées et, plus les primes montent, plus la confiance dans l’Etat emprunteur décroît dans un cercle totalement vicieux car plus cette confiance recule, plus les primes des CDS augmentent, plus les taux auxquels les Etats empruntent s’envolent et plus ces Etats s’affaiblissent. C’est le cercle infernal dans lequel la Grèce est tombée suite au déséquilibre de ses comptes et, second problème, ces CDS sont eux-mêmes devenus un produit financier, un « produit dérivé » qui s’achète et se vend, dans des anticipations de hausse ou de baisse, dans ce jeu des espoirs de gain qui, comme à la Bourse, s’appelle la spéculation.
Ces contrats d’assurance qui pèsent tant sur les capacités d’emprunt des Etats pèsent ainsi doublement puisque leur valeur en est venue à beaucoup plus dépendre des anticipations des marchés que de la solvabilité de tel ou tel pays. Ce serait à peine forcer le trait que de dire que bien des Etats sont devenus, par là, de simples produits sur lesquels les investisseurs jouent, comme sur le cours d’une action ou les valeurs de l’or, du riz ou de tout autre matière première.
C’est contre cette dérive que Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Georges Papandréou et Jean-Claude Juncker, qui est aussi président de l’eurogroupe, de la zone euro, appellent l’Union à prendre des mesures d’encadrement dans ce qui est une déclaration de guerre aux marchés.
Européens en tête et France et Allemagne en tête des Européens, depuis l’automne 2008, les Etats sont bel et bien en guerre contre la dérive des marchés financiers et leur toute puissance non pas parce que Nicolas Sarkozy ou Angela Merkel, d’anciens libéraux convaincus, seraient devenus anticapitalistes – ce n’est pas du tout le cas – mais parce que les Etats sont maintenant menacés par la folie des marchés, comme on le voit avec les dangers de la crise grecque. Le krach de Wall Street a sonné l’alarme et, mois après mois, il change la donne qui s’était créée, depuis le milieu des années 70, avec le triomphe des idées libérales. Une nouvelle période s’est ouverte, encore incertaine puisqu’elle naît à peine et que son équilibre se cherche toujours dans les brumes d’un petit matin.
|
Re: Géopolitique 15 mars 2010, 12:17 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'ombre du vide en Egypte
Le dernier communiqué médical est rassurant. « La convalescence se poursuit normalement », a indiqué, samedi, l’hôpital allemand où le président égyptien avait subi, une semaine plus tôt, une ablation de la vésicule biliaire mais cette intervention chirurgicale n’en est pas moins devenue, au Proche-Orient, le sujet de toutes les interrogations.
Sans même parler des rumeurs que sa soudaineté a suscitées et que les démentis sur la présence d’une tumeur maligne ne tarissent pas, toutes les capitales de la région considèrent désormais que la succession d’Hosni Moubarak est virtuellement ouverte, que le plus prestigieux, le plus influent et le plus peuplé des pays arabes entre, autrement dit, dans une période d’incertitude qui pourrait mettre en question bien des équilibres.
Dépourvue de pétrole mais riche de ses 80 millions d’habitants, de ses traditions culturelles et du rôle historique qu’elle a joué dans la réaffirmation politique du monde arabe, l’Egypte n’est pas que l’un des principaux alliés des Etats-Unis. Elle est, également, un acteur essentiel des négociations israélo-palestiniennes depuis qu’elle est en paix – froide mais en paix – avec Israël et l’intermédiaire attitré, aussi, du Hamas et du Fatah qu’elle tente vainement de réconcilier depuis que les islamistes ont pris le contrôle de Gaza.
Dans le monde arabo-musulman, l’Egypte est, en un mot, le chef de file du camp dit « modéré », c’est-à-dire pro-occidental, et tout affaiblissement du pouvoir au Caire laisserait un vide que l’Arabie saoudite ne pourrait pas combler mais dont l’Iran et la Syrie pourraient profiter. De Jérusalem à Washington, du Golfe à l’Europe en passant par les sunnites et les chrétiens libanais, l’inquiétude est donc d’autant plus palpable qu’Hosni Moubarak n’a pas de successeur désigné.
Malgré les protestations des Etats-Unis, en vingt-neuf ans de présidence, il n’a pas laissé la moindre place à quelque forme d’opposition que ce soit. Il y a le président, son parti et l’armée dont il est issu. C’est tout et la seule vraie dissidence est constituée par les Frères musulmans, premier mouvement islamiste du monde arabe, à mille lieux d’al Qaëda, nullement terroriste mais très traditionaliste, hostile aux Occidentaux et solidement implanté dans la jeunesse, les milieux les plus défavorisés et plusieurs des grandes villes du pays.
Hosni Moubarak a 81 ans. Même s’il se remet complètement de cette opération, son règne touche à sa fin et l’heure de vérité sonnera, au plus tard, en septembre 2011, date de la prochaine présidentielle.
Soutenu par les milieux d’affaires, Gamal Moubarak, le fils du président, est généralement considéré comme le plus probable des héritiers mais l’instauration d’un système dynastique n’est pas évidente. Le tout puissant chef des services secrets, Omar Suleiman, incarnerait une continuité mais il n’aurait pas, dit-on, le soutien de l’armée et puis il y a un nouvel opposant, Mohamed el Baradei, ancien chef, égyptien, de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Il est l’espoir des démocrates laïcs mais tout le régime est, déjà, ligué contre lui.
|
Re: Géopolitique 17 mars 2010, 07:05 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Pas de tapis de roses pour les gauches
C’est requinquant, une victoire. Comme rajeunie et tout en muscles, la gauche française l’éprouve depuis dimanche. Sa résurrection conforte les espoirs de toute la gauche européenne qui n’a pas tort d’y voir une confirmation de l’essoufflement de Silvio Berlusconi, de la spectaculaire remontée des travaillistes dans les sondages ou, encore, des difficultés que ses alliés libéraux, trop à droite, trop thatchériens, créent à Angela Merkel.
Portée par la crise financière et la demande de règles et de protections qui s’ensuit, la gauche se sent d’autant plus le vent en poupe en Europe qu’elle y incarne l’alternance puisque l’écrasante majorité des gouvernements de l’Union sont, aujourd’hui, de droite. Tout menace, désormais, les majorités conservatrices mais ce n’est pas sur un tapis de roses que les gauches s’avancent.
Toutes n’auront pas autant de problèmes que la gauche grecque, revenue au pouvoir pour y découvrir des comptes maquillés et devoir imposer une austérité qui laisse pantois les plus orthodoxes des économistes. Toute l’Europe n’est pas la Grèce mais, partout ou presque, les plans de sauvetage de l’hiver 2008/2009 ont encore alourdi un endettement que les déficits budgétaires nourrissent depuis des décennies. Il n’y a pas d’argent en caisse. Les possibilités d’emprunt s’amenuisent. Le temps sera toujours moins aux largesses sociales que le taux de chômage et la baisse du pouvoir d’achat, pourtant, justifieraient pleinement et, pire encore, l’augmentation des impôts ne résoudrait rien.
Elle aggraverait, au contraire, les choses car elle viendrait mettre de nouveaux freins à une croissance déjà faible qu’il s’agit, plutôt, de relancer – mais comment ? – pour créer des emplois, rééquilibrer les comptes sociaux et accroître les recettes des Etats. Rien n’est simple dans ce moment qui va durer et, à peine aux portes du pouvoir, les gauches sont d’ores et déjà en danger de décevoir et d’ouvrir alors la voie à une extrême-droite qui ne s’affirme pas qu’en France.
C’est requinquant, une victoire mais, quant le contexte est aussi alarmant, il faut se préparer à en relever les défis.
Il y a des pistes.
La première consisterait, pour les gauches européennes, à s’entendre, sans attendre, sur une avancée de l’Europe politique qui seule permettrait de communautariser les dépenses, de recherche et de défense notamment, de les réduire autrement dit, et de réindustrialiser l’Europe en y lançant des politiques industrielles concertées, innovantes et créatrices d’emploi.
La deuxième serait d’ouvrir, à l’échelle européenne toujours, de grands travaux d’infrastructures, créateurs d’emplois aussi et finançables car rapidement rentables. La troisième serait de repenser et coordonner les politiques fiscales européennes afin de mieux imposer les bénéfices et traquer la fraude sans que l’argent ne puisse échapper à l’imposition en s’exilant sous de meilleurs cieux. Quant à la quatrième piste elle serait de réinventer la protection sociale en la mettant sous conditions de ressources, pleine et entière pour les plus démunis, plus restrictive pour les autres. Les chantiers sont gigantesques. Il ne faut pas tarder à s’y atteler.
|
Re: Géopolitique 17 mars 2010, 07:13 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Epreuve de force entre Israël et les Etats-Unis
Lorsqu’on commence à réaffirmer une évidence, c’est qu’elle n’est plus aussi évidente que cela. Israël est « un allié stratégique des Etats-Unis et le restera » a fait dire, hier, le Département d’Etat et ce rappel, parce qu’il était devenu nécessaire, donne la mesure de la crise qui ne cesse plus de s’amplifier entre les deux pays depuis l’affront fait, mardi dernier, au vice-président américain.
Ce jour-là, alors qu’il recevait Joe Biden venu donner une solennité au démarrage de pourparlers indirects avec les Palestiniens, Israël avait annoncé la construction de 1600 nouveaux logements à Jérusalem-est, la partie arabe de la ville dont les Etats-Unis ne reconnaissent pas l’annexion. C’était précisément le genre de geste dont les Américains avaient demandé aux Israéliens de s’abstenir. C’était une gifle donnée aux Etats-Unis qui, loin de se contenter de la « condamnation » aussitôt exprimée par leur vice-président, ne cachent plus leur colère.
Vendredi, c’est la secrétaire d’Etat elle-même, Hilary Clinton, grande amie d’Israël, qui a appelé Benjamin Netanyahu pour lui faire part de son « irritation ». C’est un « signal profondément négatif », lui a-t-elle lancé en lui disant « ne pas comprendre comment cela avait pu se produire » et en exigeant du gouvernement israélien qu’il « montre non seulement par des mots mais aussi par des faits son engagement envers sa relation avec les Etats-Unis et le processus de paix ». Dimanche, c’est l’un des plus proches collaborateurs de Barack Obama, son ancien directeur de campagne David Axelrod, qui a publiquement parlé d’une « insulte » faite aux Etats-Unis et l’ambassadeur israélien à Washington, entretemps convoqué au Département d’Etat, en est ressorti visiblement sonné.
« C’est la crise la plus grave depuis 1975 », depuis le moment, autrement dit, où les Etats-Unis avaient contraint Israël à un retrait partiel du Sinaï, a-t-il estimé dans un compte-rendu à ses collaborateurs qui faisait, hier, les gros titres de la presse israélienne.
En ne tournant pas la page, en faisant, au contraire, monter la pression, la Maison-Blanche tente d'amener contraindre le Premier ministre israélien à choisir entre une vraie dégradation de ses relations avec les Etats-Unis et un tournant vers de vraies négociations. Pour l’heure, Benjamin Netanyahu ne cède pas. Alors même qu’il avait été piégé, dans cette affaire, par ses alliés religieux et qu’il s’était, dans un premier temps, confondu en regrets, il a réaffirmé, hier, qu’Israël ne limiterait pas ses constructions à Jérusalem-est qu’il considère comme partie intégrante de sa capitale.
Le chef de file de la droite ne veut pas mettre en péril sa coalition avec l’extrême-droite car il ne veut pas devoir faire entrer les centristes de Kadima au gouvernement sous pression américaine et perdre ainsi la conduite des négociations avec les Palestiniens. C’est une épreuve de force qui affaiblit Benjamin Netanyahu, effraie la presse israélienne et dont l’issue est incertaine.
|
Re: Géopolitique 19 mars 2010, 07:01 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Boule de neige contestataire en Russie
Ce sont des signes, rien que de signes mais frappants et que relevaient, hier, les correspondant de l’Agence France Presse à Moscou. Il y avait, d’abord, eu ces manifestations de l’extrême Ouest russe pour protester contre les droits de douane soudainement imposés à l’importation de voitures japonaises d’occasion dont vit cette région.
On en avait parlé dans cette chronique car c’était la première fois, depuis la première élection de Vladimir Poutine, qu’un mouvement social organisé s’exprimait dans la rue, sans peur et massivement. Soutenus par la population locale, ces gens défendaient leur gagne-pain. Leurs revendications n’étaient pas politiques. Ils ne s’en prenaient pas au pouvoir en tant que tel, pas directement en tout cas, mais vint un deuxième signe du recul de la peur.
Invités à fêter l’anniversaire de Vladimir Poutine, entretemps devenu Premier ministre et non plus président, des écrivains connus refusent de s’y rendre, le font savoir et expliquent ce refus par leur réprobation de l’autoritarisme et de l’arbitraire ambiants. Là, quelque chose se passe, une rupture dans l’acceptation générale de ce pouvoir et, tout récemment, un chanteur rock, Iouri Chevtchouk, a créé l’événement en s’en prenant, lui, en plein concert, devant des milliers de fans, non seulement à la brutalité et la corruption de la milice mais aussi à « ce régime dur, cruel et inhumain ».
Peu après, c’était un acteur, Alexeï Devotchenko, qui appelait ses collègues à ne plus jouer dans les films « patriotiques » pour ne pas « soutenir, disait-il, ce régime cynique ». Longtemps inexistante, la contestation s’élargit sans cesse dans les milieux intellectuels et artistiques de Russie et, comme l’écrit le journaliste Andreï Lochak sur un site culturel, « les gens ont commencé à se défendre les uns les autres et protester devient presque à la mode ».
Le changement est tel que, cette semaine, l’édition russe de Newsweek, décrivait une « bulle de colère en train de gonfler » dans le pays et qui est particulièrement sensible sur Internet où elle s’exprime avec toujours plus de virulence, notamment contre la milice dont les exactions y sont dénoncées par des témoignages qui en suscitent d’autres dans un effet boule de neige.
S’il fallait donner une seule explication à cette fin de l’apathie russe ce serait l’émergence de Dmitri Medvedev, le jeune et nouveau président que Vladimir Poutine a mis en place parce qu’il ne pouvait pas briguer un troisième mandat consécutif. En dénonçant la corruption et le non-respect de la loi, en se faisant le chantre de l’état de droit, ce juriste a levé le couvercle de la contestation car il en donne lui-même l’exemple mais, s’il le fait, c’est que la société russe évolue et que la génération qu’il incarne aspire à la démocratie.
La Russie change, en profondeur, parce qu’il y a 25 ans cette semaine, Mikhaïl Gorbatchev l’avait remise en mouvement avec la Pérestroïka et que le désir d’ordre engendré par l’anarchie et les mafias des années Eltsine, cette sinistre décennie Poutine qui s’était ensuivie, n’ont pas empêché la société russe de se diversifier, la liberté d’y cheminer et de revenir maintenant à la surface.
|
Re: Géopolitique 19 mars 2010, 07:39 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les recompositions européennes
Il n’y a pas que l’économie qui soit sans frontières. La politique l’est aussi devenue et, pour régionales qu’elles soient, ces élections françaises l’illustrent bien. Non seulement les deux résurrections auxquelles elles ont donné lieu, celles de la gauche et de l’extrême droite, sont en cours dans toute l’Europe mais ces deux forces sont, partout, en recomposition.
Pour ce qui est de la gauche, on voit déjà à quel point la conjugaison de l’endettement des Etats, de la nécessité de réinventer la protection sociale et de l’apport des Verts modifie ses approches et ses propositions. Si l’on simplifie et, donc, exagère, la gauche, c’était toujours plus – plus de salaires, de protection et de redistribution par l’impôt. Même quand ce n’était pas ce qu’elle faisait, cela restait son ADN, ce qu’elle aurait voulu faire, alors que demain…
Ce sera « la justice et l’égalité », disait, avant-hier, François Hollande sur notre antenne, autrement dit moins de toujours plus et plus de lutte contre les privilèges, plus d’équité, en un mot, dans la répartition de l’effort, notamment fiscal, qui attend nos société. Ce sera, disent beaucoup, une priorité à donner à la jeunesse qui ne trouve pas d’emplois plutôt qu’aux salariés et aux retraités dont les revenus sont assurés, aussi mal qu’ils le soient. Nécessité oblige, la gauche ce sera, aussi, la recherche d’une croissance moins dommageable pour l’environnement – bref, une autre gauche, de ce siècle et non plus du précédant.
Quant à l’extrême-droite, l’évolution qui se dessine est, peut-être, plus profonde encore. Dans toutes les décennies d’après-guerre, elle puisait ses racines dans le fascisme des années trente, voire le nazisme. Elle n’était qu’une nostalgie de temps affreux qui, même lorsqu’elle progressait, la rendait infréquentable, ostracisé, inacceptable aux yeux mêmes de beaucoup de ses électeurs qui ne lui apportaient leurs voix que dans un vote protestataire qui n’aurait pas été le leur si elle avait eu la moindre chance de vraiment peser.
Et puis il y a eu la fin de la croissance d’après-guerre, la montée du chômage, la montée consécutive du rejet de l’immigration, la place de plus en plus grande prise par les décisions européennes et le sentiment que les scrutins nationaux avaient, en conséquence, de moins en moins d’importance. Non seulement les repères politiques se sont brouillés, non seulement le désir de retrouver des cadres compréhensibles s’est accru mais la peur de l’islam s’est ajoutée à cette peur de l’Europe dans un formidable désir de repli national.
Moins extrême, parfois très policée, une nouvelle droite de la droite s’affirme en Europe et ses laboratoires sont en Scandinavie et, surtout, aux Pays-Bas. Là-bas, elle défend non seulement les acquis sociaux nationaux face à la mondialisation économique et la nation face à l’Europe mais également les droits de la femme, et même des homosexuels, contre un islam réduit à ses fanatiques et diabolisé comme incarnation de tous les maux du siècle. Comme cela s'est déjà fait en Italie, en Autriche et au Danemark, cette nouvelle extrême droite se rapprochera de plus en plus des droites, comme les gauches se rapprochent des verts, et beaucoup de chose en changeront, petit à petit, sur les échiquiers politiques de l’Europe.
|
Re: Géopolitique 24 mars 2010, 08:00 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La victoire d'Obama
Les Républicains criaient au communisme. La gauche démocrate ne voulait pas entendre parler d’une loi qui n’aurait pas institué un système d’assurance public. La droite démocrate craignait de tomber sous l’accusation d’avoir contribué à un accroissement du rôle de l’Etat et d’être désavouée par les électeurs.
Sitôt après son élection, Barack Obama avait ainsi vu s’enliser dans les sables du Congrès son projet phare, la généralisation de la couverture médicale aux dizaines de millions d’Américains qui en sont dépourvus. Son autorité nationale et, par là même, internationale, en était atteinte mais il a maintenant gagné. Il a repris la main, fait adopter ce projet hier, en retrouvant des accents de campagnes, en plaidant passionnément cette nécessité morale devant l’opinion, en rompant avec ce désir de conciliation qui lui est propre et en allant lui-même au Congrès dire aux Représentants qu’ils étaient devant ce genre de moment où, loin de la routine des commissions et des votes de procédure, un élu retrouve la raison même _le bien public_, qui l’a poussé à entrer en politique.
« Je sais, avait-il dit samedi, ce qui se martèle dans les comptes-rendus de ce débat : Qu’est-ce que cela impliquera pour le Parti démocrate ? Quelles en seront les conséquences sur les sondages de popularité du président ? Comment cela jouera-t-il en novembre (aux élections de mi-mandat) ? Que se passera-t-il dans les circonscriptions incertaines ? » C’est effectivement à cela qu’était trop souvent réduit ce débat et Barack Obama, en plein Congrès, a rebattu les cartes en lançant : « Ne le faites pas pour moi. Ne le faites pas pour le parti démocrate. Faites le pour le peuple américain ». C’était sobre et percutant, un rappel à la noblesse de la politique et un appel à l’idéalisme assorti d’un démontage de tous les arguments utilisés pour bloquer une réforme dont les compagnies d’assurance et leurs lobbies ne voulaient pas et, là où avaient échoué tant de présidents américains, des deux Roosevelt à Bill Clinton en passant par Richard Nixon, Barack Obama a réussi.
Cela va changer la vie quotidienne de 32 millions d’Américains qui ne pourront plus se voir refuser une assurance et dont les primes vont baisser. Quatre-vingt-quinze pour cent des Américains auront, maintenan, une couverture médicale. Excusez du peu. C’est également une rupture culturelle dans un pays qui a toujours considéré que la solidarité relevait de la charité et que chacun devait rester responsable de lui-même quand bien même il n’avait pas les moyens de l’être. C’est un très grand et beau moment pour les Etats-Unis et la politique mais cela pourrait également changer beaucoup de choses pour la diplomatie américaine.
|
Re: Géopolitique 24 mars 2010, 08:10 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Bras de fer dans l'Union
L’Allemagne est seule, mais ferme sur ses positions. « Il ne s’agit pas de discuter d’une aide d’urgence à la Grèce » lors du Conseil européen de jeudi et vendredi, a déclaré hier Angela Merkel alors que la Commission européenne et pratiquement tous les autres pays de l’Union pensent, et disent, le contraire.
Pour José Manuel Barroso, « nous avons besoin d’une décision pour savoir comment gérer la Grèce sinon la grande incertitude actuelle risque de perdurer longtemps ». « Nous ne pouvons pas, ne devons pas abandonner nos amis grecs », a renchéri Bernard Kouchner en reconnaissant qu’il n’y avait pas, sur ce point, « d’accord complet avec nos amis allemands ». Même son de cloche à Madrid, à Rome, à Vienne et Jean-Claude Trichet, lui-même, le président de la Banque centrale européenne a abondé dans ce sens en déclarant, en français, en anglais et en allemand, que les Etats de la zone euro y étaient entrés pour « partager un destin de commun ».
L’Allemagne n’en veut pas, pas tout de suite et pas formellement au moins, mais le reste de l’Union souhaite que les 27 chefs d’Etat et de gouvernement entérinent, dans trois jours, à Bruxelles, le dispositif de soutien à la Grèce sur lequel les ministres des Finances de la zone euro s’étaient mis d’accord la semaine dernière. Il s’agirait de prêts bilatéraux d’un montant global de 22 milliards, non pas consentis par l’Union en tant que telle mais par les pays de la monnaie unique et accordés à des taux inférieurs à ceux auxquels la Grèce doit actuellement emprunter. Il ne s’agirait pas, autrement dit, d’un don mais d’un prêt, avec intérêts, permettant à la Grèce de passer cette mauvaise passe sans devoir céder aux conditions exorbitantes que lui imposent les marchés.
Ce serait l’expression d’une solidarité européenne, d’un front commun contre l’assaut lancé sur un pays membre, mais l’Allemagne s’y oppose, au risque non seulement d’affaiblir encore la Grèce mais également de s’isoler et de faire monter la tension dans l’Union.
La première raison de son refus est qu’Angela Merkel doit compter, à la fois, avec son opinion et les libéraux de sa coalition. Soumis, il y a dix ans, sous Gerhard Schröder, à une cure d’austérité qui leur a permis de relancer leurs exportations, les Allemands ne veulent pas entendre parler, aujourd’hui, d’aider des pays, fussent-ils européens, qui n’ont pas fait les mêmes sacrifices qu’eux. Un tiers des Allemands vont jusqu’à estimer que la Grèce devrait sortir de l’euro. A l’approche d’importantes élections régionales, l’affaire est délicate pour la chancelière, d’autant plus explosive que ses alliés libéraux flattent l’opinion allemande en se montrant intraitables mais, bien au-delà de cela, l’Allemagne a peur d’un engrenage.
Elle craint qu’il ne faille soutenir, après la Grèce, d’autres pays européens et que, de fil en aiguille, le fondement même de la monnaie unique _l’idée que chacun de ses pays était responsable de sa bonne santé financière_ ne soit mis en question. L’Allemagne n’a pas tort. C’est toute l’architecture de la zone euro qui est à revoir et ce n’est pas seulement à Berlin que cela donne le vertige.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.