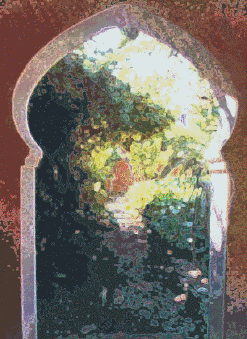|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 13 avril 2010, 23:59 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'alerte hongroise
En hongrois, jobbik signifie « le meilleur ». C’est le nom que s’est donné un parti d’extrême droite qui ne réunissait encore que 2,2% des voix aux législatives de 2006 mais qui vient de frôler les 17% à celles d’avant-hier. Talonnant la gauche, le Jobbik est devenu, dimanche, le troisième parti de Hongrie, pays membre de l’Union européenne, et cela n’a rien d’anecdotique car cette formation et la Garde hongroise qui parade dans ses meetings en uniformes noirs sentent à plein nez le fascisme des années trente ans qui fut dominant à Budapest sous le régime de l’amiral Horthy.
L’envol du Jobbik tient à celui du déficit budgétaire de la Hongrie. Pour y faire face, la majorité socialistes sortante avait du geler les salaires, supprimer le treizième mois des fonctionnaires et augmenter la TVA. Là-dessus le krach de Wall Street avait fait plonger le forint, la monnaie nationale. Beaucoup de Hongrois qui avaient emprunté en devises étrangères pour bénéficier d’intérêts moins élevés n’ont plus pu honorer leurs traites. La Hongrie a du faire appel au FMI, à la Banque mondiale et à l’Union qui lui ont prêté 20 milliards de dollars sous condition d’une rigueur accrue. Les comptes publics ont été largement rétablis mais le pays s’est senti mis sous tutelle, ruiné, et une haine y est montée, violente, aveugle, non seulement contre les multinationales qui avaient racheté des pans entiers de l’économie hongroise après la chute du communisme mais aussi contre les Juifs – « les Israéliens », dit-on dans une dernière pudeur – et contre les Roms, surtout, les Tsiganes, nombreux en Hongrie, marginalisés et le plus souvent sans travail.
Ce qui s’entend, aujourd’hui, à la base du Jobbik, contre les Roms, les Juifs et les étrangers fait blêmir mais ce n’est pas tout. A la fin de la Première guerre mondiale, le traité de Trianon avait considérablement réduit le territoire de la Hongrie au profit de pays voisins où vivent depuis d’importantes minorités hongroises. Cette plaie se rouvre. La grande Hongrie est l’un des premiers chevaux de bataille du Jobbik, son autre produit d’appel, et le plus inquiétant est que le Fidesz, le grand parti de droite qui a remporté ces législatives, colle dangereusement au Jobbik pour ne pas se laisser déborder.
Légitimisée par le Fidesz, portée par la profondeur et la persistance des difficultés sociales, cette extrême droite peut encore élargir son électorat et prendre un vrai poids sur la politique de ce pays et le pire est qu’on aurait tort de ne voir là qu’un phénomène hongrois. Aux dernières élections européennes, l’extrême droite avait remporté 17% des voix aux Pays-Bas, 16% dans les régions flamandes de la Belgique, près de 18% en Autriche, 15% au Danemark, 11% en Italie et elle avait dépassé les 5% dans six autres pays de l’Union. En progrès en France, elle pourrait arriver en tête des législatives néerlandaises de juin prochain car le rejet de l’autre monte et prospère en Europe, attisé par le chômage, la peur de l’islam et cette prééminence que le marché mondial et les institutions européennes ont prise sur les Etats nations. Ce n’est pas, déjà, l’alerte noire mais une tempête se lève.
|
Re: Géopolitique 14 avril 2010, 10:36 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La troisième victoire d'Obama
La Chine manquait à l’appel. Assoiffée de matières premières par sa croissance à deux chiffres, elle ne voulait pas compromettre ses relations avec l’Iran qui lui vend du pétrole. Tout sauf irréprochable en matière de droits de l’homme, elle ne voulait pas non plus créer un nouveau précédent de sanctions internationales qui aurait pu la gêner un jour. Rien ne l’incitait, de surcroît, à prêter la main aux Etats-Unis qui la pressaient de réévaluer sa monnaie et viennent de vendre des armes à Taïwan, l’autre Chine sur laquelle elle compte bien finir par remettre la main.
La Chine, en un mot, s’inquiétait des ambitions nucléaires de l’Iran mais pas au point d’aller voter au Conseil de sécurité – où elle dispose d’un droit de veto – de nouvelles sanctions contre ce pays vis-à-vis duquel elle continuait de prêcher patience et diplomatie. La Chine posait problème, un gros problème, à Barack Obama et puis, lundi, retournement de situation. Le président Hu Jintao est longuement reçu à la Maison-Blanche. Ses porte-paroles qualifient l’entretien de « positif et constructif » tandis que ceux de Barack Obama annoncent, exultant, que les Chinois « sont prêts à travailler » à l’élaboration d’une résolution du Conseil sur des sanctions contre Téhéran.
En quelques semaines, tout a changé parce que la Chine a bien du voir que les Etats-nis Unis Unis étaient autrement plus importants pour elle que l’Iran, qu’elle devait retrouver un équilibre dans ses relations avec Washington, que son émergence et son intransigeance commençaient à beaucoup préoccuper de par le monde et, notamment, que la sous-évaluation de sa monnaie était en train de liguer contre elle trop de pays qui ne supportent plus d’être inondés de produits chinois à bas prix ou concurrencés par eux. La Chine a compris qu’il y avait matière à un donnant-donnant et, pendant qu’elle s’assouplissait sur l’Iran, elle a obtenu de Barack Obama qu’il suspende une offensive contre son dumping monétaire en échange d’une promesse de réévaluation progressive.
Et puis enfin, la Chine ne voulait pas se retrouver isolée au Conseil de sécurité seule aux côtés de l’Iran, maintenant que Barack Obama a réussi son rapprochement avec la Russie. Si l’on résume, ce président américain que tant de gens avaient déjà enterré en décembre a réussi depuis, coup sur coup, à faire adopter sa réforme de la couverture médicale, à donner un nouveau départ aux relations américano-russes, à rouvrir le dialogue avec Pékin et à isoler l’Iran qui n’a plus de soutiens de poids.
Ni Moscou ni Pékin n’accepteront, pour autant, de voter une résolution imposant les sanctions « dures » que souhaiteraient l’Europe et l’Amérique. Le texte qui sera adopté par le Conseil restera certainement modéré mais là n’est pas l’essentiel. Outre que l’Union européenne et les Etats-Unis pourront alors y ajouter leurs propres sanctions, l’Iran se retrouve désormais dans le collimateur de l’ensemble des grandes puissances qui durciraient toutes le ton s’il faisait un pas de plus vers la bombe. L’intérêt de l’Iran serait, aujourd’hui, de chercher, et trouver, un compromis.
|
Re: Géopolitique 14 avril 2010, 11:22 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
|
Re: Géopolitique 15 avril 2010, 14:27 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les mollahs face à leur choix
Il faut toujours penser, en politique, aux coups d’après. Les discussions sur de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran ont repris, hier, entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Maintenant que la Chine s’est ralliée, lundi, au principe de ces sanctions, elles devraient entrer en vigueur après quelques semaines ou mois, peut-être, de marchandage sur leur ampleur mais, cette étape franchie, que se passera-t-il ?
Le plus probable est que l’Union européenne, les Etats-Unis, plusieurs autres pays sans doute aussi, ajouteront leurs propres sanctions, plus dures, à celles qu’aura décrétées l’Onu. Ce sera la deuxième étape, un bras de fer économico-politique qui constituera un rude défi pour le régime iranien.
Ce n’est pas qu’il devra automatiquement céder. Les sanctions se contournent. Il suffit pour cela de tout payer plus cher et l’on trouve toujours des entreprises ou des Etats prêts à prendre des risques pour engranger des bénéfices sans pareils ou obtenir des contreparties politiques. Le régime iranien ne sera pas immédiatement étranglé par ce cumul de sanctions mais lorsqu’on doit déjà faire face à une inflation flirtant avec les 20%, à un lourd déficit budgétaire, à une crise politique majeure et à un mécontentement social croissant, il n’est pas facile d’encaisser, en plus, des restrictions sur ses activités commerciales et financières, sa circulation maritime et ses ventes de pétrole, surtout, qui pourraient baisser d’un tiers, faute d’acheteurs, alors que ce pays en tire l’essentiel de ses ressources.
Ces sanctions pèseront lourd et peuvent donc avoir deux conséquences possibles. Premier scénario, le régime iranien se convainc que la partie n’est plus jouable. Il amorce des gestes d’ouverture et une négociation s’engage, au terme de laquelle la République islamique renoncerait à l’arme nucléaire en échange de sa complète réintégration dans l’économie mondiale, de garanties de sécurité et d’une reconnaissance par les Etats-Unis et l’ensemble des grandes puissances de sa place et de son rôle de première puissance régionale.
Ce serait l’intérêt de l’Iran qui aurait tout à y gagner. C’est un scénario qu’on ne peut pas exclure et que les puissances émergentes voudraient favoriser, aussitôt que possible, avec l’aide de la Turquie. Elles vont s’y employer dès aujourd’hui avec l’espoir de faire comprendre au régime iranien que, plus tôt il se montrerait prêt au compromis, mieux se serait pour tout le monde et pour lui-même. Ce serait effectivement l’issue heureuse pour tous même si elle demandait du temps mais on ne peut pas exclure que ce régime craigne de se condamner en s’ouvrant au monde extérieur et qu’il choisisse plutôt de faire monter les enchères, en Irak, en Afghanistan et au Liban, dans l’espoir de faire reculer les Etats-Unis.
Il dispose d’assez de relais régionaux pour tenter de le faire mais il jouerait, là, avec le feu car il risquerait alors de se heurter à un vrai front, non seulement de l’Europe et des Etats-Unis mais également de la Chine et de la Russie dont Barack Obama, l’Iran en tête, s’est beaucoup rapproché. La partie ne fait que commencer mais la donne n’est pas favorable à Téhéran.
|
Re: Géopolitique 16 avril 2010, 00:43 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 11 161 |
|
Re: Géopolitique 22 avril 2010, 00:24 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'embellie polono-russe
Ce volcan islandais n'aura pas fait que souligner la fragilité de nos sociétés. En entrant en éruption et paralysant le moyen de transport,- la circulation aérienne,- dont le monde est devenu si dépendant, il nous a rappelé qu'un grain de sable, une particule, pouvait enrayer l'extrême sophistication de la modernité mais il a également eu le plus inattendu des effets politiques.
L'un après l'autre, les grands de ce monde ont renoncé à leur présence aux obsèques du président polonais et, mystère des vents et calcul diplomatique aidant, le seul à ne pas avoir déclaré forfait aura été Dmitri Medvedev, le président russe. Etats-Unis et Europe, cet Occident vers lequel la Pologne regardait depuis si longtemps aura été absent tandis que l'Orient dont elle a tant souffert, la Russie, était, lui, présent à ses côtés dans son deuil.
Cela ne suffira bien sûr pas à effacer l'histoire. En Pologne, le malheur est russe. Il l'a été au 19ième lorsque la Pologne, rayée de la carte et partagée entre les empires européens, a vécu l'oppression tsariste dans sa chair. Il n'a pas cessé de l'être au 20ième lorsque l'URSS y a porté la guerre en 1920 avant de se repartager ce pays avec l'Allemagne nazie, d'en exterminer l'élite, en 1940, dans des massacres auxquels celui de Katyn avait donné son nom, de laisser écraser par les nazis l'insurrection de Varsovie alors que l'Armée rouge aurait pu intervenir puis d'imposer aux Polonais, par la force, quatre décennies d'un régime communiste dont la chute avait annoncé l'implosion soviétique.
Entre ces deux pays le contentieux est immense mais tout vient de bouger car, avant même que Dmitri Medvedev ne fasse ce geste qui a tant frappé les Polonais, la Pologne s'était sentie lâchée par l'Amérique lorsque Barack Obama avait entrepris de se rapprocher de la Russie pour contrer les ambitions nucléaires de l'Iran. Sitôt élu, il avait abandonné toute velléité de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'Otan et renoncé au déploiement d'un système antimissile en Pologne et en République tchèque.
Ces décisions avaient signifié, pour les Polonais, que la Russie qu'ils continuaient à tant craindre ne serait pas encerclée jusqu'à ses frontières par l'Alliance atlantique. Ils s'étaient alors dit, en septembre dernier, que la Raison d'Etat leur commandait de trouver un modus vivendi avec la Russie qui avait, de son côté, immédiatement compris qu'une occasion s'offrait à elle de se réconcilier avec un pays dont le poids est toujours plus grand dans l'Union européenne et l'Otan.
Vladimir Poutine a invité le Premier ministre polonais à venir commémorer, à Katyn, le massacre de 1940. Trois jours plus tard, l'avion de Lech Kaczynski s'écrasait au dessus de cette forêt et la Russie a su montrer, là, une telle solidarité avec la Pologne que l'archevêque de Cracovie, déclarait dans son homélie d'hier que « les témoignages de bonté de nos frères russes ravivent l'espoir d'un rapprochement et d'une réconciliation de nos deux nation slaves ». Oui, l'ancien secrétaire personnel de Jean-Paul II dit "nos deux nations slaves". Les plaies ne se sont pas, déjà, refermées mais, par les plus étranges des détours, l'Islande et l'Iran viennent de changer beaucoup de choses au cour de l'Europe.
|
Re: Géopolitique 22 avril 2010, 06:58 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le lib-dem et ces deux-là
Un sondage vient même de le placer en tête des intentions de vote. Tous le mettent au coude à coude avec le chef de file de l’opposition conservatrice, David Cameron, et le Premier ministre travailliste sortant, Gordon Brown. Il fait la « une » de tous les journaux d’Outre Manche qui n’en finissent plus de gloser sur ses chances, son avenir et la révolution que son envol pourrait introduire dans la politique britannique.
Nick Clegg – c’est son nom – est, en un mot, devenu la personnalité centrale de la campagne pour les élections du 6 mai depuis que ce jeune dirigeant des Libéraux-Démocrates, les « lib-dems », le centre gauche, a rebattu les cartes en s’imposant, jeudi, au cours du premier des trois débats télévisés opposant les candidats des trois partis. Prenant de court tout le pays, partis, journaux et électeurs, le petit qui montait est, d’un coup, devenu celui qui éclipse les deux poids lourds pour deux raisons.
La première est qu’aucun des deux grands partis n’étant assuré d’obtenir une majorité suffisante pour gouverner seul, Gordon Brown et David Cameron ont l’un et l’autre ménagé ce troisième homme dont ils pouvaient avoir à rechercher le soutien au soir du vote. Le conservateur et le travailliste ne cessaient de s’écharper que pour sourire à Nick Clegg. Sept fois de suite, Gordon Brown a prononcé ce qui est devenu la formule emblématique de ce débat : « Je suis d’accord avec Nick » qui s’est ainsi fait introniser par des rivaux qui ne réalisaient visiblement pas qu’ils se tiraient, là, dans le pied.
La deuxième raison du succès de « Nick » est que beaucoup d’électeurs n’ont pas plus envie de reconduire les Travaillistes au pouvoir depuis 1997 que de confier leur pays à une jeune conservateur sans expérience politique, un peu trop bien né et longtemps trop sûr d’une victoire annoncée.
Ils veulent un changement, c’est sûr, mais la crise financière leur fait d’autant plus souhaiter la continuité que Gordon Brown a un savoir-faire que personne ne lui conteste et qu’il a su rappeler depuis le krach de Wall Street. Dans ces temps d’hésitation, de lassitude et de dégout provoqué par les révélations sur la manière dont tant d’élus conservateurs et travaillistes abusaient de leurs notes de frais, Nick Clegg était le vent frais et il a joué cette carte à fond, ne désignant les « front runners », les favoris, que par deux mots d’un souverain mépris : « those two », ces deux là.
Il reste deux débats télévisés, une complète nouveauté en Grande-Bretagne. Nick Clegg va maintenant se faire attaquer par la gauche et la droite. L’incertitude est grande mais il n’est plus du tout impossible qu’il arrive en deuxième position, en situation de monnayer son soutien contre un changement du mode de scrutin qui ébranlerait le duopole des conservateurs et des travaillistes.
Ce serait une révolution et, dans l’éventualité ou ses amis et lui entreraient au gouvernement, plus vraisemblablement avec la gauche qu’avec la droite, de vrais partisans de la construction européenne se trouveraient alors aux affaires à Londres, à des postes clé. Ce serait la seconde révolution.
|
Re: Géopolitique 22 avril 2010, 10:35 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Désunion céleste
Là, ce n’est que logique. Logiquement, eurosceptiques et europhiles devraient s’accorder à considérer que le ciel européen ne peut pas rester découpé en 27 cieux nationaux, qu’il doit être unique, comme le marché et la monnaie le sont, et régi par une seule et même autorité européenne.
Logiquement, ce devrait être fait depuis longtemps mais un nuage venu d’Islande vient de rappeler que l’Union européenne restait une désunion céleste, composée de 27 espaces aériens, ouverts ou fermés par 27 Etats, sans parler de leurs différentes autorités.
Résultat, il a fallu quatre jours pour organiser, hier, par vidéoconférence, une concertation des 27 ministres des transports et cette Union européenne qui a un Parlement, un président, une Commission, tant de traités et d’institutions communes, n’a pas été plus à même de diriger les passagers en rade vers les aéroports qui avaient pu rester ouverts que d’organiser des transports de substitution et de dégager, surtout, entre des vents qui inquiétaient à juste titre, des couloirs européens qui auraient permis de désengorger les aéroports nationaux et de rapprocher ces naufragés de l’air de leur destination finale.
Béante, cette faille est une leçon de choses sur la construction européenne. Après guerre, ce processus avait été entrepris à la fois pour faire face à l’URSS et enterrer les conflits entre les nations du continent en les liant par des objectifs et des intérêts communs. On l’a poursuivi, après la Guerre froide, pour affirmer l’Europe, ses valeurs, sa culture et son économie, dans un monde dont les rapports de force s’articulent toujours plus entre des puissances de taille continentale. La mondialisation du marché et l’internationalisation des défis, technologiques, environnementaux et économiques, commandent de ne pas reculer parce que seule une puissance publique de taille continentale peut faire poids face à un marché mondialisé et que les Etats nations n’ont pas la taille suffisante pour répondre, en ordre dispersé, aux questions de l’heure.
On le voit bien dans cette crise qui n’est pourtant pas la plus redoutable du siècle, mais abandonner le contrôle de son espace aérien, fût-ce volontairement et au profit d’une autorité commune, c’est abandonner le contrôle de sa sécurité, prérogative nationale s’il en est.
Un projet de ciel unique existe, mais toujours dans les tiroirs parce que les Etats membres n’étaient pas pressés de franchir ce pas et qu’il y faudra l’unanimité des 27, donc, de longs marchandages dont la seule perspective a freiné les enthousiasmes.
Nul doute que les choses bougeront maintenant mais si l’on ne veut pas que l’Union reste incompréhensible, tantôt faite, tantôt inexistante, trop pesante ici, totalement absente ailleurs, un machin dont les citoyens se détournent toujours plus car personne ne peut plus s’y retrouver, il faudra bien finir par y mettre une logique. Il faudra bien finir par admettre que l’unification de l’Europe ne peut progresser que si ses citoyens et ses gouvernements admettent que son but ultime est la naissance d’une Europe fédérale, d’Etats-Unis d’Europe dont le gouvernement serait aussi unique que le ciel devrait l’être.
|
Re: Géopolitique 24 avril 2010, 15:54 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Détente au coeur de l'Europe
Les choses bougent, décidément, en Europe centrale. Après le dégel polono-russe, c’est maintenant l’Ukraine et la Russie qui se rapprochent, refermant près de dix années de crise.
Aux termes d’un accord signé, hier, par leurs présidents, l’Ukraine a accepté de prolonger de 25 ans les facilités qu’elle accorde à la flotte militaire russe dans son port de Sébastopol et la Russie lui a garanti, en échange, un tarif préférentiel, et très avantageux, sur ses livraisons de gaz. Chacun y gagne. C’est un bon compromis pour les deux pays mais également une bonne nouvelle pour tout le continent européen qui voit se dissiper, là, deux dangers pour sa stabilité économique et politique.
L’Union européenne, d’abord, importe près du quart de sa consommation de gaz de Russie. Ce gaz transite, pour l’essentiel, par l’Ukraine et l’Union avait souffert, l’an dernier, de la bataille sur le prix du gaz russe livré à Kiev car, en coupant ses livraisons aux Ukrainiens, la Russie avait, par là même, ralenti jusqu’à la rupture ses livraisons aux 27. Une incertitude continuait de planer sur les approvisionnements russes de l’Union et elle est maintenant levée puisque les prix payés par l’Ukraine sont désormais garantis à long terme.
Quant à l’affaire de Sébastopol, elle était encore plus préoccupante car ce port est situé sur la péninsule de Crimée, région historiquement russe mais cédée à l’Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, à une époque où ces modifications de frontières entre deux Républiques soviétiques membres de la même Union – l’URSS – n’étaient que symboliques. La Crimée est peuplée de Russes et de russophones. Elle se sent russe et, si l’Ukraine avait voulu en faire partir la marine russe en 2017, à l’expiration du bail dont elle y bénéficie, la Crimée aurait sans nul doute fait sécession avec le soutien de Moscou et créé, au cœur du continent, une situation difficilement maîtrisable.
Beaucoup le diront, mais non. Tout cela signifie que l’Ukraine et la Russie retrouvent des relations qui ne peuvent être qu’étroites parce que leurs économies sont complémentaires, que le berceau de la Russie est l’Ukraine, qu’une moitié de la population ukrainienne est russophone et que les mariages mixtes sont si nombreux et depuis si longtemps qu’une multitude de Russes sont Ukrainiens, comme l’était Khrouchtchev, et l’inverse. Ces deux pays ne pouvaient pas rompre leurs liens sans de graves et inutiles conflits mais c’est à l’Union européenne que le nouveau président ukrainien, Viktor Ianoukovitch, avait réservé sa première visite après son élection de février dernier.
L’Ukraine négocie un accord d’association avec l’Union. Elle peut devenir une plaque tournante, un pont, entre l’Union européenne et la Fédération de Russie qui, parallèlement, cherchent à définir entre elles un équilibre continental sous la triple égide du président russe, Dmitri Medvedev, de Nicolas Sarkozy et d’Angela Merkel. Ce rapprochement avait été longtemps freiné par la Pologne mais, maintenant qu’elle se rapproche elle-même de Moscou, ce ne devrait plus être le cas.
|
Re: Géopolitique 26 avril 2010, 12:12 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'éclatement belge
Cela ne se passe pas en Afrique, continent aux frontières contestables et contestées. Cela ne se passe non plus dans les Balkans où l’éclatement de la Yougoslavie et l’inextricable mélange des peuples et des religions avaient provoqué, dans la dernière décennie du siècle passé, une guerre de partage d’un territoire autrefois commun.
Cela se passe, hier, en Belgique, au cœur de l’Europe, dans un pays dont la capitale est également celle de l’Union européenne, qu'il préside qui plus est au second semestre. Le gouvernement vient de tomber. Il a chuté sur une affaire de droits linguistiques dans la banlieue de Bruxelles parce que cette ville francophone est située dans la partie flamande du Royaume, que ses habitants débordent sur sa périphérie et que la population flamande leur refuse l’usage de leur langue dans la vie administrative car elle craint d’être débordée par les francophones dans ses municipalités, de ne plus s’y sentir chez elle.
C’est une affaire de rien, un conflit local mais ce qui se joue dans ce bras-de-fer, c’est tout le rapport de force entre Flamands et Wallons, une bataille politique entre pauvres devenus riches et riches devenus pauvres. Tout un temps, la richesse belge avait été wallonne car c’était en Wallonie que s’était développée l’industrie nationale, liée aux mines et à la sidérurgie. C’est là qu’étaient la bourgeoisie, les intellectuels, les gens cultivés et distingués qui n’avaient que mépris pour ces paysans flamands supposés parler un mauvais patois néerlandais mais le déclin a frappé le charbon et l’acier. La Wallonie s’est appauvrie pendant que les Flandres s’enrichissaient dans le tertiaire et désormais, mélange de revanche sociale et d’égoïsme régional, les Flamands ne veulent plus que leurs impôts financent la Wallonie, exactement comme l’Italie du Nord ne veut plus financer celle du Sud.
Entre ces deux parties d’un royaume devenu fédéral et coupé, d’Est en Ouest, par une frontière linguistique constituant un véritable mur, l’opposition est totale. Elle est, heureusement, non violente mais si passionnelle et exacerbée que, lorsque le gouvernement est tombé, des élus de l’extrême droite flamande ont entonné l’hymne indépendantiste de la Flandre en plein Parlement tandis que des militants de leur parti faisaient tomber une banderole d’un balcon intérieur sur laquelle on lisait : « C’est le moment de l’indépendance ». A l’extérieur, un petit groupe de jeunes nationalistes flamands scandaient la même chose mais en plus cru. « Que la Belgique crève ! », disaient-ils et l’éclatement de ce pays n’est plus, à terme, une hypothèse à écarter.
Ce n’est bien sûr pas inéluctable mais l’antagonisme entre les deux populations ne cesse de s’approfondir et les indépendantistes flamands frôlent les 40% de soutien dans les sondages. Dans une crise devenue permanente, quelque chose se brise dans ce pays qui a une histoire de résistance aux autres depuis la conquête des Gaules par César mais qui n’en est pas moins une création des puissances européennes qui ne remonte qu’à 1831. Ce royaume peut éclater, comme la Tchécoslovaquie, après tout, l’avait fait en 1992, il y a dix-huit ans seulement.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.