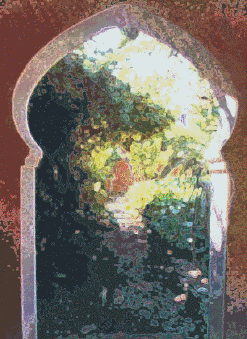|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 04 mai 2010, 00:52 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Mardi 23 mars, en marge du congrès de l'AIPAC, l'American Israel Public Affairs Committee, où il prendra la parole, Netanyahu sera reçu par le président Obama. Cette rencontre, la quatrième depuis l'arrivée au pouvoir de ces deux dirigeants depuis un peu plus d'un an, était encore incertaine la semaine dernière. Elle se déroulera suite à la plus grave crise qu'aient connue les relations entre les deux pays depuis de nombreuses années, aux dires mêmes de Michael Oren, l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis.
Les engagements par écrit pris par Netanyahu, suite aux demandes américaines, ont permis qu'il soit invité par Obama à la Maison Blanche. Bien qu'aucune information à ce sujet n'ait été rendue publique, selon des sources israéliennes et américaines, il semble en effet que le Premier Ministre israélien se soit engagé à assouplir les conditions du siège de Gaza, à lever une partie des centaines de barrages et check points qui parsèment la Cisjordanie, à libérer des prisonniers proches du Fatah et à aborder dans le cadre des négociations indirectes, qui devraient commencer sous l'égide des Américains après les fêtes de pâques, toutes les questions centrales du conflit comme celles des frontières, des colonies, de Jérusalem, de la sécurité, des réfugiés et de l'eau, au lieu de se concentrer sur la procédure de négociation, comme il le voulait préalablement.
Par contre Netanyahu ne s'est pas engagé à arrêter les constructions à Jérusalem qui, de son point de vue, ne sont pas différentes de celles de Tel Aviv. Il s'est seulement engagé à mieux contrôler ces projets et à les limiter, pour ne plus embarrasser les Américains, comme cela s'est passé récemment avec l'annonce de la construction de 1600 appartements dans le quartier de Ramat Shlomo alors que le vice président américain Joe Biden était présent en Israël. Si les négociations israélo-palestiniennes reprennent réellement sur cette base, on pourra dire que la crise qui vient de se dérouler, aura été bénéfique.
Pour juger de la méthode de gouvernement de ces deux dirigeants, je voudrais comparer deux décisions prises par leurs gouvernements respectifs et qui ont fait par hasard la une de l'actualité le même jour hier.
Dimanche soir, la Chambre des Représentants votait, à 219 voix pour et 216 contre, la réforme de la couverture santé, donnant un accès aux soins à plus de 32 millions d'Américains qui en étaient exclus jusqu'à présent, réforme souhaitée depuis des décennies par les démocrates et qu'aucun président avant Obama n'avait réussi à faire voter jusqu'alors. Malgré les récents revers dans des élections partielles, retirant au parti démocrate la majorité des 60 % au Sénat, Obama n'a pas renoncé à batailler même dans son camp pour faire passer cette loi, et cela malgré des sondages impopulaires et la campagne démagogique que les républicains assistés des nombreux lobbies financiers ont menée contre lui. Il a maintenu son cap et son succès lui permet aujourd'hui d'aborder renforcé les prochaines échéances.
Le même jour le gouvernement israélien votait une proposition du vice ministre de la santé, le rabbin Yaakov Litzman, s'opposant au déplacement de tombes anciennes au nom de la loi juive imposant le respect des morts. Ces tombes, probablement de non-juifs, ont été découvertes sur le site prévu pour la construction d'une salle pour les urgences de l'hôpital Barzilaï d'Ashkelon. Cette décision a fait la une des journaux télévisés hier soir en Israël, les journalistes allant jusqu'à dénoncer l'incapacité de Netanyahu à s'opposer à quelques rabbins ultra-orthodoxes, qui imposent un délai supplémentaire d'un an pour construire cette salle dont l'hôpital d'Ashkelon, desservant plus de 500 000 personnes, a un besoin d'autant plus pressant à cause de la situation sécuritaire existante dans le Sud du pays. Le coût de cette décision de déplacer de quelques centaines de mètres la future salle des urgences, qui ne se trouvera plus en conséquence à proximité de l'hôpital, est évalué à 135 millions de shekels (27 millions d'euros) qui seront pris sur un budget du ministère de la santé, déjà fortement sollicité par ailleurs. Nétanyahu s'est donc soumis au chantage des ultra-orthodoxes qui avaient menacé de démissionner du gouvernement en cas de décision contraire. Une fois de plus une minorité d'obscurantistes imposent leur loi à la majorité laïque du pays. Même parmi les religieux, beaucoup de voix se sont élevées contre cette décision.
Deux méthodes de gouvernement donc : Celle d'une part d'un président américain, ne baissant pas les bras, prêt à passer des compromis pour faire voter une loi historique, même à l'encontre d'une partie de son propre électorat. Rappelons que la loi des droits civiques, qui a supprimé la situation d'apartheid que subissaient les noirs dans les états du Sud dans les années soixante, ne fut également pas populaire en son temps.
Et celle d'un Premier Ministre israélien, prêt à toutes les compromissions pour conserver sa majorité. Au bout d'un an, la seule survie de son gouvernement semble être d'ailleurs le seul acquis de Netanyahu.
Deux méthodes donc, deux bilans différents après un an ! Il est trop tentant, au sortir de cette comparaison, d'opposer une décision qui sanctifie les morts au détriment des besoins de la santé publique, à une autre qui privilégie la santé des plus démunis aux intérêts des plus nantis. Espérons que Bibi apprenne à l'avenir d'Obama si, à son tour, il veut entrer dans l'histoire !
18:01 Publié dans La Paix Maintenant | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note
11.03.2010
Reprise des négociations ou échec annoncé ?
Déjà 3 semaines se sont passées depuis le premier article que j'ai posté sur ce blog. J'ai observé d'abord avec intérêt les premières réactions des internautes. Mais très vite, j'ai réalisé que malheureusement la plupart des messages reflétaient le travers que je redoutais. Beaucoup d'entre eux, souvent postés par les mêmes internautes d'ailleurs, servaient à leur auteur de tribune pour y affirmer leurs préjugés, souvent reflets de leur méconnaissance de la réalité ou de l'histoire de la région, ou pour alimenter des polémiques stériles. Pour ma part, j'ai hésité un temps sur la conduite à tenir, car il m'est possible en tant que responsable du blog d'interdire les réactions des internautes. Puis j'ai décidé de leur laisser leur liberté d'expression, confiant en la capacité du lecteur de faire seul la part des choses, et de reprendre ce blog pour y exprimer mon regard sur l'actualité.
Que s'est-il passé depuis ces trois dernières semaines qui nécessiterait un éclairage sur ce Proche Orient compliqué ? Je ne vais pas m'étendre longtemps sur l'affaire de Dubaï qui a, semble-t-il, passionné certains internautes. Si c'est bien le Mossad qui est derrière cette opération, la seule question qu'il faut se poser, en dehors de toute question de morale, est de savoir si l'élimination de ce responsable du Hamas valait le risque pour Israël de se mettre à mal avec l'un des rares pays arabes avec lesquels il entretient des relations ? Depuis le temps qu'Israël élimine des responsables militaires et politiques du Hamas, il semble qu'aucun bilan n'a été fait pour constater que ces dirigeants étaient bien vite remplacés. Peut être qu'il serait temps d'essayer une autre approche et de tenter de négocier avec le Hamas, le poussant éventuellement, lui, à montrer son refus de le faire au vu et au su de tout le monde. De plus en plus de voix s'expriment en ce sens même en Israël.
Le seul fait marquant de ces derniers jours est la reprise pour une période de 4 mois, sous l'égide des Américains, des négociations israélo-palestiniennes qui sont au point mort depuis plus d'un an. Selon tous les commentateurs, il n'y a pas grand-chose à en attendre dans l'immédiat, les positions des uns et des autres étant bien trop éloignées et leurs objectifs très différents. Le gouvernement israélien affirme, tout en ne s'opposant pas à ce processus, vouloir appeler à une reprise de négociations directes avec les Palestiniens. En fait, il semble plutôt chercher surtout à gagner du temps en attendant les élections de la mi mandat de novembre aux Etats-Unis qui vont bloquer les initiatives américaines dans la région. Le paradoxe de cette situation, me semble-t-il, c'est que le résultat des dernières élections israéliennes marquait l'expression d'un électorat qui préférait voir un Netanyahu en place de Premier Ministre pour résister aux pressions américaines et négocier un accord espéré par la majorité de la population dans les meilleures conditions possibles pour Israël. Or si les sondages de popularité de Bibi témoignent de sa réussite quant au premier objectif recherché, il ne semble pas en mesure d'atteindre le second. En effet, malgré des effets de manche comme le discours de Bar Ilan où Bibi reconnaissait aux Palestiniens leur droit à un Etat et la décision de gel des constructions dans les colonies, qui est trop souvent contournée comme ces jours-ci quand le ministre de l'Intérieur a annoncé le jour même de l'arrivée de Joe Biden la construction de 1600 appartements dans une colonie au Nord de Jérusalem, au risque d'humilier les Etats-Unis, le gouvernement Netanyahu reste prisonnier de sa droite et de son extrême droite.
Quant aux Palestiniens ils veulent arriver à présenter un bilan politique leur permettant de gagner les élections locales en Cisjordanie prévues le 17 juillet prochain, soit exactement dans 4 mois. Et la meilleure façon de le faire pour le tandem Abbas-Fayyad, c'est d'une part de poursuivre la politique menée par le Premier Ministre palestinien Salam Fayyad de construction sur le terrain des structures et institutions du futur Etat palestinien, y gagnant le support et le crédit de la communauté internationale et d'autre part de se montrer intransigeant à l'égard des Israéliens pour ne pas être accusé de collaboration. Ainsi de plus en plus des hautes personnalités palestiniennes ne veulent plus bénéficier des cartes de VIP pour échapper aux contrôles des Israéliens aux check point sous l'œil envieux et en colère de leur peuple. Par ailleurs des fonctionnaires palestiniens envisagent l'élimination progressive du travail palestinien dans les zones industrielles des colonies, dans le cadre du changement de structure économique et organisationnel de l'Autorité Palestinienne. Certains vont jusqu'à confisquer les produits fabriqués dans les colonies dans les magasins palestiniens. Cette nouvelle Intifada dite « blanche », si elle s'étend, risque de mettre à mal la position israélienne, déjà fortement dégradée, sur le plan international. De plus, elle peut gagner à la cause palestinienne le support politique de la frange de la population israélienne lasse de ce conflit et contribuer au réveil du camp de la paix. Certains signes comme les manifestations chaque samedi dans le quartier de Sheih Jarrah à Jérusalem contre les confiscations de maison en sont peut être le signe annonciateur.
Certes s'il est toujours préférable de négocier que de s'ignorer, il peut être aussi très contre productif d'entamer des négociations alors que, de part et d'autre, on est convaincu dès le départ qu'elles ne peuvent aboutir. Un nouvel échec désespérerait encore plus les deux populations et ne renforcerait que les extrémistes des deux côtés.
14:31 Publié dans La Paix Maintenant | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note
15.02.2010
Pourquoi ce blog
Quand j'ai été sollicité par le Nouvel Obs pour rédiger ce blog, je n'ai pas hésité une seconde. Il ne manque pas pourtant de blogs ou de forums consacrés au problème du Moyen Orient dans la presse, des blogs souvent tenus par des journalistes spécialisés connaissant bien l'histoire de cette région. Alors pourquoi en faire un nouveau ? Quelle information vais-je transmettre qu'un lecteur averti ne pourrait pas trouver facilement ailleurs ? Israël est le pays au monde où l'on trouve le plus grand nombre de journalistes rapporté à la surface du pays. Il y a plus de correspondants étrangers en Israël qu'il y en a dans toute l'Afrique. Alors ce ne sont pas les sources d'information qui manquent pour qui veut s'informer.
Mais ce qui manque ce sont les outils pour comprendre une situation, pour la décrypter. Comment expliquer la pérennité de ce conflit ? Existe-t-il une solution possible ? De plus en plus de monde en Occident pense que non. La plupart des dirigeants mondiaux qui ont essayé ces dernières années de s'en mêler se sont vite contentés de donner quelques conseils. Certains au cours de voyages dans la région ont délivré des messages ou fait des déclarations de circonstance pour plaire à l'un ou l'autre des camps et se sont retirés de ce champ de mines où ils ne pouvaient qu'y laisser des plumes.
Alors quoi faire ? Qu'est ce qu'un militant comme moi, qui depuis plus de 40 ans se bat pour la paix, peut apporter à un lecteur ? Je vais essayer de lui donner une perspective pour comprendre l'actualité, parce que si l'on ne comprend pas d'où l'on vient, on ne peut pas comprendre où l'on va. Ami Ayalon, ancien chef du Shin bet (les services secrets israéliens) et ancien marin que j'interviewais pour mon livre « Bâtisseurs de paix », me disait que quand on veut voir avancer un bateau, il ne faut pas se mettre à sa proue mais à son arrière. De là on distingue le sillage laissé dans la mer qui indique la direction vers laquelle le bateau avance. Il en est de même avec l'histoire de ce conflit, me disait-il. Si l'on veut puiser un espoir pour continuer à se battre pour la paix, il faut regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Il est vrai que depuis le temps où Golda Meïr disait que le peuple palestinien n'existait pas, il y en a eu. Même Netanyahou, issu d'une des familles les plus emblématiques de la droite nationaliste israélienne, a admis la nécessité de créer un état palestinien. Mais quel état, dans quelles frontières et avec quelles prérogatives, tout le problème est là.
Dans ma jeunesse, je pensais que l'histoire avait un sens. Aujourd'hui je n'en suis plus si sûr, même si je reste persuadé que la majorité des hommes sur cette planète partage le même souhait, celui de vivre et prospérer en sécurité auprès des siens. Ils aspirent aussi à la justice, me direz-vous. C'est vrai. Encore faut-il qu'ils acceptent de ne pas rechercher une justice absolue parce qu'il n'y en a pas, chaque peuple ayant des comptes à régler avec ses voisins, conséquence de siècles d'histoire et de conflits. Si l'on veut réparer toutes les injustices du passé, on rentre dans une comptabilité sans fin. Pour vivre au mieux les uns à côté des autres, il nous faut nous limiter à rechercher une justice relative, ce qui implique pour chacun la nécessité d'abandonner une part de ses revendications et de ses rêves. Je pense qu'au Proche Orient aussi, les hommes aspirant réellement à une solution finiront, après avoir essayé toutes les mauvaises solutions, par devenir réalistes. Mais je ne suis pas naïf. Je sais qu'il existe aussi, de part et d'autre, des forces qui ne veulent pas de solution ou plutôt qui veulent imposer la leur. Et ces hommes savent ce qu'il faut faire pour saboter toute perspective de paix quand elle existe et ce n'est pas difficile de le faire dans cette région du monde.
En Israël la classe politique se divise en deux écoles : celle qui pense que dans le contexte actuel, il n'y a pas de solution à ce conflit et qu'il faut donc le gérer au mieux en limitant le nombre de victimes et celle qui pense qu'il y a une solution possible acceptable par les deux parties. C'est à ce camp auquel je me rattache. Je sais qu'aujourd'hui en France, la plupart des personnes se revendiquant comme « pro israéliens » sont convaincues que les médias sont acquis à la cause adverse et qu'il en est symétriquement de même pour les personnes se revendiquant comme « pro palestiniens ». On est vite catalogué quand on écrit sur ce sujet. J'ai appris qu'il faut tenir compte de la perception que chacun peut avoir d'un événement parce que celle-ci fait partie intégrante de la dynamique du conflit. C'est pour cela que la meilleure façon d'aider les protagonistes à trouver une solution à ce conflit, c'est d'essayer de casser les stéréotypes que chacun peut avoir de l'autre et de l'amener à se mettre à sa place. Cela nécessitera pour certains d'entre vous, peut être, la capacité de se remettre en question si vous pensez que dans ce conflit il y a un côté qui a entièrement raison et un autre entièrement tort. Pour ma part, je ne sais pas être « pro israélien » sans être en même temps « pro palestinien » et réciproquement. C'est là où un engagement comme le mien dans un mouvement qui se bat depuis plus de 30 ans prend son sens. C'est donc le regard engagé sur l'actualité du Proche Orient d'un militant que je vous donnerai sur ce blog.
|
Re: Géopolitique 04 mai 2010, 07:25 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le sens d'un sauvetage
Il y a une mauvaise lecture de ce sauvetage grec qui ne manquera pas d’être faite. C’est donc, cela l’Europe, se diront certains. C’est donc, bien une instance supranationale, disent-ils déjà, qui impose à un gouvernement en difficultés des meures d’austérité d’une dureté sans précédent, un blocage des salaires de la fonction publique, un relèvement de l’âge de la retraite, une augmentation de la TVA et on en passe et des pires.
Ce n’est qu’à ce prix, c’est vrai, que les autres pays de l’euro et le FMI ont accepté, hier, de prêter – prêter et non pas donner – 110 milliards sur trois ans à ce pays aux abois mais s’ils n’y avaient pas mis ces conditions, cet argent n’aurait servi à rien car, aide ou pas, la Grèce serait, alors inéluctablement allé à une faillite qui n’aurait été que légèrement différée. Ce n’est pas à l’austérité que les Grecs auraient été soumis mais à la même ruine que l’Argentine avait connue, il y a 9 ans, lorsqu’elle s’était retrouvée en cessation de paiements. Ce prêt n’aurait pas été remboursé aux contribuables européens et c’est toute la zone euro, surtout, qui aurait été précipité dans la tempête car la contagion aurait gagné le Portugal, l’Espagne et l’Italie avant d’atteindre la France et l’Allemagne.
Ces si violentes mesures d’austérité, ce n’est pas l’Europe mais la crise des finances grecques qui l’impose. Elles ne sont pas à reprocher à l’Europe mais aux précédents gouvernements grecs qui avaient maquillé leurs comptes et la bonne lecture de ce sauvetage est que l’Union est peut-être en train de franchir, là, une étape trop attendue et nécessaire.
En adoptant la monnaie unique, les pays de l’euro avaient crée un géant sans tête, une zone monétaire appuyée sur l’une des plus fortes économies du monde mais sans autre institution commune qu’une Banque centrale indépendante. Il n’y avait, et il n’y a toujours pas, de politique économique commune, pas d’harmonisation, ni fiscale ni sociale, pas de politique industrielle ni de politique budgétaire.
Les dirigeants d’alors n’étaient pourtant pas plus stupides que d’autres. Ils ne l’étaient même pas du tout mais avaient considéré que nécessité ferait loi et que ce gouvernement économique commun auquel les Européens n’étaient pas encore prêts, le temps finirait par l’esquisser ou une crise par l’imposer.
La crise est venue. Après une longue hésitation, l’Allemagne a fini par accepter un contournement de l’interdiction d’aide collective à un pays de l’euro qu’elle avait elle-même fait inscrire dans les traités par crainte qu’un tel parapluie n’incite des capitales européennes au laxisme. La nécessité de la solidarité l’a emporté parce qu’il était devenu clair que tous auraient à souffrir de son absence et, désormais, ce « gouvernement économique » dont le krach de Wall Street avait, déjà, fait admettre le principe devient une évidence.
Nécessité fait bel et bien loi. Les esprits bougent mais tout reste à concevoir et mettre en place. On n’y est pas encore et, le jour où se serait fait, restera la grande question, celle de la démocratie européenne, aujourd’hui bien trop indirecte pour satisfaire quiconque.
|
Re: Géopolitique 04 mai 2010, 09:09 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
50 généraux et amiraux américains à la retraite signent une lettre véhémente pour dénoncer les égarements anti-israéliens d'Obama
par Liran Kapoano, pour American Thinker
Thème : Proche-Orient
Date de publication : le 19 avril 2010
Titre original : Israël as a Security Asset for the United States
Traduction : Objectif-info
En réponse au traitement grotesque que vient de réserver l'administration Obama à Israël , un groupe d'environ 50 généraux et amiraux américains retraités a élaboré de conserve la lettre suivante. Cette lettre invite aussi bien le président que le Congrès et le public américain à mesurer à quel point les succès d’Israël et de l’Amérique sont intimement liés.
Voici la lettre non publiée à ce jour, obtenue directement auprès d’officiers signataires :
Israël est un capital de sécurité pour les États-Unis
Nous, soussignés, avons voyagé en Israël ces dernières années avec l'Institut juif pour les Affaires de Sécurité nationale (JINSA). Nous représentions des décennies d'expérience militaire. Ayant eu accès sans restrictions aux dirigeants civils et militaires d'Israël, sommes parvenus à la conviction inébranlable que la sécurité de l'état d'Israël est une question de grande importance pour les États-Unis et pour leur politique au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Un Israël fort et en sécurité est un capital sur lequel les stratèges militaires américains et les dirigeants politiques peuvent compter. Israël est une démocratie, un produit rare et précieux dans la Région, et Israël partage notre engagement pour la liberté en général, les libertés individuelles et la primauté du droit.
Au cours de nos voyages et de nos entretiens, la détermination des Israéliens pour protéger leur pays et parvenir à une paix juste et réaliste avec leurs voisins a été clairement exprimée. Ainsi nous prenons acte des tensions actuelles entre les États-Unis et Israël avec consternation et nous éprouvons une profonde inquiétude en voyant certaine divergences politiques primer sur nos intérêts mutuels de première importance.
En tant que professionnels américains de la défense, nous analysons les événements du Moyen-Orient au prisme des intérêts de sécurité américains.
Au cours de la guerre froide, les États-Unis et Israël se sont engagés dans un processus de coopération en matière de sécurité ; aujourd'hui les deux pays font face à la menace identique d’un terrorisme alimenté par des gens qui redoutent tout ce qui relève de la liberté. La collaboration historiquement étroite des États-Unis avec Israël à tous les niveaux des forces armées israéliennes, la recherche-développement militaire, les renseignements partagés et les exercices militaires d’entrainement conjoints, a renforcé la sécurité des deux pays. La police et les responsables américains des affaires juridiques ont tiré avantage de leur collaboration étroite avec les professionnels israéliens dans le domaine du contre-terrorisme intérieur, et lors des premières réponses aux attentats terroristes.
Israël et les États-Unis sont unis par des valeurs partagées et des menaces partagées contre notre mode de vie.
La prolifération des technologies nucléaires et des armes correspondantes au Moyen-Orient et en Asie, et la maîtrise de la technologie des missiles balistiques désormais implantés dans des aires géographiques étendues, nécessitent des coopérations en matière de renseignement, et de politique technologique et de sécurité. Le terrorisme, qu’il s’agisse de l’origine de son financement, de l’entrainement ou de l’exécution des opérations terroristes, doit recevoir une réponse multilatérale quand c’est possible. La diffusion de la haine et le soutien au terrorisme d’extrémistes violents au nom de l'Islam, qu’ils proviennent acteurs étatiques ou non-étatiques, doivent être traités comme des menaces contre la paix mondiale.
Au Moyen-Orient, dans une région instable si essentielle pour les intérêts des États-Unis, il serait pusillanime de s’écarter ou de dénigrer un allié de la trempe d’Israël.
Ainsi, la prochaine fois que quelqu’un prétendra stupidement qu’Israël mérite parfois un peu « d’amour vache » pour « retrouver le droit chemin », ou qu’il faut traiter l’état juif comme un gosse turbulent qui doit aller piquet et que c’est bon pour tout le monde, qu’il aille donc le dire à ces 50 généraux et amiraux à la retraite.
Signataires au 12 avril 2010 :
Lieutenant General Mark Anderson, USAF (ret.)
Rear Admiral Charles Beers, USN (ret.)
General William Begert, USAF (ret.)
Rear Admiral Stanley W. Bryant, USN (ret.)
Lieutenant General Anthony Burshnick, USAF (ret.)
Lieutenant General Paul Cerjan, USA (ret.)
Admiral Leon Edney, USN (ret.)
Brigadier General William F. Engel, USA (ret.)
Major General Bobby Floyd, USAF (ret.)
General John Foss, USA (ret.)
Major General Paul Fratarangelo, USMC (ret.)
Major General David Grange, USA (ret.)
Lieutenant General Tom Griffin, USA (ret.)
Lieutenant General Earl Hailston, USMC (ret.)
Lieutenant General John Hall, USAF (ret.)
General Alfred Hansen, USAF (ret.)
Rear Admiral James Hinkle, USN (ret.)
General Hal Hornburg, USAF (ret.)
Major General James T. Jackson, USA (ret.)
Admiral Jerome Johnson, USN (ret.)
Rear Admiral Herb Kaler, USN (ret.)
Vice Admiral Bernard Kauderer, USN (ret.)
General William F. Kernan, USA (ret.)
Major General Homer Long, USA (ret.)
Major General Jarvis Lynch, USMC (ret.)
General Robert Magnus, USMC (ret.)
Lieutenant General Charles May, Jr., USAF (ret.)
Vice Admiral Martin Mayer, USN (ret.)
Major General James McCombs, USA (ret.)
Lieutenant General Fred McCorkle, USMC (ret.)
Rear Admiral W. F. Merlin, USCG (ret.)
Rear Admiral Mark Milliken, USN (ret.)
Rear Admiral Riley Mixson, USN (ret.)
Major General William Moore, USA (ret.)
Lieutenant General Carol Mutter, USMC (ret.)
Major General Larry T. Northington, USAF (ret.)
Lieutenant General Tad Oelstrom, USAF (ret.)
Major General James D. Parker, USA (ret.)
Vice Admiral J. T. Parker, USN (ret.)
Major General Robert Patterson, USAF (ret.)
Vice Admiral James Perkins, USN (ret.)
Rear Admiral Brian Peterman, USCG (ret.)
Lieutenant General Alan V. Rogers, USAF (ret.)
Rear Admiral Richard Rybacki, USCG (ret.)
General Crosbie Saint, USA (ret.)
Rear Admiral Norm Saunders, USCG (ret.)
General Lawrence Skantze, USAF (ret.)
Major General Sid Shachnow, USA (ret.)
Rear Admiral Jeremy Taylor, USN (ret.)
Major General Larry Taylor, USMCR (ret.)
Lieutenant General Lanny Trapp, USAF (ret.)
Vice Admiral Jerry O. Tuttle, USN (ret.)
General Louis Wagner, USA (ret.)
Rear Admiral Thomas Wilson, USN (ret.)
Lieutenant General Robert Winglass, USMC (ret.)
Rear Admiral Guy Zeller, USN (ret.)
[www.jinsa.org]
|
Re: Géopolitique 11 mai 2010, 15:34 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
vendredi 7 mai 2010
L'ornière se creuse en Europe
On ne savait pas avant le vote. On ne sait toujours pas après le vote et de cette incertitude sur laquelle se concluent les élections britanniques vont naître encore plus d’incertitudes pour l’ensemble de l’Union européenne.
Les nouvelles ne sont pas bonnes mais commençons par la Grande-Bretagne. Comme c’était probable, ni les conservateurs, pourtant largement en en tête, ni les travaillistes, en recul d’une centaine de sièges, ne disposent d’assez d’élus pour former seuls le gouvernement mais la situation sortie des urnes est encore plus complexe qu’on ne pouvait le craindre. Même en s’alliant, les travaillistes et les libéraux-démocrates resteraient loin du seuil nécessaire à la Chambre. Ils ne semblent, donc, pas à même de constituer une coalition de centre gauche, sauf à aller chercher des appuis dans les tout petits partis ce qui fragiliserait beaucoup leur éventuel gouvernement.
Si les conservateurs et les libéraux-démocrates ont, à l’inverse, assez d’élus pour pouvoir gouverner ensemble, leur alliance serait beaucoup trop conflictuelle, presque contre nature, pour apparaître durable. La Grande-Bretagne sort de ces élections sans majorité, sans majorité cohérente en tout cas. Cela signifie qu’il n’y avait pas d’offre à même de satisfaire les électeurs – ni à gauche avec des travaillistes usés par treize ans de pouvoir et que leur libéralisme avait trop éloignés de leur base populaire, ni à droite avec des conservateurs dont la volonté de rigueur budgétaire a inquiété et dont le chef de file a pu paraître trop inexpérimenté pour ces temps de crise, ni au centre avec des lib-dems qui auront énormément séduit pendant la campagne télévisée mais qui ont finalement reculé en sièges comme si l’électorat avait craint, à l’heure de la décision, d’accroître la confusion annoncée.
La Grande-Bretagne n’est pas renforcée par ce scrutin. Elle se réveille, au contraire, affaiblie puisqu’elle ne devrait pas pouvoir prendre de direction claire face à un déficit budgétaire record, comparable à celui de la Grèce, et à un endettement qui, pour être moindre que celui de la France, n’en est pas moins inquiétant.
C’est une crise politique qui frappe à Londres et qui vient généraliser, ainsi, sur fond de crise économique, une crise politique rampante dans toute l’Europe. En France, une écrasante majorité de la population est insatisfaite de son président qui a déçu la droite et pas du tout séduit la gauche. En Allemagne, la coalition entre démocrates-chrétiens et libéraux ne fonctionne pas et paraît courir, dimanche, à une défaite régionale qui la priverait de sa majorité à la Chambre haute. En Italie, le gouvernement de Silvio Berlusconi est miné par les divisions. En Espagne, le gouvernement socialiste ne fait que se survivre avec un chômage à 20% et l'on pourrait multiplier les exemples.
Il n’y a pas, en un mot, un seul homme d’Etat européen assez solide et écouté pour tirer l’Union de l’ornière dans laquelle elle s’enfonce. Ce n’est pas l’apocalypse mais ca ne va pas bien, pas bien du tout.
|
Re: Géopolitique 16 mai 2010, 09:33 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La force ou la vassalité
Leur nombre n’est pas en baisse. Qu’ils soient de droite ou de gauche, libéraux, souverainistes ou altermondialistes, les adversaires de l’unification européenne se sentent, aujourd’hui, confortés par les difficultés de l’Union.
« Je vous l’avais bien dit », répètent-ils à l’envi, sourds au fait qu’elle relève le défi et ardemment sceptiques sur les possibilités de la voir sortir renforcée de ces crises qui la font tanguer. Seule la réalité tranchera. Rien n’est joué, c’est vrai. On verra mais il y a une question, en revanche, à laquelle chacun peut, dès maintenant, donner sa réponse.
Serait-il regrettable ou souhaitable que l’Union se défasse, que l’Europe en revienne aux frontières et aux douanes d’antan et que le franc, le mark, la lire ressuscitent sur les cendres de la monnaie unique ? L’Union sert-elle, autrement dit, à quelque chose et, si oui, à quoi ? Tout le monde, bien sûr, n’a pas la même réponse mais en voici une, en plusieurs points.
Si l’on prend l’avion d’Helsinki à Madrid ou de Paris à Varsovie, on ne change pas de monde. Si on le prend d’une ville d’Europe à une ville d’Amérique, les attitudes et les codes, le paysage culturel, sont différents. On passe dans un autre monde et cela signifie qu’il y a une profonde unité de l’Europe, faite d’histoire et d’empreintes communes, de mêmes familles régnantes et de mêmes révolutions démocratiques, de guerres et de traités, de chrétienté longtemps dominante et de ces Lumières qui ont, partout, tout changé. Vieux rêve – atteint, brisé, repris – l’unité européenne a de solides fondements mais ces objectifs d’après guerre, dira-t-on, la paix et le front commun contre l’URSS, sont désormais obsolètes.
Erreur, ils ne le sont pas. Les guerres de Yougoslavie, cet instant où la France et l’Allemagne ont failli se diviser comme en 14, viennent tout juste de rappeler que, de l’Ukraine à la Belgique, de la division hongroise à la désunion italienne, plus d’un conflit latent ne demanderait qu’à entraîner le continent dans de nouvelles boucheries et, parallèlement, une autre menace a remplacé l’URSS.
Chine en tête, le défi économique des pays émergents vaut bien les chars soviétiques.
Le plus démocratique et le plus social des grands ensembles du monde, l’Europe, n’a ainsi pas que des valeurs à défendre mais, également, des intérêts et une stabilité intérieure. Elle ne le ferait certainement pas mieux en ordre dispersé qu’unie, peinant même à s’unir, et son choix est, en vérité, simple. Ou bien elle affirme une unité économique et politique qui la mettra sur les chemins d’un fédéralisme ou bien ses pays ne pèseront plus guère dans un siècle que domineront les anciennes et nouvelles puissances de taille continentale.
On peut choisir de ne pas compter. La vassalité a ses tranquillités mais si l’on ne s’en satisfait pas, on ne peut pas toujours rejeter l’Europe car elle n’est pas telle qu’on la voudrait déjà. On ne peut pas constamment soupirer sur elle et ricaner de ses retards et complexités. Il faut la vouloir, telle qu’on la voudrait, et lutter pour elle, telle qu’elle mettra, forcément, hélas, trop longtemps à être car ni Rome ni la France ne s’étaient faites en un jour.
|
Re: Géopolitique 16 mai 2010, 09:42 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le baroque triomphe à Londres
A 43 ans l’un et l’autre, ils ont en commun la jeunesse, le brio et beaucoup d’ambition. Ce n’est pas rien. Ce socle-là en vaut bien d’autres et pourrait devenir d’autant plus solide que le nouveau Premier ministre britannique, le conservateur David Cameron, et son vice-Premier ministre, le libéral-démocrate Nick Clegg, n’ont pas que cela en commun.
Outre qu’ils sont désormais condamnés à réussir ou à échouer ensemble, l’un et l’autre sont des pragmatiques, dénués de ces blocages idéologiques qui imposent tabous et automatismes dans l’action. Cela devrait leur permettre de se montrer souples dans leur coalition, de chercher à dégager des convergences plutôt que d’affirmer leurs divergences, mais leur mariage n’en reste pas moins contre-nature.
David Cameron est si profondément hostile au processus d’unification européenne qu’il avait longtemps pourfendu le traité de Lisbonne et ses avancées institutionnelles, bien trop fédéralistes à son goût. Il a logiquement choisi un europhobe militant, William Hague, pour diriger la diplomatie britannique. Il est également partisan de procéder à des coupes sombres dans les dépenses publiques afin de réduire au plus vite un déficit et un endettement qui menacent la Grande-Bretagne d’une crise de confiance alors que Nick Clegg est le contraire de tout cela.
Epouse espagnole, père d’origine russe et mère néerlandaise née en Indonésie, il est aussi cosmopolite que David Cameron est un pur produit de l’aristocratie britannique. Polyglotte ayant longtemps vécu à Bruxelles et travaillé dans les institutions communautaires, Nick Clegg est un ardent militant de la cause européenne et de l’entrée de la Grande-Bretagne dans la monnaie unique. Il n’avait cessé, durant la campagne, de mettre en garde contre un excès de rigueur qui casserait, disait-il, une reprise encore fragile et souhaite une réforme du mode de scrutin, plus favorable aux petits partis comme le sien mais dont les conservateurs ne veulent pas entendre parler car les grands partis comme le leur n’auraient qu’à y perdre.
Inscrit dans les résultats d’un vote qui contraignait à un gouvernement de coalition, c’est le mariage de la carpe et du lapin et, avec ces quadragénaires, les échiquiers politiques européens deviennent toujours plus baroques. Sans même parler des plus petits pays, les trois grandes puissances de l’Union seront maintenant conduites, en France, par un président désaimé, ancien libéral devenu régulateur ; en Allemagne, par une chancelière démocrate-chrétienne dont la coalition avec les libéraux bat de l’aile et vient de perdre, dimanche, sa majorité à la Chambre haute et, depuis hier soir, par cette addition des contraires au Royaume-Uni.
C’est un élément d’incertitude supplémentaire mais le signe, aussi, que de droite comme de gauche, les grands courants politiques européens hérités du 19ième siècle et affirmés au 20ième ne correspondent plus forcément à des sociologies et des économies profondément transformées, pas plus aux besoins qu’aux attentes.
|
Re: Géopolitique 16 mai 2010, 09:55 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La bombe jetée par la Commission
Ce n’est pas brusquement sorti d’un chapeau. Ces propositions d’examen commun des projets de budgets nationaux que la Commission européenne vient de faire ne datent pas de la crise grecque. Elles découlent directement du consensus sur la nécessité d’un gouvernement économique commun auquel les 27 étaient parvenus, l’année dernière, après que le krach de Wall Street leur eut fait voir la nécessité de resserrer les rangs de l’Europe.
L’alerte sur la cohésion de la zone euro n’a, ensuite, fait que précipiter un mouvement qui l’avait précédée, qu’amplifier une évolution vers plus d’intégration économique qui pose, aujourd’hui, quatre questions. Cette évolution est-elle souhaitable ? Violerait-elle la démocratie, comme on le dit déjà, en retirant les choix budgétaires aux représentations nationales ? Pourra-t-elle, ou non, se concrétiser et, si oui, serait-elle suffisante ?
A la première question, la réponse est « oui », elle est souhaitable et même nécessaire, puisque l’Union ne peut durablement avoir une monnaie unique mais autant de politiques économiques que de pays membres. Sauf à vouloir en revenir aux monnaies nationales et, de fil en aiguille, aux douanes et aux frontières intérieures, il faut pouvoir appuyer l’euro sur une harmonisation des politiques économiques.
Ce point ne fait guère débat mais la deuxième question suscite, elle, de grandes polémiques car il est vrai que toute coordination budgétaire au niveau de l’Union retire une part de pouvoir aux Parlements nationaux dans le plus essentiel des domaines, celui des moyens. C’est vrai, mais deux choses. Le partage volontaire des souverainetés, premièrement, est l’essence du projet européen qui consiste à toujours plus unir les nations dans un ensemble commun qu’elles ont souverainement décidé de constituer. La suppression des barrières douanières, la zone Schengen ou l’euro n’étaient pas moins révolutionnaires que ces propositions de la Commission qui, deuxièmement, ne tendent pas à retirer aux Parlements nationaux la décision d’affecter l’impôt à telle ou telle dépense mais à veiller à ce que tous les projets de budget nationaux soient conformes aux grands équilibres – endettement et déficits – que les Etats membres se sont engagés à respecter et que leur intérêt, de surcroît, est de ne pas violer.
A la troisième question, la réponse est vraisemblablement « non », ces propositions ne se concrétiseront pas, pas pleinement en tout cas, car plusieurs Etats les refuseront. La Suède a déjà dit « non ». Il serait étonnant que la Grande-Bretagne n’en fasse pas autant mais il est très possible, en revanche, que la zone euro finisse par accepter une forme de coordination préalable ou que plusieurs de ses pays le fassent, France et Allemagne en tête. Comme toujours, on commencerait alors par une avant-garde que d’autres rejoindraient ensuite.
Quant à la quatrième question, la réponse est également « non », cette coordination ne serait pas suffisante, car une politique économique commune demande une harmonisation des politiques fiscales et sociales qui exigerait, elle-même, une démocratie paneuropéenne qui n’est qu’esquissée. Ces propositions font du bruit mais elles ne sont qu’un pas, fondamental mais qu’un pas.
|
Re: Géopolitique 16 mai 2010, 09:57 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La bombe jetée par la Commission
Ce n’est pas brusquement sorti d’un chapeau. Ces propositions d’examen commun des projets de budgets nationaux que la Commission européenne vient de faire ne datent pas de la crise grecque. Elles découlent directement du consensus sur la nécessité d’un gouvernement économique commun auquel les 27 étaient parvenus, l’année dernière, après que le krach de Wall Street leur eut fait voir la nécessité de resserrer les rangs de l’Europe.
L’alerte sur la cohésion de la zone euro n’a, ensuite, fait que précipiter un mouvement qui l’avait précédée, qu’amplifier une évolution vers plus d’intégration économique qui pose, aujourd’hui, quatre questions. Cette évolution est-elle souhaitable ? Violerait-elle la démocratie, comme on le dit déjà, en retirant les choix budgétaires aux représentations nationales ? Pourra-t-elle, ou non, se concrétiser et, si oui, serait-elle suffisante ?
A la première question, la réponse est « oui », elle est souhaitable et même nécessaire, puisque l’Union ne peut durablement avoir une monnaie unique mais autant de politiques économiques que de pays membres. Sauf à vouloir en revenir aux monnaies nationales et, de fil en aiguille, aux douanes et aux frontières intérieures, il faut pouvoir appuyer l’euro sur une harmonisation des politiques économiques.
Ce point ne fait guère débat mais la deuxième question suscite, elle, de grandes polémiques car il est vrai que toute coordination budgétaire au niveau de l’Union retire une part de pouvoir aux Parlements nationaux dans le plus essentiel des domaines, celui des moyens. C’est vrai, mais deux choses. Le partage volontaire des souverainetés, premièrement, est l’essence du projet européen qui consiste à toujours plus unir les nations dans un ensemble commun qu’elles ont souverainement décidé de constituer. La suppression des barrières douanières, la zone Schengen ou l’euro n’étaient pas moins révolutionnaires que ces propositions de la Commission qui, deuxièmement, ne tendent pas à retirer aux Parlements nationaux la décision d’affecter l’impôt à telle ou telle dépense mais à veiller à ce que tous les projets de budget nationaux soient conformes aux grands équilibres – endettement et déficits – que les Etats membres se sont engagés à respecter et que leur intérêt, de surcroît, est de ne pas violer.
A la troisième question, la réponse est vraisemblablement « non », ces propositions ne se concrétiseront pas, pas pleinement en tout cas, car plusieurs Etats les refuseront. La Suède a déjà dit « non ». Il serait étonnant que la Grande-Bretagne n’en fasse pas autant mais il est très possible, en revanche, que la zone euro finisse par accepter une forme de coordination préalable ou que plusieurs de ses pays le fassent, France et Allemagne en tête. Comme toujours, on commencerait alors par une avant-garde que d’autres rejoindraient ensuite.
Quant à la quatrième question, la réponse est également « non », cette coordination ne serait pas suffisante, car une politique économique commune demande une harmonisation des politiques fiscales et sociales qui exigerait, elle-même, une démocratie paneuropéenne qui n’est qu’esquissée. Ces propositions font du bruit mais elles ne sont qu’un pas, fondamental mais qu’un pas.
|
Re: Géopolitique 21 mai 2010, 01:23 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les bons offices turco-brésiliens
Marchandages ? Donnant-donnant ? On jure que non à Paris comme à Téhéran mais il y a une certitude dans cette libération, hier, de Clotilde Reiss.
C’est avant tout à Luiz Inacio Lula da Silva que la jeune universitaire doit d’avoir pu regagner la France, hier, car le régime iranien n’avait rien à refuser au président brésilien qui lui avait demandé ce geste dans le cadre de la médiation sur le dossier nucléaire qu’il paraît avoir réussi, la nuit dernière, entre les grandes puissances et la République islamique.
Attention ! Le diable est dans les détails qui ne sont pas déjà connus. Comme souvent dans le passé, une déception pourrait suivre ce moment d’espoir mais retour en arrière, pour mieux comprendre ce qui se passe, en ce moment même, et pourrait, peut-être, mettre fin à ce très inquiétant bras de fer.
En octobre dernier, en proie à des crises économique et politique aussi profondes et graves l’une que l’autre, l’Iran avait accepté de confier la majeure partie de son stock d’uranium à la Russie qui l’aurait enrichi à 20% avant qu’il ne soit conditionné en France pour un usage exclusivement civil et ne lui soit, ensuite, restitué. Les choses avaient vraiment bougé. Pour les années à venir au moins, l’Iran semblait avoir renoncé aux moyens de se doter de la bombe et puis, patatras, le régime iranien avait reculé, empêtré dans ses divisions.
Il voulait toujours de cet accord, disait-il, mais pas comme il avait été envisagé. Il fallait aussi que ceci, que cela – bref, il n’y avait plus d’accord et ce retournement avait considérablement irrité la Russie qui avait, alors, amorcé son ralliement à l’adoption de nouvelles sanctions économiques par le Conseil de sécurité avant que la Chine ne fasse de même, dans le cadre d’une détente générale de ses relations avec les Etats-Unis.
L’Iran avait réussi à se mettre à dos l’ensemble des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et c’est dans ce contexte que le Brésil et la Turquie avaient annoncé leur intention d’essayer de relancer l’accord entrevu à l’automne dernier. Le Brésil voulait affirmer par là son poids politique à l’heure où il devient un nouveau grand de la scène économique internationale. Seul pays musulman membre de l’Otan et candidate à l’entrée dans l’Union européenne, la Turquie souhaitait, de son côté, rappeler son importance stratégique, ce rôle de pont que sa spectaculaire croissance économique lui permet de jouer toujours plus. Ankara et Brasilia avaient donc pris langue avec Téhéran, avec un certain succès, semble-t-il, puisque le Premier ministre turc et le président brésilien y étaient attendus ensemble ce week-end mais Recep Erdogan s’était décommandé à la dernière minute, faisant comprendre que les assurances données par les Iraniens n’étaient pas suffisantes.
L’affaire était à l’eau mais hier, en début de soirée, le Premier ministre turc a soudain rejoint Lula à Téhéran et, au milieu de la nuit, alors même que les discussions se poursuivaient, un accord était annoncé, signe que l’Iran voudrait beaucoup éviter ces sanctions de l’Onu. Quelque chose s’est débloquée. C’est en Turquie et contre des garanties turques que l’Iran pourrait procéder à l’échange de son uranium. On en est là et on en saura plus dans la journée.
|
Re: Géopolitique 21 mai 2010, 06:26 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Coup de massue pour les grandes puissances
De Washington à Moscou, de Londres à Paris en passant par le secrétariat général de l’Onu, l’embarras est le même. Devant le compromis que le Brésil et la Turquie ont scellé, hier matin, avec l’Iran sur le dossier nucléaire, les grandes puissances se sentent à la fois flouées, mises en échec et humiliés pour trois raisons.
La première est qu’il y a tromperie sur la marchandise. En octobre dernier, l’Iran possédait 1500 kilos d’uranium faiblement enrichi et lorsqu’il avait accepté d’en confier 1200 kilos à la Russie qui les aurait enrichis à 20% avant qu’ils ne soient conditionnés en France pour un usage exclusivement civil et ne lui soient, ensuite, restitués sous cette forme, c’est ainsi de la majeure partie de son stock qu’il avait, apparemment, envisagé de se dessaisir.
Pour au temps au moins, l’Iran semblait, alors, avoir renoncé aux moyens de se doter de la bombe. Les choses avaient vraiment bougé jusqu’à ce que le régime iranien ne se dédise mais c’est, aujourd’hui, de 2400 kilos d’uranium faiblement enrichi dont il dispose et cela change tout, absolument tout. En acceptant, maintenant, ce qu’il avait fini par refuser à l’automne, en s’engageant devant le président brésilien et le Premier ministre turc à procéder, en Turquie, à l’échange conçu en octobre, ce n’est plus la quasi-totalité de son stock que l’Iran neutraliserait à des fins exclusivement civiles mais la moitié seulement, 1200 kilos sur 2400. Non seulement ce n’est plus une renonciation à ses ambitions nucléaires mais, sitôt signé cet accord avec le Brésil et la Turquie, l’Iran a fait officiellement savoir qu’il entendait poursuivre les opérations d’enrichissement à 20% qu’il a entamées au début de l’année.
On n’en est plus du tout à la mesure de confiance entrevue en octobre et l’accord d’hier, de surcroît, compliquera singulièrement l’adoption de nouvelles sanctions par le Conseil de sécurité puisque le Brésil et la Turquie y siègent en ce moment, qu’ils y ont une grande influence et qu’ils estiment, l’un et l’autre, qu’aucune sanction n’est plus nécessaire après l’accord auquel ils sont parvenus. Ce n’est pas du tout l’avis des grandes puissances, Occidentaux et Russie au moins car la Chine reste silencieuse, mais elles ne peuvent ni ne veulent s’opposer frontalement au Brésil et à la Turquie qui peuvent les bloquer au Conseil et préfèrent, donc, laisser décanter les choses, laisser apparaître la tromperie sur la marchandise, pour pouvoir, ensuite, reprendre la main.
En privé, leurs diplomates ne cachent guère leur colère. En public, ils restent mesurés mais, au-delà même de ce dossier iranien, c’est un coup de massue que les grandes puissances viennent de prendre car c’est la première fois que des pays comme le Brésil et la Turquie, des puissances émergentes mais qui n’ont pas la taille de l’Inde ou de la Chine, s’imposent en acteur décisifs de la scène diplomatique. On savait que le monopole occidental sur les affaires du monde était révolu mais l’épisode d’hier fera date car ce n’est plus seulement le poids économique de l’Occident qui est relativisé mais également sa prépondérance diplomatique. Beaucoup plus qu’un embarras, c’est un coup de tonnerre qui ne marque rien de moins qu’un changement d’époque.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.