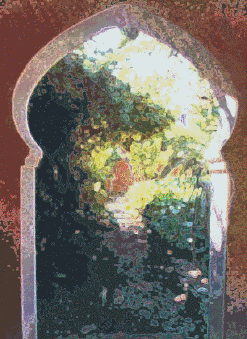|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 21 mai 2010, 12:15 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les calculs du président
C’est un complet changement de ton. Rien, disait lundi la diplomatie française. Cet accord avec l’Iran auquel étaient parvenus le président brésilien et le Premier ministre turc n’était rien d’autre, disait-elle, qu’une manœuvre des dirigeants iraniens pour retarder l’adoption du projet de nouvelles sanctions économiques que les grandes puissances ont présenté, hier, au Conseil de sécurité.
Ce n'est rien qu’une manœuvre dilatoire, disait la diplomatie française en soulignant, et pas à tort, que ce n’était plus l’essentiel mais la moitié seulement de son stock d’uranium faiblement enrichi que l’Iran se disait désormais disposé à faire sortir de son territoire avant qu’il ne lui soit restitué sous un conditionnement n’autorisant plus qu’un usage civil. Cette position de la diplomatie française était celle de l’ensemble des capitales occidentales mais, hier après-midi, Nicolas Sarkozy en a pris une tout autre. « Le transfert de 1200 kilos d’uranium faiblement enrichi hors d’Iran constitue un pas positif », a-t-il fait dire dans un communiqué en exprimant « sa reconnaissance et le plein soutien de la France au président brésilien pour les efforts qu’il a accomplis ».
D’abord discrètement mais assez rageusement moqué pour sa « naïveté » par le Quai d’Orsay, Luiz Inacio Lula da Silva est maintenant applaudi par le président de la République mais il y a trois explications à cela. La première est que Nicolas Sarkozy tient beaucoup à lui vendre des Rafale, cet avion de combat que la France n’a jamais réussi à exporter. Economiquement parlant, l’enjeu est de taille mais l’essentiel n’est pas là.
Après une journée de réflexion et une entrevue madrilène avec Lula, Nicolas Sarkozy a tiré les conclusions d’une situation de fait. Le Brésil et la Turquie siègent en ce moment au Conseil de sécurité. Ils y exercent une considérable influence sur les autres membres non permanents et ne cessent de marteler, depuis lundi, que des sanctions ne seraient plus nécessaires aujourd’hui. Il n’y a plus, autrement dit, de majorité certaine au Conseil pour l’adoption d’un projet que le Brésil refuse même d’examiner et le réalisme commandait, donc, d’accompagner la démarche turco-brésilienne. Si elle mène à un véritable abandon par l’Iran de ses ambitions nucléaires, parfait. Si l’Iran se dédisait, au contraire, Turcs et Brésiliens se rallieraient d’autant mieux à des sanctions que leurs efforts n’auraient pas été ignorés.
Nicolas Sarkozy a décidé d’attendre et voir, parsemant sa déclaration d’interrogations sur les intentions de l’Iran, mais ce n’est pas tout. Bien au-delà de ce dossier, il cultive, là, les relations qu’il a développées avec le Brésil car il a décidé de nouer des liens privilégiés avec celles des puissances émergentes qui, contrairement à la Chine, ne font que commencer à se faire une place sur la scène internationale. C’est un choix stratégique dont il espère des retombées pour l’influence française, notamment sur le dossier de la régulation des marchés dont il a fait son cheval de bataille depuis le krach de Wall Street. A ses yeux, ce choix valait bien quelques applaudissements à un accord qu’en fait, il réprouve.
|
Re: Géopolitique 22 mai 2010, 00:28 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
De l'Arizona aux mollahs
C’était une journée du monde d’aujourd’hui, où tout se tient et chaque pays compte, où ceux qu’on appelait, autrefois, les « grands » doivent désormais compter avec des petits qui ont pris du poids.
Hier, Barack Obama, premier président métis d’une superpuissance qui ne reconnaissait pas les mêmes droits à ses citoyens noirs et blancs il y encore 50 ans, recevait Felipe Calderon, président d’un pays, le Mexique, qui n’était qu’une « arrière-cour » des Etats-Unis il y a encore 25 ans. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, loin de se comporter en vassal, Felipe Calderon s’est exprimé en égal, rappelant « l’énorme contribution » des Mexicains à l’économie américaine, de ces immigrés qui doivent pourtant, a-t-il dit, « vivre dans l’ombre et parfois supporter, comme en Arizona, des cas de discrimination ».
Loin de le rabrouer, Barack Obama lui a implicitement donné raison, déplorant explicitement que l’Arizona, grande porte d’entrée des Mexicains aux Etats-Unis, vienne d’autoriser ce qu’on appelle, en France, les contrôles au faciès, ces vérifications d’identité qu’aucun délit ne justifie. Sans doute était-ce un peu le métis qui parlait, là, en connaissance de cause. C’était beaucoup, aussi, l’homme politique qui pensait aux voix des Américains d’origine « hispanique » mais c’était, surtout, avant tout, un président qui sait que le Mexique est actuellement l’un des 10 membres non-permanents du Conseil de sécurité dont les 5 membres permanents, les grandes puissances de l’après-guerre, viennent de présenter, lundi, un projet de résolution visant à instaurer de nouvelles sanctions économiques contre l’Iran.
La voix du Mexique pèsera lourd au Conseil. Le Mexique pourrait faire le vote car deux autres des non-permanents, le Brésil et la Turquie, deux pays émergents à la croissance vigoureuse, ont scellé, le week-end dernier, un accord avec l’Iran qui résoudrait, martèlent-ils, la crise provoquée par les ambitions nucléaires de la République islamique. Le Brésil et la Turquie ont pris en main ces affaires du monde qui ne se réglaient, hier, qu’entre les grands et, quelle que soit leur stupeur de voir ainsi bousculer leurs arrangements si difficilement négociés, les grandes puissances doivent ménager le Brésil, plus grand Etat d’Amérique latine qui pourrait devenir une nouvelle Chine, et la Turquie dont l’influence grandit chaque jour au Proche-Orient et en Asie centrale, sur ces terres qui étaient siennes lorsqu’elle était encore l’Empire ottoman, disloqué par la France et la Grande-Bretagne à la fin de la Première Guerre mondiale.
Soucieux de sceller avec le Brésil une connivence à laquelle il travaille depuis son élection, Nicolas Sarkozy avait dit, mardi, sa « reconnaissance et son plein soutien » au président brésilien pour l’accord de Téhéran alors même qu’il est le plus ardent partisan de sanctions contre l’Iran. Ente deux conversations avec Felipe Calderon, Barack Obama a, lui, longuement appelé le Premier ministre turc pour ménager la susceptibilité d’un pays membre de l’Otan mais que les Etats-Unis parviennent de moins en moins à maintenir dans leur sillage. De l’Arizona aux mollahs, le monde n’est plus qu’un mais, pour l'heure, la perspective de sanctions onusiennes paraît beaucoup inquiéter les dirigeants iraniens.
|
Re: Géopolitique 22 mai 2010, 23:48 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La naissance d'une nouvelle Union
Ce qu’on retient n’est pas forcément ce qui se passe. De ce grand tintamarre fait de mouvements des bourses et des monnaies, de différences d’intonation à Paris et Berlin et de déferlement de rigueur sur toutes les capitales européennes, on retient que l’euro serait en danger, l’Union proche de se déliter et l’Europe au bord de la faillite.
La confusion est telle que tout le laisse croire et qu’on ne peut, bien sûr, pas l’exclure à terme mais, pour l’heure et pour longtemps, ce n’est pas le cas. Ce qui se passe, c’est que l’Union cherche à relever les défis du moment, qu’une nouvelle Union est en train de naître et que l’accouchement est difficile. Tout vient de ce qu’en quelques mois, les investisseurs, grandes sociétés et banques, surtout, qui collectent et placent l’épargne, ont réalisé non seulement que l’endettement de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal et de la Grande-Bretagne était devenu vertigineux mais que toute l’Europe s’était endettée pour parer le krach de Wall Street et que ces nouvelles dettes s’étaient ajoutées à celles que les Européens accumulent depuis des décennies.
Les prêteurs ont tout simplement pris peur pour leur argent, la spéculation s’en est mêlée et, dans cette tourmente financière qui bat son plein, les gouvernements comme les « marchés », car c’est ainsi qu’on dit, ont compris ce que la France était à peu près seule à dire jusque là, que l’Union avait une monnaie unique mais pas de politiques communes, qu’il n’y avait personne d’autre aux manettes que d’interminables sommets à 27, que l’Europe n’était pas à même de faire face à un orage et qu’elle en était, donc, politiquement faible et d’autant plus inquiétante. Le paradoxe est que les marchés ont non seulement mis le doigt sur de vrais problèmes d’endettement mais qu’ils ont également suscité, eux qui ont tellement horreur des Etats et des réglementations, un besoin de politique et de gouvernement commun de l’Union.
C’est une très bonne chose. On en vient, enfin, aux évidences mais la soudaineté de ce besoin de politiques communes provoque – et c’est heureux – de chauds débats sur la manière d’organiser ces politiques qui n’étaient pas prévues par les traités et sur leur nature même, sur les choix autrement dit, qu’elles impliquent. En Allemagne, où l’on n’a pas oublié que c’est largement l’inflation de la fin des années 20 qui avait permis l’élection d’Hitler, on panique devant les nouveaux endettements que demande l’organisation de la solidarité européenne et, pour vendre cette solidarité à son pays, la chancelière est amenée, à la fois, à exiger un assainissement immédiat de tous les comptes publics européens pour apaiser sa droite et à prendre, dans l’urgence, pour apaiser sa gauche, des mesures de régulation des marchés qui les affolent.
Bousculés, sidérés, les autres Européens, freinent des quatre fers sur ces deux chemins à la fois. La confusion s’approfondit dans une crainte générale, exprimée hier par le patron du FMI, que tant de rigueur ne casse la reprise. Ca tangue, et trop fort, mais le fait fondamental, prometteur, est que l’Europe se cherche des politiques communes, se dispute sur leur contenu, que la politique et le débat politique se saisissent, sous nos yeux, des commandes de l’Union.
|
Re: Géopolitique 24 mai 2010, 23:53 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Deux évolutions à suivre
Les grands tournants sont rarement brusques. D’abord imperceptibles, de petits signaux les annoncent, des évolutions les préparent, et c’est, peut-être, ce qui se passe en ce moment à Cuba et en Turquie.
En avril dernier, le plus haut dignitaire de l’église cubaine, le cardinal Ortega, avait surpris en déclarant que son pays était dans une « situation très difficile », que les avis divergeaient sur les moyens de l’en sortir mais qu’un « consensus national » s’était formé sur le fait que les changements devaient, désormais, être « rapides ». Jamais le cardinal Ortega ne s’était autant aventuré sur le terrain politique. Sa déclaration pouvait se lire comme une critique du nouveau président cubain, Raul Castro, le frère de Fidel auquel il a succédé il y a deux ans, et dont les velléités de réformes sont restées extrêmement timides. Elle pouvait, au contraire, s’interpréter comme un appui de l’église à un homme qui paraît conscient de la nécessité de faire bouger les choses mais reste loin d’y parvenir.
Ce n’était pas clair mais, mercredi, le cardinal a été reçu par Raul Castro, durant plus de quatre heures. Il est sorti très confiant de cette audience, parlant d’une « reconnaissance du rôle de l’église » et d’un « dépassement des griefs passés permettant d’emprunter un nouveau chemin ». Le cardinal avait obtenu un geste sur les détenus politiques qui s’est concrétisé ce week-end lorsque l’église a fait savoir à un opposant en grève de la faim que les prisonniers de conscience seraient transférés dans des prisons de leur région afin que leurs familles puissent leur rendre plus facilement visite et que tous ceux qui sont souffrants, une trentaine sur quelques deux cents, pourraient être hospitalisés.
Non seulement Raul Castro vient de faire une concession de taille à la dissidence qui ne pourra qu’en être encouragée mais il a bel et bien promu, là, l’église au rang d’interlocuteur du pouvoir et d’intermédiaire avec l’opposition. Si cette dynamique se confirmait Cuba pourrait, alors, entrer dans un pluralisme de fait, très comparable à celui que la Pologne avait connu dans les années 70, avant la création de Solidarité.
Affaire à suivre, donc, à la loupe, tout comme ce qui vient de se produire en Turquie. Là-bas, deux grandes forces dominent l’échiquier politique. Au pouvoir, les anciens islamistes de l’AKP sont devenus un parti conservateur, religieux et traditionaliste, mais bon gestionnaire, démocrate, respectueux de la laïcité et pro-européen. L’AKP a su ajouter à sa base populaire le soutien du patronat et d’une partie des classes moyennes alors que le CHP, la formation créée par Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, n’a cessé de reculer parce qu’elle s’opposait aux réformes demandées par l'Europe au motif qu’elles allaient amoindrir le rôle de l’armée, gardienne de la laïcité. Le CHP avait abandonné sa place de parti de la modernité à l’AKP mais il a profondément renouvelé, hier, sa direction, s’est ouvert à des pro-européens et remis, ainsi, en position de s’opposer aux anciens islamistes en leur reprenant ses électeurs. La Turquie est peut-être en tain d’évoluer vers un bipartisme -droite, gauche- qui ferait plus que jamais d’elle un modèle dans le monde musulman.
|
Re: Géopolitique 26 mai 2010, 00:52 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le cynisme nord-coréen
Beaucoup de guerres ont été déclarées pour moins que cela. Le 26 mars dernier, une corvette sud-coréenne, le Cheonan, était coulée à la limite des eaux territoriales des deux Corée et 46 hommes trouvaient la mort dans ce naufrage. Une enquête internationale a conclu, la semaine dernière, que le bâtiment avait été touché par une torpille tirée par un sous-marin sud-coréen.
Pyongyang accuse Séoul d’avoir « fabriqué » des preuves et estime que les deux pays sont désormais « proches de la guerre ». Séoul a suspendu toutes ses relations commerciales avec la Corée du Nord, entend porter l’affaire devant le Conseil de sécurité et y demander des sanctions internationales contre le régime nord-coréen. Le Japon et les Occidentaux soutiennent les Sud-Coréens avec lesquels les Etats-Unis viennent d’annoncer l’organisation de manœuvres navales qui devraient débuter « prochainement ».
Dans un concert d’invectives réciproques, c’est dans une logique de guerre que la région est entrée mais, si un dérapage n’est, bien sûr, pas exclu, il est pourtant improbable que les choses en arrivent là pour quatre raisons. La premières est que les Etats-Unis n’ont aucun désir de se laisser engager dans un conflit alors qu’ils cherchent désespérément à se sortir d’Irak et d’Afghanistan, à éviter une escalade avec l’Iran et à trouver un règlement global au conflit israélo-palestinien. Non seulement l’humeur et tout sauf martiale à Washington mais la Chine ferait tout pour dissuader les Etats-Unis d’aller trop loin parce qu’un effondrement du régime nord-coréen provoquerait un afflux de réfugiés sur son territoire et rapprocherait de ses frontières l’armée américaine qui entretient 28 000 hommes en Corée du Sud.
Quant aux deux Corée elles-mêmes, elles ont également toute raison de canaliser cette crise car une guerre mettrait à plat l’économie du Sud qui n’a, de surcroît, aucune envie d’avoir à prendre en charge la reconstruction du Nord qui n’ignore pas, pour sa part, qu’il n’aurait aucun moyen de sortir vainqueur d’un affrontement armé alors qu’il n’a même pas de quoi nourrir sa population.
Affreuse à voir, la vérité est que rigoureusement personne ne souhaite la fin de ce régime nord-coréen, dynastique et ubuesque, monstrueusement répressif, sans doute le plus abominable qui soit au monde, pour la simple raison que personne ne voudrait avoir à remettre ce pays sur pied, et que ni la Chine ni aucune des puissances asiatiques, en fait, ne souhaite voir renaître une Corée unifiée qui modifierait, à terme, tous les rapports de force continentaux. Une corvette envoyée par le fond, c’est trop, surtout quand le secrétaire général de l’Onu est sud-coréen, mais ce qui se hurle en silence dans toute la région n’est rien d’autre qu’un lâche et collectif « Pourvu que ça dure ! ».
Reste alors à comprendre ce qui explique cette provocation nord-coréenne. Réponse : comme avec son programme nucléaire, ce régime aux abois a cherché, là, à provoquer une crise dans l’espoir de pouvoir en monnayer l’apaisement contre des aides. C’est aussi simple et cynique que cela, sauf que de provocation en provocation, cette affaire finira, un jour, par mal tourner.
|
Re: Géopolitique 28 mai 2010, 05:34 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'Europe et les marchés
Dans cette crise monétaire et boursière qui repartait, hier, en flèche, le vocabulaire est trompeur. « Les marchés sont inquiets ou rassurés, les marchés veulent ou imposent », dit-on dix fois par jour au gré des hausses et des baisses, mais « les marchés » ne sont jamais que les lieux où se négocient les échanges marchands, bourses ou salles d’ordre, de vente ou d’achat, des grande banques.
Un lieu ne peut pas avoir de sentiments ni vouloir quoi que ce soit. Ces lieux, les marchés, ne sont que des caisses de résonnance des analyses, inquiétudes, espoirs et anticipations des gens qui cherchent à placer au mieux ou à ne pas perdre, en tout cas, l’argent qu’ils possèdent ou sont chargés de gérer. Détenteurs de grandes fortunes ou gestionnaires des fonds de grosses sociétés ou de l’épargne publique collectée par les banques, ces gens sont de chair et d’os, non pas une entité métaphysique mais des investisseurs, obsédés par la crainte d’essuyer des pertes ou de rater des gains, qui courent simplement au plus sûr.
Qu’un pays atteigne un niveau d’endettement tel que ses capacités de remboursement soient menacées, qu’un secteur industriel ou telle multinationale voit tellement chuter ses ventes que ses bénéfices et sa valeur boursière en soient virtuellement amoindries, et les investisseurs, aussitôt, s’en détournent, vendent pour acheter ailleurs. C’est ce qui s’était passé pour la Grèce. C’est ce qui se passe, maintenant, pour l’Europe entière car, après s’être inquiétés des niveaux d’endettement européens, les investisseurs – l’argent – s’inquiètent de la brutalité des plans de rigueur multipliés par les gouvernements européens dans la mesure où ce resserrement des dépenses publiques a de grandes chances de freiner la reprise en diminuant le pouvoir d’achat, ralentissant l’activité des entreprises, diminuant les rentrées fiscales et augmentant l’endettement.
L’argent est moutonnier, simpliste, avide mais, en l’occurrence, il est tout, sauf stupide. Les investisseurs ont toute raison de nourrir cette nouvelle crainte puisque l’austérité est tout aussi inquiétante que l’endettement et ce n’est pas eux qu’il faut accuser de céder à la panique en faisant n’importe quoi. Ceux qui sont, aujourd’hui, en pleine irrationalité, ce sont les gouvernements qui prennent des mesures d’assainissement bien trop rapides et brutales, donc dangereuses et intenables. Alors, question, pourquoi le font-ils ?
Ce n’est parce qu’ils seraient bêtes et méchants puisqu’ils ne le sont pas. S’ils agissent ainsi, c’est parce qu’ils ne disposent pas d’autre moyen de réduire l’endettement que ces coupes sombres dans la mesure où les réformes structurelles, notamment fiscales, qui seraient à prendre ne peuvent pas l’être au niveau national. Qu’un gouvernement européen, par exemple, augmente l’impôt sur les sociétés, devenu bien trop bas, sans que les autres ne le fassent et le seul résultat en serait que les entreprises déménageraient leurs sièges sociaux.
Les grandes réformes que les pays européens ont à prendre passent par une harmonisation sociale et fiscale qui ne peut être, par définition, que collective. La confiance et la stabilité ne reviendront que lorsqu’il y aura un pilote dans l’avion, un gouvernement économique européen, désormais en gestation mais beaucoup, beaucoup trop lent à s’affirmer.
|
Re: Géopolitique 03 juin 2010, 07:25 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le soudain atout de l'Afrique
On en dit, désormais, que voilà, c’est fait, il s’éveille. Pas totalement infondé, c’est le bruit qui court sur ce continent africain que la France reçoit aujourd’hui, à Nice, en grande pompe mais qu’en est-il réellement ?
Depuis l’année dernière, l’Afrique, près du quart de la superficie mondiale, compte plus d’un milliard d’habitants, chrétiens et musulmans à parts sensiblement égales. D’environ 6% dans les deux années qui avaient précédé le krach de Wall Street, son taux de croissance est retombé à 2,5% l’année dernière mais devrait atteindre les 4,5% cette année et dépasser les 5% en 2011.
Loin des images toutes faites, l’Afrique n’est plus seulement ce continent de tous les malheurs conjugués, épidémies et famines, dictatures, misère et corruption. Saignée par l’esclavagisme, pillée par le colonialisme, ruinée par une rare collection de dirigeants incompétents après les indépendances des années 50 et 60, l’Afrique – c’est vrai – relève la tête avec quelques timides progrès de la démocratie, moins d’arbitraire et un démarrage économique trop bienvenu pour ne pas le souligner.
L’Afrique n’est plus un continent sans espoir mais on ne peut pas oublier que, lorsqu’on part de si bas, un taux de croissance ne signifie pas grand-chose au quotidien. Alors que l’Inde et la Chine ont tourné la page des famines, l’Afrique reste le continent le plus touché par la sous-alimentation dont souffrent 28% de sa population et l’Afrique sub-saharienne concentre à elle seule 67% de l’ensemble des personnes malades du Sida de par le monde.
Assise sur d’immenses richesses, pétrole, minerais et terres arables inexploitées, l’Afrique demeure, et de loin, le plus pauvre de tous les continents mais, depuis le début de ce siècle, son atout est de furieusement intéresser les pays émergents, Chine en tête, qui ont besoin de ses matières premières pour soutenir leur propre croissance et trouvent, là, un immense débouché pour leurs productions à bas coûts et, surtout, leurs entreprises de bâtiment et travaux publics qui peuvent y construire à des prix de moitié moins élevés que ceux des entreprises occidentales, européennes et américaines.
C’est ainsi que l’Afrique devient en ce moment même, sous nos yeux, l’un des principaux théâtres des transformations en cours de l’économie mondiale. En un rien de temps, la Chine s’est placée en tête des pays exportateurs vers l’Afrique. Elle vient de conclure, en République démocratique du Congo, un gigantesque accord aux termes duquel elle y développera les infrastructures en échange de droits d’exploitation miniers. La Corée du Sud et la Chine louent des mines et des terres à Madagascar. La Lybie exploite des terres en bail au Mali. Sur tout le continent, les compagnies pétrolières chinoises battent en brèche l’ancien monopole des compagnies occidentales. Les pays émergents mettent la main sur l’Afrique où la Chine est d’autant plus appréciée des gouvernements en place que, contrairement aux anciennes puissances coloniales, elle ne se soucie pas, et pour cause, de leur donner des leçons sur l’état de droit.
L’Afrique s’éveille et l’Europe ferait bien de se réveiller avant de l’avoir perdue.
|
Re: Géopolitique 04 juin 2010, 04:48 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
Ton premier soucis , c'est de forcer le blocus de gaza , et le mien c'est ce qui se passe chez toi .
Ce n'est pas parce que je t'aime Europe , mais parce que lorsque il t'auront englouti , ils seront plus forts contre nous .
Et toi tu n'as pas encore compris , qu'en nous affaiblissant , tu les renforces contre toi même .
|
Re: Géopolitique 05 juin 2010, 10:27 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
|
Re: Géopolitique 09 juin 2010, 12:32 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les dynamiques de la dette
L’endettement des Etats et l’austérité qu’il induit remodèlent les échiquiers européens. De gauche ou de droite, les gouvernements en place en souffrent tous car tous se mettent aux économies. Nicolas Sarkozy bat des records d’impopularité tandis que les socialistes espagnols plongent dans les sondages. La coalition allemande bat de l’aile car la chancelière démocrate-chrétienne ne veut plus entendre parler des baisses d’impôts sur lesquelles elle s’était entendue avec ses alliés libéraux. Des dynamiques nouvelles se créent partout mais, cette semaine, c’est aux Pays-Bas et en Hongrie que les effets du délabrement des finances publiques sont les plus marquants et intrigants.
Jusqu’il y a quelques semaines encore, la nouvelle extrême-droite néerlandaise était partie pour arriver en tête des législatives d’après-demain. Tout la portait car l’importance de l’immigration dans ce pays et la radicalisation politico-religieuse d’une frange des immigrés musulmans avaient suscité une réaction de rejet passionné dans ce pays qui fut, historiquement, le plus tolérant de tout le continent. Issu du parti libéral, un parti prônant l’arrêt de l’immigration musulmane caracolait dans les sondages grâce au ralliement d’une partie de l’électorat populaire, souvent venu de la gauche, de femmes effrayées à l’idée que l’islam néerlandais pourrait remettre en question l’égalité entre les sexes et d’homosexuels mobilisés par la crainte que les droits et l’acceptation qu’ils ont imposés de haute lutte depuis les années 60 puissent être, eux aussi, contestés.
Il s’agissait, là, d’une convergence jamais vue, d’un fait politique nouveau qui favorisait une extrême-droite au nom de la défense de la tolérance et de la modernité mais la crise grecque, les inquiétudes sur l’Espagne et le Portugal et les soudaines interrogations sur la solidité de l’euro ont, brusquement, changé la donne. D’un coup, la crainte de l’endettement s’est substituée à celle de l’islam au premier rang des préoccupations de l’électorat et c’est tout le paysage politique néerlandais qui pourrait en être modifié.
Si les sondages disent vrai, ce sont les libéraux qui devraient, maintenant, arriver en tête mercredi soir, suivis par la gauche travailliste. On en reviendrait, autrement dit, au vrai problème, l’économie, et aux deux pôles traditionnels de la politique européenne, une droite rigoriste et une gauche protectrice dont la remotée est d’autant plus notable que la première dit vouloir relever l’âge de la retraite de 65 ans à 67 et que la seconde oppose tranquillement à l’extrême-droite sa confiance dans l’intégration des immigrés.
Le retournement de situation n’est pas moindre en Hongrie. Là-bas, une droite, libérale et nationaliste, vient de remporter une majorité écrasante aux dernières législatives en promettant des baisses d’impôts contre la rigueur des socialistes sortants. La Hongrie était partie pour laisser filer ses déficits mais les conséquences en auraient été si incertaines que, dans un total tête-à-queue, la nouvelle majorité a volontairement dramatisé la situation, décrivant le pays comme au bord de la banqueroute, que la bourse et la devise nationale s’en sont écroulées et que la Hongrie vogue pour une austérité contre laquelle les Hongrois avaient voté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.