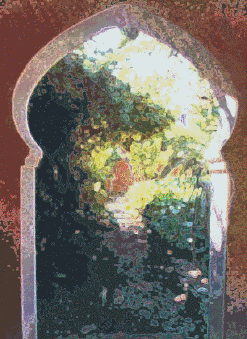|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 15 octobre 2009, 15:04 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Un article à ne pas manquer
Les grandes puissances ne savent décidément pas qu’en penser. « Y croire ou ne pas y croire ? », se demande-t-on dans toutes leurs capitales depuis que l’Iran a soudainement proposé, le 1er octobre, à Genève, non seulement d’ouvrir son site nucléaire secret de Qom aux inspecteurs de l’Agence internationale pour l’énergie atomique mais aussi de confier l’enrichissement de son uranium à la Russie et à la France qui le conditionneraient pour un usage non pas militaire mais civil.
Cela semble un peu trop beau pour être vrai mais, en même temps… Peut-être, puisqu’il y a, aussi, des raisons d’y croire. Bref, on ne sait pas et, dans l’attente des réunions prévues entre experts des deux parties et, surtout, du prochain rendez-vous de Genève, à la fin du mois, le Financial Times a publié, hier, un article à ne pas manquer.
Signé par Richard Haas, président du très influent Council on foreign relations de New York et ancien haut responsable du département d’Etat sous Georges Bush, cet article balaie d’emblée toute possibilité de frappe contre les sites iraniens au cas où Téhéran n’aurait pris que de faux engagements, destinés à gagner du temps. Cela ne ferait que retarder, au mieux, le programme iranien, explique-t-il. On ne peut frapper que ce qui est connu, ajoute-t-il. Des frappes, dit-il enfin, susciteraident de sévères représailles iraniennes en Irak et en Afghanistan et tripleraient, dans l’heure, le prix du baril de pétrole, ce qui mettrait immédiatement fin à la relance de l’économie mondiale.
Ce constat fait, Richard Haas, ancien disciple d’Henry Kissinger, suggère une stratégie pour le cas où les Iraniens ne tiendraient pas leurs nouveaux engagements. Il faudrait, écrit-il, « vivre avec le programme iranien » non pas vivre bras croisés mais en y répondant par l’organisation d’une dissuasion et l’imposition de sanctions économiques susceptibles de mettre en difficultés les actuels dirigeants iraniens sur leur scène intérieure.
La dissuasion, d’abord, consisterait, d’une part, à faire savoir à l’Iran que tout usage d’armes nucléaires, fourniture de matériels nucléaires à des groupes terroristes et mise en alerte de ses éventuelles forces nucléaires provoquerait une réponse « dévastatrice » et, d’autre part, à installer des systèmes de défense anti-missiles sur le territoire des voisins de l’Iran et à leur offrir des garanties de sécurité afin qu’ils ne se dotent pas, à leur tour, de la bombe.
Quant aux sanctions telles que les propose Richard Haas, elles devraient s’accompagner, dit-il, d’explications données à la population iranienne pour lui faire valoir qu’on ne lui dénie pas le droit au nucléaire civil mais militaire et qu’elle pourrait bénéficier d’un bien meilleur niveau de vie sans ce programme atomique. Clairement exprimée, l’idée est que cette bataille politique, une bataille de propagande, pourrait conduire, à terme, à l’arrivée au pouvoir d’une coalition « plus raisonnable » de religieux, de réformateurs et d’officiers de l’armée nationale avec laquelle il serait possible d’être plus à l’aise, même si elle conservait l’option nucléaire. Les Etats-Unis se préparent, au cas où.
|
Re: Géopolitique 16 octobre 2009, 02:55 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le double jeu pakistanais
C’est devenu quasiment quotidien, la routine pakistanaise. Hier encore, Lahore, la capitale intellectuelle de cette puissance nucléaire de près de 170 millions d’habitants, a été le théâtre de trois attaques simultanées contre des bâtiments de la police. Bilan : 28 morts auxquels il faut ajouter onze autres victimes d’un attentat commis dans le nord-ouest du pays.
Il y a trois jours, c’est un convoi des forces de sécurité qui était attaqué dans la vallée du Swat dont les autorités avaient théoriquement repris le contrôle avant l’été. Bilan : 41 morts. Trois jours plus tôt, le 10 octobre, c’est un quartier général de l’armée qui était pris d’assaut à Rawalpindi dans un coup de main spectaculaire qui aura fait vingt morts. La veille, le 9, un attentat suicide faisait plus de 50 morts à Peshawar et c’est, au total, quelque 160 personnes qui ont péri en onze jours dans cette vague d’attentats islamistes qui secoue le Pakistan.
Il y a trois explications à cette vague de terreur. Conjoncturelle, la première est que les islamistes pakistanais, très liés à al Qaëda, veulent dissuader les autorités de lancer l’offensive d’envergure qu’elles disent préparer contre eux dans le Waziristan du Sud. Voyez, disent ces attentats, ce que nous pourrions faire dans tout le pays si vous mettiez ce projet à exécution.
C’est un avertissement, des tirs de sommation, mais on aurait tort de s’arrêter à cet aspect des choses. Bien au-delà de ce moment du bras de fer permanent entre le pouvoir central et les islamistes se pose, d’abord, le problème de l’extraordinaire ambiguïté politique de ce pays. Créé, après guerre, par les Britanniques au moment où ils se retiraient des Indes, afin d’offrir aux musulmans du sous-continent le « foyer national » auquel ils aspiraient depuis le début du siècle, le Pakistan est un Etat jeune et largement artificiel, constitué de populations autochtones et de dizaines de millions de personnes venues des régions indiennes, tout à la fois une mosaïque de peuples et un mélange des populations rurales et d’une intelligentsia particulièrement sophistiquée, celle-là même qui avait conçu ce projet national.
Le Pakistan n’a ainsi que deux seuls vrais ciments, l’islam qui est son identité et la peur de l’Inde, de cet immense voisin en plein boom économique et technologique que les Pakistanais regardent toujours comme un pays revanchard qui voudrait récupérer ses provinces perdues. Ce sont ces deux ciments qui font que les services secrets pakistanais utilisent et combattent à la fois les islamistes. Ils veillent à les canaliser mais s’en servent pour frapper l’Inde et tirer les ficelles en Afghanistan, pays que les services pakistanais considèrent comme une arrière-cour leur offrant une profondeur stratégique face aux Indiens. Alliés du Pakistan, empêtrés en Afghanistan, les Etats-Unis exigent la mise au pas de ces islamistes mais, sur fond de dégradation de la situation afghane, leurs protecteurs des services veulent à la fois faire mine de donner satisfaction à l’Amérique en s’attaquant à eux et se garder cette armée de réserve en donnant à voir sa puissance.
|
Re: Géopolitique 19 octobre 2009, 10:52 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'imbroglio balouitche
Au sud-est du pays, le Baloutchistan est une province iranienne, limitrophe du Baloutchistan pakistanais. C’est là qu’un attentat contre les Gardiens de la révolution, le bras armé du régime, la force militaire qui tend à prendre le pas sur le clergé, a fait 42 morts dont plusieurs haut gradés et le général Shoustari, patron d’un corps d’élite en charge des opérations étrangères et du soutien aux mouvements libanais et palestinien liés à l’Iran.
Pour le régime, c’est une gifle que les Gardiens ont aussitôt promis de venger de façon « dévastatrice ». C’est une humiliation que le président de la République en personne, Mahmoud Ahmadinejad, a qualifiée de « crime contre l’humanité » dont « nous allons, a-t-il dit, nous occuper sérieusement » mais, question, qui était derrière cet attentat ?
La réponse est, a priori, claire puisqu’il a été revendiqué, affirme la presse iranienne, par les Jundollahs, petit groupe terroriste extrêmement actif depuis quatre ans et qui dit lutter contre le « génocide » dont serait victime la population baloutche, minorité sunnite effectivement tenue en suspicion par ce pays à majorité chiite. Les Jundollahs, les Soldats de Dieu, ont déjà plusieurs coups de main spectaculaires à leur actif dont, en décembre 2005, une tentative d’assassinat de Mahmoud Ahmadinejad durant une visite au Baloutchistan et un attentat kamikaze contre une mosquée chiite de cette province qui avait fait 25 morts, le 28 mai dernier.
La cause parait entendue mais les Gardiens de la révolution et l’état-major de l’armée nationale ont très vite accusé, hier, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne de soutenir les Jundollahs qu’ils « organisent, ont-il dit, aident et équipent ».
Il y a là une part de vérité car, au milieu de cette décennie, au moment même où les Jundollahs sont passés à l’action, plusieurs services occidentaux avaient entrepris de déstabiliser le régime de Téhéran en aidant les minorités iraniennes, notamment baloutche, vivant aux frontières du pays. Il est difficile de savoir jusqu’à quel point cette stratégie a réellement été développée mais, en tout état de cause, il serait très peu vraisemblable que les services britanniques ou américains soient derrière l’attentat d’hier puisque les Etats-Unis, dans l’espoir d’arriver à un compromis avec l’Iran, viennent de couper les budgets dévolus à la propagande politique destinée à la population iranienne et que les Occidentaux sont suspendus au rendez-vous qu’ils ont aujourd’hui, à Vienne, avec des représentants de Téhéran qui doivent y préciser les ouvertures faites à Genève, au début du mois, par leur gouvernement.
Si les Jundollahs n’ont pas agi seuls, c’est bien plutôt du côté des taliban pakistanais et afghans qu’il faudrait regarder. Pour gagner l’Europe, le trafic de drogue dont ils vivent passe par le Baloutchistan où il se heurte à la police iranienne. Ce sont eux, surtout, qui auraient toute raison de s’inquiéter d’une éventuelle détente entre les Etats-Unis et l’Iran qui pourraient, alors, œuvrer ensemble, contre les taliban, dans la bataille afghane.
|
Re: Géopolitique 20 octobre 2009, 02:11 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le nouvel arc de crise
Peut-être faudrait-il oublier les mots de « Proche-Orient ». Pour parler de la zone où se concentrent les problèmes les plus brûlants du monde, sans doute faudrait-il plutôt utiliser la dénomination d’« Asie du sud-ouest », région dans laquelle les atlas englobent non seulement Israël et ses voisins arabes mais aussi l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan et l’Inde – l’ensemble des pays qui font aujourd’hui l’actualité internationale dans une rare et inquiétante complexité.
Qu’on en juge. A Washington, le sujet de l’heure est la présidentielle afghane du mois d’août. La fraude y a été telle que la réélection d’Hamid Karzaï ne pourrait plus être confirmée sans susciter de nouvelles divisions afghanes Un second tour s’impose. Il serait impossible de ne pas l’organiser mais on ne pas non plus le faire avant que les neiges ne bloquent des régions entières. Il faudrait attendre le printemps, autrement dit reporter à de longs mois l’urgence qu’est le déploiement d’une nouvelle stratégie de l’Otan dans ce pays et les Occidentaux font donc le forcing auprès d’Hamid Karzaï et de son rival, Abdullah Abdullah, pour qu’ils acceptent de gouverner ensemble.
On devrait savoir ce qu’il en est dans la journée mais, si les Occidentaux en sont à rêver de cet expédient, ce n’est pas seulement qu’ils sont en passe de perdre cette guerre. C’est également qu’ils craignent que l’Afghanistan n’emporte le Pakistan dans sa tourmente puisque taliban pakistanais et afghans s’épaulent dans leurs pays respectifs, que les militaires pakistanais voudront reprendre pied en Afghanistan si un vide s’y créait car ce pays n’est pour eux que leur arrière-cour, une profondeur stratégique à opposer à l’Inde rivale, et que les tensions entre l’Inde et le Pakistan, deux Etats nucléaires, en seraient immédiatement ravivées.
Les Etats-Unis veulent reprendre en mains « l’Afpak », comme ils désignent désormais l’ensemble pakistano-afghan, et c’est pour cela qu’ils ont pratiquement obligé l’armée pakistanaise à lancer l’offensive en cours contre les taliban dans cette région limitrophe de l’Afghanistan qu’est le Sud-Waziristan. Beaucoup de choses se jouent dans cette bataille mais plus au sud, là où la frontière occidentale du Pakistan longe l’Iran, se pose un nouveau problème, celui du Baloutchistan, à cheval sur les deux pays et virtuellement sécessionniste dans chacun d’entre eux.
C’est là qu’un groupe terroriste du Baloutchistan iranien, lié aux taliban de l’Afpak, a monté, dimanche, un attentat d’ampleur contre le pilier du régime iranien, les Gardiens de la Révolution. Sur cette frontière-là, les intérêts iraniens et américains convergent et c’est l’une des raisons pour lesquelles, aux dires même des Américains, les pourparlers sur le nucléaire ont progressé hier, à Vienne, entre Téhéran et les Occidentaux.
Toutes les parties le disent. Il y aurait eu un si « bon départ » que les discussions reprennent ce matin, dans quelques instants. Rien n’est encore réglé. Tout peut encore capoter mais une sauce, décidément, paraît prendre.
|
Re: Géopolitique 21 octobre 2009, 06:19 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le chaud-froid de Vienne
Les Iraniens freinent, mais sans rompre. Après une première journée, lundi à Vienne, de discussions encourageantes avec les grandes puissances, ils ont soudain multiplié, hier, les obstacles, jusqu’à rendre impossible la reprise des pourparlers avant la tombée de la nuit.
Tantôt, c’était la France dont ils récusaient la présence en invoquant de vieux contentieux datant d’il y a trente ans et qu’ils ressortaient du jour au lendemain. Tantôt, c’était l’extrême confusion de leurs propositions qui plongeait leurs interlocuteurs dans la perplexité. Non, contrairement à ce qu’ils avaient laissé entrevoir le 1ier octobre, à Genève, ils ne voulaient plus confier à la Russie l’essentiel de leurs stocks d’uranium pour l’enrichir à des fins civiles, à moins de 20%, et n’envisageaient plus que des opérations successives portant sur de petites quantités.
On était loin du geste clair qui pouvait rétablir la confiance, loin de la situation qui retarderait d’au moins un an la progression de l’Iran vers le nucléaire militaire, loin de la percée, donc, qui aurait pu permettre de marcher vers un grand compromis régional entre les Etats-Unis et la République islamique. Faute de réunion plénière, ces pourparlers tournaient aux apartés de couloir qui rendaient la situation encore plus illisible mais au moment même où l’on frôlait l’impasse, les discussions ont repris, bientôt qualifiées de « constructives » par les Iraniens qui ont été les premiers à annoncer qu’elles se prolongeraient aujourd’hui, « avec tous les pays concernés », ont-ils dit dans une formule signifiant qu’ils ne récusaient plus la France.
Essayons de comprendre. Première hypothèse, celle qu’avancent les plus pessimistes des diplomates européens, l’Iran se jouerait des grandes puissances. Il n’aurait laissé entrevoir un compromis, à Genève, que pour les enferrer dans des négociations qu’il n’aurait aucune intention de faire aboutir. Son objectif ne serait que de retarder l’application de nouvelles sanctions économiques par le Conseil de sécurité et sa tactique serait donc de ne pas rompre ces pourparlers mais, au contraire, de les faire durer en alternant le chaud et le froid.
C’est tout à fait plausible mais une autre hypothèse ne l’est pas moins. On peut tout aussi bien considérer que le rapprochement diplomatique entre les Etats-Unis et la Russie et le mécontentement populaire auquel se heurte le régime iranien depuis les élections frauduleuses du mois de juin ont conduit ses dirigeants à plus de réalisme. Ils ne voudraient pas risquer d’affronter en même temps une fronde intérieure persistante et des sanctions économiques qui pourraient la nourrir. Ce régime aurait également compris que les Etats-Unis ont besoin de trouver un compromis avec lui. C’est la carte qu’il jouerait depuis septembre mais avec d’autant plus de lenteur, et d'à-coups, que le pouvoir iranien est profondément divisé et que les instructions données à ses négociateurs peuvent ainsi varier d’heure en heure. Il n’y a pas de certitude. On ne sait pas et, pour ne rien simplifier, ces deux hypothèses ne s’excluent pas.
|
Re: Géopolitique 22 octobre 2009, 09:13 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les deux interrogations afghanes
Ce sera donc le 7. Ce devrait, du moins être le 7 novembre que se tiendra le second tour de la présidentielle afghane puisque le président sortant, Hamid Karzaï, a fini par admettre que le premier tour avait été entaché de fraudes massives et que la victoire qui lui avait été initialement reconnue restait à confirmer.
Toutes les capitales de l’Otan l’en ont applaudi. Toutes sont soulagées qu’il ait enfin cédé à leurs pressions et les ait ainsi sorti d’une alternative impossible, soit ne pas reconnaître son élection et démultiplier le chaos afghan, soit la reconnaître et non seulement se faire complices d’une fraude mais risquer aussi de nouveaux fractionnements du pays.
Les Etats-Unis et leurs alliés ont, en un mot, évité le pire, sauf… Sauf qu’il est à peu près impossible d’organiser ce second tour en si peu de temps, qu’on ne peut pas attendre plus longtemps puisque les neiges auront bientôt isolé des régions entières et que la participation, surtout, sera extrêmement faible, bien inférieure encore aux 38,7% du premier tour, car les Afghans n’ont aucune envie d’aller braver les embuscades des taliban pour prendre part à un vote dont les résultats, cuisinés une première fois, pourraient l’être une seconde fois.
Ce second tour dont on se félicite tant est, en réalité, mal parti et c’est pour cela que, dans l’ombre mais si activement que cela se sait, les diplomaties occidentales cherchent à arracher à Hamid Karzaï et à son concurrent, l’ancien ministres des Affaires étrangères Abdullah Abdullah, un compromis, une forme ou l’autre de partage du pouvoir, qui dispenserait de retourner aux urnes.
Officiellement, chacun d’eux refuse et l’a publiquement dit mais les tractations se poursuivent. Tout a un prix, non pas financier, ce serait trop gros, trop risqué, mais politique puisque chacun des deux rivaux pourrait trouver avantage à se faire reconnaître une légitimité par l’autre, celle de président et celle de chef d’une opposition légale qui serait, par exemple, associée aux grandes décisions avec une sorte de droit de veto ou d’avis au moins. Rien n’est joué. On verra.
Parallèlement, d’autres tractations se poursuivent à Washington, à la Maison-Blanche comme au Congrès, sur la stratégie que les Etats-Unis devraient adopter. Les militaires réclament des renforts, 40 000 hommes de plus qui viendraient s’ajouter aux 36 000 qui ont déjà vainement étoffé les rangs américains depuis le début de l’année.
Le vice-président, Joe Biden est contre. Il prône, lui, un simple redéploiement des troupes à la frontière pakistanaise, voire des deux côtés de cette frontière, afin de couper l’aide que les taliban afghans reçoivent des taliban pakistanais, d’empêcher leurs coups de main communs et d’interdire les replis en territoire pakistanais, dans ces zones incontrôlées qui sont, en ce moment même, le théâtre d’une violente bataille entre les insurgés et l’armée pakistanaise. La réponse de Barack Obama se fait un peu attendre.
|
Re: Géopolitique 28 octobre 2009, 15:40 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Entre Paris et Berlin, une « relation unique »
Sitôt président, Nicolas Sarkozy avait rendu visite à Angela Merkel. Sitôt qu’elle se sera officiellement succédée à elle-même, Angela Merkel dînera, ce soir, à l’Elysée. La chancelière rend une politesse au président mais, bien au-delà de la simple courtoisie, ce geste de réciprocité marque une volonté commune de…
Non ! Ce mot de « relance », relance du couple franco-allemand, qui vient naturellement aux lèvres est banni du vocabulaire officiel. A Paris comme à Berlin, on travaille depuis le début de l’été à une affirmation de la coopération économique et politique entre les deux pays, ce travail est devenu intense ces dernières semaines, mais ce n’est pas sous le signe de la relance mais de l’« approfondissement » que cet effort est placé et cette différence sémantique a ses raisons.
La première est que Paris et Berlin tiennent aujourd’hui tant à œuvrer en commun que l’heure n’est pas à rappeler, fût-ce en creux, qu’il y eut un temps où Nicolas Sarkozy regardait plus vers la Grande-Bretagne que vers l’Allemagne, plus attiré qu’il était par le libéralisme anglo-saxon que par le capitalisme rhénan. Il y eut un temps où son tropisme était plus atlantique qu’européen mais la crise est venue et ces temps-là sont désormais mis sur le compte de la période de rodage qui a, c’est vrai, toujours commencé par gripper la relation entre deux nouveaux dirigeants français et allemand.
Cela ne compterait pas, n’aurait jamais compté, et il y aurait d’autant moins lieu de parler d’une « relance » que la bonne entente entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy s’est déjà manifestée dans la préparation du G-20, dans son déroulement, sur l’Iran, le Proche-Orient et la plupart des grands dossier internationaux.
Ce choix du mot d’« approfondissement » veut ainsi dire qu’il n’y aurait pas de changement de cap alors même qu’il y en a un mais opéré, c’est encore vrai, depuis l’hiver dernier. Quant à la seconde raison de ce choix, autrement plus réelle, elle est que, dans une Union à 27, il serait extrêmement maladroit de sembler vouloir relancer le couple franco-allemand, en revenir à l’époque où cette locomotive emmenait l’Europe où elle le souhaitait. Cela risquerait de créer des méfiances, de froisser des susceptibilités nationales, de susciter, sans doute, des coalitions adverses dont l’Union n’a nul besoin. Va donc pour « approfondissement », même s’il s’agit bel et bien d’une relance.
Bien qu’on y pense beaucoup, on ne va pas se ruer sur des gestes aussi spectaculaires qu’une participation d’un représentant allemand au Conseil des ministres français et vice-versa mais l’idée est de coordonner les politiques des deux pays, au sein de l’Union, sur la scène internationale et dans les domaines financier, économique, industriel avec la volonté, notamment, de promouvoir une « ambition industrielle pour l’Europe », autrement dit de la réindustrialiser. La nouvelle coalition allemande parle aujourd’hui d’une « relation unique » entre la France et l’Allemagne, d’une relation qui se veut, en clair, déterminante.
|
Re: Géopolitique 02 novembre 2009, 08:14 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
" La fin du communisme : 1) Le rapport Khrouchtchev"
Toute cette semaine, vous consacrez votre chronique à la fin du communisme...
Une anecdote, d’abord, pour ouvrir cette série de cinq chroniques consacrées à l’histoire, étapes et causes, de l’effondrement communiste. Correspondant du Monde en URSS, j’étais en Arménie lorsque le Mur est physiquement tombé. Je venais d’enquêter sur la montée de l’indépendantisme dans cette République soviétique. J’avais passé la nuit à écrire et lorsqu’on me passe la communication téléphonique pour Paris et que j’annonce à la sténo que j’avais dix feuillets à lui dicter, il y a un silence au bout du fil : « L’Arménie … ? Avec ce qui s’est passé cette nuit ? … ».
Il n’y avait à l’époque ni internet ni CNN, pas à Erevan en tout cas. Je ne savais rien et quand la sténo m’explique que le Mur venait de tomber, je lui rétorque, excédé : « Et alors ? ». Je ne l’avais pas dit que je rendais les armes -les symboles ont du poids en politique-. J’ai ravalé mon papier mais cet « Et alors ? » avait un sens. Il y a avait des semaines que la Hongrie laissait passer les Allemands de l’Est à l’Ouest. Six mois plus tôt, la télévision soviétique avait retransmis en direct, les premiers débats du premier parlement soviétique, le soviet suprême, élu au terme d’élections partiellement libres. Vissée aux petits écrans, toute l’URSS avait entendu des opposants, Sakharov en tête, dénoncer la corruption, l’impéritie, l’injustice, les crimes du communisme.
En août, en Pologne, Tadeusz Mazowiecki était devenu le premier Premier ministre non-communiste du bloc soviétique. Il y avait longtemps que le soviétisme se mourait, que le Mur était déjà tombé. On en n’était plus là mais au délitement de l’URSS elle-même. Un correspondant n’avait qu’à ouvrir ses yeux et ses oreilles pour le constater et il fallait la chute physique du Mur pour qu’on veuille bien croire que ce qu’on refusait de croire se passait bel et bien ?
Comme toujours, la croyance générale en l’immortalité du communisme empêchait de voir les faits alors même que tout n’avait cessé de bouger, depuis 1956 au moins, dans ce monde opaque qui n’était pourtant pas illisible.
Février 1956, c’est le rapport que Nikita Khrouchtchev présente devant le XX° Congrès du parti soviétique, devant une salle pétrifiée dans laquelle on entend bientôt plus que des sanglots, que le bruit sourd de personnes tombant évanouies de leurs chaises car, avec ce rapport, Khrouchtchev prononce le plus accablant des réquisitoires contre Staline, mort trois ans plus tôt après avoir été, durant un quart de siècle, le pape et le César du monde communiste, vénéré, adulé sur les cinq continents.
Tout y passe, les déportations de peuples entiers, la répression de masse, les exécutions sans procès, les « monstrueuses falsifications » qui avaient permis le massacre des premiers communistes et, en juin suivant, ce texte finit par être connu du monde entier. Dès lors, toute l’histoire du bloc soviétique ne sera plus qu’une lente et longue hésitation entre des réformes qui menacent d’ébranler tout le système et un statu quo qui le condamne à une sclérose mortifère face à la compétition économique, scientifique, sociale, du monde capitaliste.
Quelques mois après ce rapport, la Pologne et la Hongrie vont bouger, suscitant les deux premières grandes crises du bloc mais on en parle demain.
|
Re: Géopolitique 03 novembre 2009, 01:04 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
"La fin du communisme : 2) Les graines hongroises et polonaises"
Les magasins étaient pleins. On y venait se fournir de toutes les autres démocraties populaires. Du matin au soir, des embouteillages de Mercedes d’occasion rachetées en Autriche et en Allemagne bloquaient le cœur de Budapest, la capitale. Pour un journaliste découvrant la Hongrie en 1978, ce pays était presque incompréhensible tant il était moins sinistre et plus riche que le reste du bloc soviétique, Pologne, Tchécoslovaquie ou Roumanie. Janos Kis, la tête pensante de la dissidence hongroise, avait alors entrepris de me l’expliquer.
« En 1956, avait-il commencé, ... ». Tiens ! Ici aussi, tout avait donc commencé en 56, comme en Pologne où, à chaque fois que je demandais à un responsable du parti, un dignitaire catholique, une figure de la dissidence, un ouvrier, un étudiant, comment il se pouvait qu’il règne, de fait, un tel pluralisme dans un pays communiste, tous répondaient aussi : « En 1956… ».
En Pologne comme en Hongrie, 1956 fut une année de révolutions. La dénonciation des crimes de Staline par Khrouchtchev devant le XX° congrès du parti soviétique y avaient bientôt provoqué tout à la fois une ébullition puis des troubles socio-politiques et un retour en grâce de communistes réformateurs, Wladislaw Gomulka à Varsovie, Imre Nagy et Janos Kadar à Budapest, qui avaient tous été éliminés, emprisonnés, torturés au temps de la répression stalinienne et qu’on laissait revenir en scène pour tenter de sauver la situation.
Aux débuts, il y eut un profond parallélisme entre l’éveil de ces deux pays qui se prêtaient la main dans l’audace mais, très vite, tout les sépara. En Pologne Gomulka sait jusqu’où ne pas aller trop loin. Avec l’aide de l’Eglise catholique et l’assentiment d’intellectuels communistes qui rêvaient, pourtant, de démocratie, il parvient à canaliser la contestation avant que l’URSS n’intervienne. En Hongrie, au contraire, débordé par la rue, Imre Nagy restaure le pluripartisme, parle de rompre l’alliance militaire avec Moscou et l’Armée rouge écrase l’insurrection hongroise dans le sang avant qu’Imre Nagy ne soit pendu, avec l’assentiment de Janos Kadar, devenu l’homme des Soviétiques.
L’URSS a sauvé son empire. La déstalinisation a montré ses limites mais tout n’en pas moins changé dans ces deux pays. En Pologne, Gomulka offre des marges de liberté d’expression à l’Eglise et aux intellectuels qui l’ont aidé à trouver un compromis avec Moscou. En Hongrie, Janos Kadar tente de faire oublier le bain de sang auquel il avait acquiescé en lançant, dès les années soixante, les réformes économiques qui vont faire de son pays la « baraque la plus gaie du camp », comme on dit alors. C’est de ces marges de liberté polonaises que naîtra Solidarité en 1980. C’est de ces réformes hongroises que s’inspirera, en 1985, la première phase de la Perestroïka soviétique. C’est de 1956 et de ces deux pays que sont provenus l’appel d’air et les changements sourds qui provoquèrent, en 1989, l’implosion soviétique. Lent mouvement de plaques tectoniques, la chute du mur de Berlin s’était amorcé 33 ans plus tôt mais il y eut – ce sera la suite de cette série – bien d’autres moments clé.
|
Re: Géopolitique 04 novembre 2009, 05:15 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
"La fin du communisme : 3) la génération cachée des soixantards"
Embonpoint, âge avancé, chapeaux, écharpes et manteaux gris, il y avait un profil du dirigeant soviétique. Jusqu’à l’arrivé au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, en 1985, l’URSS était une gérontocratie mais elle n’était pas que cela. A l’ombre du Kremlin, l’immeuble du Comité central, siège de ses commissions et de ses fonctionnaires, cachait une tout autre espèce d’hommes dans ses bureaux aux portes capitonnées.
Les initiés les appelaient les « soixantards », la génération des années soixante durant lesquelles ils avaient fini leurs études et commencé de monter dans l’appareil, et c’est cette génération qui a soutenu Mikhaïl Gorbatchev, fait la Perestroïka, présidé, en un mot, à cette étrange reddition pacifique du soviétisme qu’on date de la chute du mur de Berlin, il y aura vingt ans lundi. L’un d’eux, Andreï Gratchev, dernier porte-parole du dernier président de l’URSS, était dans ce studio lundi mais qui étaient ces hommes, tellement méconnus mais au rôle si fondamental ?
Tout jeunes gens à la mort de Staline, ils avaient cru aux promesses du XX° Congrès, à la déstalinisation lancée par Khrouchtchev et à ce dégel qui avait vu les prisonniers politiques revenir du Goulag et la censure se desserrer au point d’autoriser la publication des premières œuvres de Soljenitsyne. Ils avaient alors cru à une démocratisation du régime, lente, progressive mais dont, après tout, les premiers signes étaient là et puis…
Et puis non ! La tragédie hongroise de 1956, l’éviction de Khrouchtchev en 1964, l’arrivée aux manettes de vieillards dont l’obsession était que rien ne bouge, l’abandon de toute idée de réforme économique, le retard technologique que prenait leur pays et, surtout, le déferlement de chars sur le Printemps de Prague, sur ce « socialisme à visage humain » qui les avait fait tant vibrer, leur avaient ôté tout espoir de voir quoi que ce soit changer de leur vivant.
Fonctionnaires du comité central, ils étaient des rouages fondamentaux du système mais entre eux, en liaison avec les grands instituts d’où sortait l’élite soviétique, ils furent également ceux qui avaient ouvert des pistes, favorisé le renforcement de la détente et préparé, à tout hasard, sans y croire, la boîte à idées dans laquelle allait puiser Gorbatchev. Les soixantards furent les collaborateurs naturels, enthousiastes, de cet homme qu’ils avaient espéré sans croire à sa venue.
Sans eux, Gorbatchev aurait été plus seul encore et… Une anecdote. Après la chute du mur, grande réunion européenne à Prague. J’y retrouve Jiri Pelikan, ancienne figure du Printemps. L’ambassadeur russe, un soixantard de mes amis, arrive, marche vers nous et, alors que j’allais faire les présentations, ils tombent dans les bras l’un de l’autre et s’embrassent. C’était l'ambassadeur, que j’avais connu à la section internationale du comité central soviétique, qui avait fait franchir à Pelikan les lignes russes, dans le coffre de sa voiture, lorsqu’il s’était résolu à passer à l’Ouest. Tous deux étaient des soixantards. Le monde soviétique était plus complexe qu’il n’y paraissait mais, pour que ces hommes brisent le système, il avait fallu de grands ébranlements, sujets des prochaines chroniques.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.