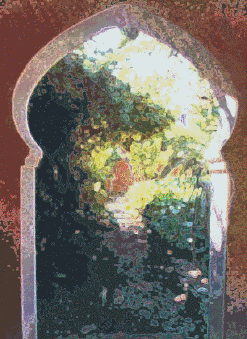|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 05 novembre 2009, 06:18 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
"La fin du communisme : 4) De Kabul à Gdansk"
Le mur de Berlin n’est pas tombé comme les murailles de Jéricho. La mort du soviétisme s’inscrit dans une histoire longue que cette série de chroniques tente d’éclairer depuis lundi, mais il y eut un moment décisif dans ce lent processus. Tout s’est joué entre Kabul et Gdansk, en neuf mois, entre décembre 1979 et août 1980.
Dans ce partage du monde qu’avait suscité la Guerre froide, l’Afghanistan était une zone grise, une Finlande de l’Asie, l’un de ces rares pays qui n’appartenait à aucun des deux blocs et savait assez ménager leurs intérêts respectifs pour les tenir l’un et l’autre à distance. La Finlande était proche des Occidentaux mais en bons termes avec l’URSS. L’Afghanistan était en bons termes avec les Occidentaux mais proche de l’URSS jusqu’à ce qu’un coup d’Etat, en 1973, y fasse pencher la balance vers ce qu’on appelait le monde libre. Le Kremlin ne pouvait pas le tolérer. En 1978, il appuie un contre coup qui place l’Afghanistan dans son orbite mais comme la situation créée est incertaine, comme les hommes de Moscou perdent rapidement pied à Kabul, l’Armée rouge entre en Afghanistan en cette fin d’année 1979.
Ce pays deviendra bientôt le Vietnam de l’URSS, son bourbier militaire, mais les dégâts politiques sont immédiats. Le monde musulman où le Kremlin comptait de nombreux amis grâce à sa rupture avec Israël est aussitôt vent debout. Beaucoup plus proche, pourtant, de Moscou que de Washington, le mouvement des non-alignés dénonce cette intervention. Pour l’URSS qui perd, là, d’un coup, la sympathie du tiers-monde, c’est une Berezina diplomatique. L’URSS vient de commettre une erreur fatale qui modifie profondément son image internationale. Elle n’est plus l’amie, le soutien, des « damnés de la terre » et, là-dessus, la classe ouvrière polonaise se retourne contre elle.
Parti des chantiers navals de Gdansk, des chantiers Lénine, un mouvement de grève s’étend en dix jours à toute la Pologne. Le mouvement est tellement massif que le parti polonais doit accepter, en août 1980, la création d’un syndicat indépendant qui comptera vite dix millions de membres. Le monde découvre alors que le communisme est rejeté – et avec quelle force… – par cette classe ouvrière au nom de laquelle il dit exercer sa dictature, celle du prolétariat. En neuf mois, le soviétisme aura été désavoué à la fois par les pays décolonisés et par le monde ouvrier.
Plus grave encore, l’URSS ne pourra reprendre en mains la Pologne qu’en s’y appuyant non pas sur le parti dont la base a rejoint Solidarité mais sur les militaires et un général, Wojciech Jaruzelski, dont les lunettes noires évoquent irrésistiblement celles de Pinochet. Avec ses magasins vides et son retard technologique, le soviétisme vient, en plus, de perdre la bataille idéologique. Il ne reste plus rien des mythes politiques sur lesquels il s’appuyait. Ses dirigeants, de surcroît, n’en finissent plus de mourir, l’un après l’autre. C’est l’heure du benjamin du Bureau politique, Mikhaïl Gorbatchev qui deviendra le dernier président de l’URSS, le dernier car il n’y aura, bientôt, plus d’Union soviétique.
|
Re: Géopolitique 06 novembre 2009, 06:17 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
"La fin du communisme : 5) Le rôle de Gorbatchev"
Tout menait le soviétisme à sa fin. C’est ce que cette série de chroniques tente de montrer depuis lundi. Tout l’y menait parce que son échec économique était patent, qu’il avait pris un retard technologique pratiquement irréversible sur l’Occident et que, depuis 1956 et la déstalinisation, son histoire se résumait à des révoltes à répétition et une constante hésitation, surtout, entre la nécessité de réformes et la crainte qu’elles ne provoquent une implosion du système.
Lorsqu’il a fini par mourir, le soviétisme était à l’agonie depuis 1956, une agonie qu’avaient précipitée Solidarité et l’aventure afghane, mais sa mort aurait pu être autrement plus longue et sanglante qu’elle ne l’a été. Le miracle est qu’il ait rendu les armes sans vaine résistance et ce miracle on le doit à un homme, Mikhaïl Gorbatchev, que la quasi-totalité des soviétologues comprenaient si peu qu’ils avaient fini par le qualifier d’« accident génétique » dans la lignée des successeurs de Lénine, ce qui constituait une formidable erreur d’analyse.
Gorbatchev aura tout simplement été un homme de son temps, un homme de cette génération de l’élite soviétique dont on parlait avant-hier, celle des soixantards, arrivés à l’âge adulte à la mort de Staline, aux premières responsabilité dans les années soixante, et qui avaient cru au dégel avant de voir toutes leurs espérances de changement déçues. Gorbatchev savait que l’URSS était à bout de souffle. C’est pour cela que le Bureau politique s’était résigné à le porter à la tête du parti.
Gorbatchev savait que l'Europe centrale dansait avec la crise et qu’il ne serait plus question d’y envoyer des chars rétablir l’ordre sans risquer de vraies guerres. Il le savait tellement qu’il avait immédiatement entrepris des réformes économiques et averti les dirigeants des Démocraties populaires qu’ils ne pouvaient plus compter sur l’Armée rouge.
Perestroïka puis Glasnost, réformes économiques puis politiques, libéralisation de la presse dès 1987 et élections pluralistes au printemps 89, six mois avant la chute du Mur, Gorbatchev est allé vite sur la voie des réformes mais autant il savait ce dont il ne voulait plus et ce qui n’était plus possible, autant il ne savait pas où cet indispensable changement pourrait mener. Son dernier porte-parole, Andreï Gratchev, l’explique très bien dans une interview que Marianne publie demain. Gorbatchev, dit-il, « voulait autre chose que le stalinisme, autre chose que l’absurdité d’une gestion nomenklaturiste et incompétente. Il ne savait pas quel serait le point final mais savait ce qu’il voulait éviter. Il ne voulait pas recourir à la force. Il croyait à la loi, à l’état de droit. Il était convaincu qu’on était entré dans l’histoire universelle et que l’humanité était obligée de chercher des réponses collectives à des défis, énergétiques ou écologiques, dépassant les frontières des Etats. Il croyait, enfin, que la justice sociale et la démocratie pouvaient fournir de meilleures réponses que celles du capitalisme libéral ».
Convaincu de la faillite soviétique, décidé à rendre impossible le retour en arrière, Gorbatchev était un social-démocrate qui a échoué et un pacifiste qui a réussi.
|
Re: Géopolitique 10 novembre 2009, 07:01 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Rien n’est plus difficile à écrire que l’histoire.
Il y a les faits, bien sûr, grandes dates, grands événements, mais il ne suffit pas de les connaître pour les comprendre. Il faut arriver, aussi, à les remettre dans leur contexte, dans l’histoire longue et, là, tout se complique. Parce que chaque époque cherche à en tirer ses propres enseignements et que chacun y cherche ses justifications, l’histoire est sujette à polémiques et celle de la fin du communisme ne fait pas exception à cette règle.
En marge des cérémonies du 20ième anniversaire de la chute du mur de Berlin, Lech Walesa s’est ainsi dit « terrifié » du « mensonge » qui serait, à l’en croire, en train de s’imposer. « On fait des héros de ceux qui ne l’ont pas été, a déclaré le fondateur et ancien président de Solidarité. Gorbatchev n’a jamais voulu renverser le Mur ni le communisme, a-t-il ajouté, et si l’on présente les choses ainsi, on édifie l’Europe sur un mensonge et cela me terrifie ». Pour Walesa, la fin du communisme est due pour 50% à Jean-Paul II, pour 30% à Solidarité et à lui-même et pour 20% au « reste du monde » sans plus de précision. C’est dit, c’est clair mais, au même moment, Angela Merkel, chancelière allemande venue de l’Allemagne de l’est, remerciait Mikhaïl Gorbatchev, présent à ses côtés comme Lech Walesa, en lui disant : « Vous avez rendu cela possible. Vous avez courageusement laissé les choses arriver et c’était bien plus que ce que nous pouvions attendre ».
Il y a là deux narrations d’une même histoire, l’une et l’autre fondées. Sans l’élection d’un pape polonais, sans le « n’ayez pas peur » lancé par Jean-Paul II sitôt après son intronisation, sans son premier voyage de souverain pontife sur sa terre natale et la manière dont il avait rassemblé son peuple derrière lui en lui disant de ne pas être contre mais d’être pour, non pas contre le communisme mais pour la liberté, le monde ne se serait pas souvenu que l’Europe soviétique était aussi l’Europe, la Pologne ne se serait pas vue unie dans son aspiration à la démocratie, Solidarité ne serait pas née, pas aussi vite en tout cas, et la Pologne n’aurait pas ainsi sonné le tocsin du soviétisme.
Lech Walesa a raison mais si ce n’était pas Mikhaïl Gorbatchev que le parti soviétique avait porté à sa tête lorsque toute la génération brejnévienne se fut éteinte, si cet homme n’avait pas appartenu à cette génération soviétique dont tous les espoirs de changement avaient été déçus depuis 1956, s’il n’avait pas été décidé à sortir la Russie de son impasse et à refuser la violence quoi qu’en coûtât, s’il n’avait pas lancé le signal du changement dans tout le bloc et pressé les dirigeants de l’Europe communiste de suivre son exemple, non, le Mur ne serait pas tombé, pas si vite en tout cas et pas aussi pacifiquement surtout.
Walesa comme Gorbatchev, chacun a joué son rôle et s’il y a débat, c’est sur ce que l’on veut narrer : des révoltes populaires ou la sagesse du dernier président soviétique, la Pologne qui change le monde ou le Kremlin qui rend sa liberté à l’Europe centrale, une révolution ou une évolution. Ce fut tout cela en même temps mais il faudra beaucoup de temps et de recul pour chacun l’admette.
|
Re: Géopolitique 13 novembre 2009, 01:12 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
par Daniel Pipes
Jerusalem Post
28 octobre 2009
[fr.danielpipes.org]
Version originale anglaise: Turkey: An Ally No More
Adaptation française: Anne-Marie Delcambre de Champvert
« Il ne fait aucun doute qu'il est notre ami » a déclaré le premier
ministre de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à propos du
président de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, alors même qu'il
accusait le ministre des affaires étrangères d'Israël, Avigdor
Lieberman, de menacer d'utiliser des armes nucléaires contre
Gaza. Ces affirmations scandaleuses montrent un changement
profond dans l'orientation du gouvernement de la Turquie, depuis
six décennies le meilleur allié musulman de l'Occident, puisque le
parti AKP [ Parti de la Justice et du Développement] d'Erdogan
est arrivé au pouvoir en 2002.
Trois évènements survenus tout au long de ce mois révèlent
l'ampleur de ce changement. Le premier s'est produit le 11
octobre avec la nouvelle que l'armée turque- bastion de longue
date de la laïcité et défenseur de la coopération avec Israël- a
brusquement demandé aux forces israéliennes de ne pas
participer à l'exercice annuel de la Force aérienne [turque]«
L'aigle d'Anatolie ».
Erdogan a mentionné « les sensibilités diplomatiques » pour
justifier l'annulation et le ministre des Affaires étrangères, Ahmet
Davutoglu, a parlé de « sensibilité à propos de Gaza, Jérusalem-
Est et la mosquée d'Al-Aqsa ». Les Turcs ont explicitement rejeté les avions israéliens qui pourraient avoir
attaqué le Hamas ( une organisation islamiste), lors de l'opération de l'hiver dernier dans la bande de
Gaza. Alors que Damas approuvait la suspension de l'invitation, elle a incité les gouvernements américain
et italien à retirer leurs forces de « l'Aigle d'Anatolie », ce qui du coup signifiait l'annulation de l'exercice
international.
Quant aux Israéliens, ce changement « soudain et inattendu » a ébranlé jusqu'au plus profond leur
alignement militaire avec la Turquie, en vigueur depuis 1996. L'ancien chef des forces aériennes, Eytan
Ben-Eliahu, par exemple, a qualifié l'annulation d' " évolution profondément inquiétante ». Jérusalem a
immédiatement réagi en révisant la pratique qu'avait Israël de fournir à la Turquie des armes de pointe,
comme la vente récente, pour 40 millions de dollars à la Force aérienne turque, de missiles.
Une idée asurgi, celle d'arrêter d'aider les Turcs à faire échouer les résolutions sur le génocide arménien qui
régulièrement sont présentées devant le Congrès américain.
Barry Rubin, du Centre Interdisciplinaire de Herzliya,
non seulement soutient l'idée que « l'alliance israéloturque
est terminée » mais il conclut que les forces
armées de la Turquie ne défendent plus la république
laïque et ne peuvent plus intervenir lorsque le
gouvernement devient trop islamiste.
Le deuxième évènement a eu lieu deux jours plus tard,
le 13 octobre, lorsque le ministre des Affaires
étrangères de Syrie, Walid al-Moallem, a annoncé que
les Forces turques et syriennes venaient juste «
d'effectuer des manoeuvres près d'Ankara ». Moallem a
appelé à juste titre ceci une évolution importante « car
il réfute l'information sur les mauvaises relations entre
les institutions militaires et politiques en Turquie, à
propos des relations stratégiques avec la Syrie ».
Traduction : les forces armées de la Turquie sont
perdantes face aux politiciens.
Le troisième évènement , dix ministres turcs, dirigés par Davutoglu, ont rejoint leurs homologues syriens ,
le 13 octobre, pour des pourparlers sous l'égide du nouveau « Haut Conseil de Coopération stratégique
Turquie-Syrie ». Les ministres ont annoncé qu'ils avaient signé près de 40 accords, à mettre en oeuvre
dans les 10 jours ; que seraient réalisés des exercices militaires terrestres conjoints, plus complets et plus
approfondis que le premier qui s'était produit en avril et que les dirigeants des deux pays allaient signer un
accord stratégique en novembre.
En conclusion le Conseil a publié une déclaration conjointe annonçant la
formation d'un « partenariat stratégique durable » « entre les deux parties »
pour soutenir et élargir leur coopération dans un large éventail de questions
d'intérêt mutuel et pour renforcer les liens culturels et la solidarité entre
leurs peuples . « L'esprit du conseil » a expliqué Davutoglu « est un destin,
une histoire et un avenir communs ; nous allons construire ensemble l'avenir
» ; tandis que Moallem a appelé la réunion un « festival pour célébrer » les
deux peuples.
Les relations bilatérales ont en effet subi un revirement spectaculaire depuis
la décennie précédente, quand Ankara a été dangereusement près d'entrer
en guerre avec la Syrie. Mais l'amélioration des relations avec Damas ne
sont qu'une partie d'un effort beaucoup plus important d'Ankara pour
renforcer les relations avec les Etats régionaux et musulmans, une stratégie
énoncée par Davutoglu dans son livre influent paru en 2000 « Stratejik
derinlik : türkiye'nin uluslararasi konumu ( Profondeur stratégique : la
position internationale de la Turquie »
En bref, Davutoglu prévoit de réduire les conflits avec les voisins , la Turquie
émergeant comme une puissance régionale, une sorte d'empire ottoman
modernisé. Dans cette stratégie est implicite la distanciation de la Turquie,
de l'Occident en général et d'Israël en particulier. Même si ce n'est pas
présenté en termes islamistes « la profondeur stratégique » correspond étroitement à la vision du monde
du parti islamiste AKP.
Comme le note Barry Rubin, « le gouvernement turc est plus proche politiquement de l'Iran et de la Syrie
que des Etats-Unis et d'Israël ». Caroline Glick, éditorialiste du Jerusalem Post, va plus loin : Ankara a déjà
« quitté l'alliance occidentale et est devenue un membre à part entière de l'axe iranien. » Mais les milieux
officiels en Occident semblent presque inconscients de ce changement capital dans la loyauté
(l'allégeance) de la Turquie et de [l'importance de] ses implications.
Le coût de leur erreur deviendra bientôt évident.
|
Re: Géopolitique 16 novembre 2009, 15:13 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les deux craintes de l'Iran
L’espoir paraît s’évanouir. Entrevue début octobre, la possibilité d’un compromis international sur le programme nucléaire iranien s’amenuise de jour en jour, faute d’une réponse claire de Téhéran. Au rythme de trois ou quatre déclarations contradictoires par semaine, c’est tantôt « oui mais… », tantôt « non mais… », tantôt « oui, si… » mais jamais « oui », une telle confusion que Bernard Kouchner a fini par publiquement dire, hier, ce que toutes le chancelleries murmuraient depuis dix jours.
« Dans la pratique, a-t-il dit à un quotidien israélien, la réponse a été quasiment donnée et elle est négative. C’est dommage, dommage, dommage », a-t-il ajouté tandis que les présidents russe et américain, en marge du Forum économique Asie Pacifique, à Singapour, haussaient également le ton. « Jusqu’à présent au moins, l’Iran a malheureusement été incapable de dire « oui » et nous n’avons plus beaucoup de temps », a déclaré Barack Obama tandis que Dmitri Medvedev se faisait inhabituellement menaçant vis-à-vis de Téhéran en parlant « d’autres options ouvertes » si le processus de négociation n’aboutissait pas.
Citant l’entourage présidentiel, la presse russe affirmait, la veille, que le Kremlin était désormais « prêt à 100% » à soutenir de nouvelles sanctions contre l’Iran si la situation ne se débloquait pas. Pour peu que Russes et Américains parviennent, le mois prochain, à de nouveaux accords de désarmement et que leur rapprochement se confirme en conséquence, le régime iranien pourrait avoir à faire ainsi face à l’unanimité du Conseil de sécurité.
Le régime iranien perdrait alors le discret soutien que la Russie lui apportait en prêchant la patience à son égard. Les sanctions économiques internationales seraient durcies dans un moment de crise à Téhéran. Le mécontentement social s’ajouterait à cette fronde et ces protestations qui ne s’atténuent pas depuis le trucage des élections présidentielles de juin dernier.
Le pouvoir iranien est en train de se tirer dans le pied mais son incapacité à conclure ce compromis avec les grandes puissances qu’il avait lui-même souhaité n’est pas inexplicable. Ce pouvoir connaît les risques d’une épreuve de force mais ceux d’une détente ne sont pas moins grands pour lui et plus difficiles encore à parer car il y a une logique du compromis.
Dans l’hypothèse – qu’il n’a toujours pas formellement exclue – où il se résoudrait à apaiser les craintes internationales sur la vraie nature de son programme nucléaire, le régime iranien entrerait dans une logique de coopération avec les Etats-Unis, économique bien sûr mais aussi diplomatique. Il lui serait pratiquement impossible de refuser le développement d’échanges dont l’Iran aurait tellement besoin pour moderniser l’exploitation de ses réserves pétrolières et gazières. Il ne pourrait pas, non plus, repousser les offres américaines d’accords de sécurité fondés sur un apaisement des tensions régionales. Ce régime perdrait l’ennemi qui lui sert à justifier le maintien de sa rigueur intérieure. Il devrait, en un mot, s’ouvrir à un moment où il pourrait ne pas y survivre.
|
Re: Géopolitique 19 novembre 2009, 00:57 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Jeudi 19 novembre 2009
Le futur Président du Conseil de l'Europe
C’est lent, c’est dur, c’est compliqué l’Europe. Traité de Lisbonne aidant, voilà qu’elle aura maintenant un vrai président, non plus l’un de ses Etats membres qui la préside, à tour de rôle, pour six mois mais un homme ou une femme qui l’incarne sur la scène internationale pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois, pour cinq ans donc, en principe.
C’est mieux. Il n’y aura plus de secrétaire d’Etat américain pour demander, comme le faisait ironiquement Henry Kissinger, qu’on lui donne le numéro de téléphone de l’Europe, mais le mieux n’est jamais que relatif dans un ensemble qui se construit en marchant, pas à pas. Contrairement à celui qui préside la France ou les Etats-Unis, ce président ne présidera pas l’Union européenne mais le Conseil européen, l’assemblée des 27 chefs d’Etat et de gouvernements. Il ne sera pas nommé par l’électorat paneuropéen qui élit, lui, les députés européens, mais par ce conclave des dirigeants des Etats qui se réunissent ce soir à cet effet et dont la préoccupation n’est pas de choisir une personnalité forte, charismatique, si active et présente qu’elle puisse leur faire de l’ombre.
Jaloux de leur pouvoir et de leur aura personnelle, soucieux, surtout, de ne pas laisser l’Union prendre le pas sur ses Etats membres dont ils veulent préserver les prérogatives, ils cherchent bien plutôt un président de séance, un chairman dirait-on en anglais, qu’un président tout court. Il leur faut donc trouver à la fois quelqu’un qui ne fasse pas large tout en n’étant pas insignifiant ; venant si possible d’un petit pays pour qu’aucune des puissances européennes ne semble mettre la main sur l’Union ; plutôt quelqu’un du nord car le président de la Commission vient du sud et un conservateur puisque la majorité du conseil est de droite et que, par souci d’équilibre, le poste de Haut représentant, de ministre des Affaires étrangères de l’Union, ira à une personnalité de gauche.
Comme toujours, on cherche, en un mot, un plus petit commun dénominateur et, comme d’habitude, on le cherche dans d’obscures tractations entre Etats dont l’opacité ôte d’avance toute vraie légitimité au futur élu.
La France et l’Allemagne vont peut-être limiter la casse en soutenant un candidat commun mais, tant que les Etats membres, et une très large partie de l’opinion européenne derrière eux, n’auront pas renoncé à la suprématie des Etats dans l’Union, on en restera toujours à ces maquignonnages, plus ou moins risibles, tristement risibles. Tant qu’il n’y aura pas un mouvement de fond, dans les opinions comme parmi les élus, en faveur d’un pouvoir européen procédant de l’électorat paneuropéen, l’Union ne sera pas une vraie démocratie, proche de ses citoyens parce qu’il pourront y peser vraiment et comprendre son fonctionnement.
Comme dans toute fédération, il y aura toujours deux pouvoirs dans l’Union, pouvoir fédéral et pouvoir des Etats.
C’est logique mais, que ce soit à travers l’élection d’un président au suffrage universel ou de la Commission par le Parlement, comme dans toute fédération, les citoyens européens devraient pouvoir désigner un exécutif européen, président ou gouvernement.
|
Re: Géopolitique 19 novembre 2009, 01:10 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
18.11.09 - 20:57
L'Iran a annoncé mercredi son refus de transférer à l'étranger son uranium faiblement enrichi et a appelé à une nouvelle réunion à Vienne avec les grandes puissances, signifiant ainsi son rejet du projet d'accord proposé par l'AIEA il y a près d'un mois.
"Nous avons fait un examen technique et économique (...) Très certainement, nous ne transférerons pas à l'étranger notre uranium enrichi à 3,5%", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki, cité mercredi par l'agence Isna.
"Cela signifie que nous sommes prêts à examiner un échange simultané en Iran même", a-t-il ajouté.
Ces déclarations signifient que l'Iran refuse le projet d'accord tel que présenté par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) le 21 octobre après des négociations entre l'Iran, les Etats-Unis, la Russie et la France.
"Il y a une réponse très claire et négative des Iraniens", a commenté le ministre français Bernard Kouchner, tout en souhaitant "continuer à parler" avec Téhéran.
Selon des diplomates occidentaux, le projet d'accord prévoyait le transfert vers la Russie d'une grande partie de l'uranium iranien faiblement enrichi (3,5%), pour qu'il y soit enrichi davantage avant d'être transformé en France en combustible pour un réacteur de recherche à Téhéran.
"Nous avons un déficit de confiance", a expliqué à des journalistes à Vienne Ali Asghar Soltanieh, le représentant de l'Iran à l'AIEA. "Nous voulons être sûrs qu'il y ait la garantie qu'au bout du compte, nous recevrons du combustible pour le réacteur de recherches de Téhéran".
Mardi, le président américain Barack Obama, en visite à Pékin, et son homologue chinois Hu Jintao, ont appelé l'Iran à "répondre positivement à la proposition" de l'AIEA, estimant que Téhéran devrait assumer "les conséquences" d'un blocage.
Dans une interview à CNN dans la nuit de mardi à mercredi, M. Obama a mis en garde contre de nouvelles sanctions en cas de refus.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait pour sa part jugé "prématuré" mardi de conclure que les discussions sur le nucléaire iranien avaient échoué.
M. Mottaki a affirmé que l'Iran voulait une nouvelle réunion technique avec les Etats-Unis, la Russie et la France, sous l'égide de l'AIEA.
"Nous avons déclaré que le comité technique de la réunion de Vienne doit se réunir de nouveau et nous exposerons nos considérations" sur l'échange entre l'uranium faiblement enrichi de l'Iran contre du combustible, a-t-il déclaré.
Selon M. Mottaki, les représentants américains, russes et français ont proposé de "prendre l'uranium iranien enrichi à 3,5% pour donner en contrepartie du combustible à 20% et comme l'Iran a besoin de 116 kilos de combustible il faudrait leur livrer en contrepartie 1.160 kilos d'uranium enrichi à 3,5%".
La question de l'enrichissement est au centre du bras de fer entre l'Iran et les puissances du groupe des Six (Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine et Allemagne) qui redoutent que Téhéran n'utilise l'uranium à des fins militaires.
Le transfert de l'uranium enrichi iranien vers l'étranger permettrait d'apaiser les inquiétudes internationales sur le programme nucléaire iranien en assurant un plus grand contrôle des stocks iraniens.
L'uranium enrichi sert à produire du combustible pour des réacteurs civils mais entre également, à un niveau élevé d'enrichissement, dans la fabrication de la bombe nucléaire.
M. Soltanieh a en outre fait état mercredi d'une seconde visite, jeudi, d'inspecteurs de l'AIEA sur le chantier du nouveau centre d'enrichissement d'uranium près de Qom (150 km au sud-ouest de Téhéran).
La révélation en septembre de l'existence de ce site avait attisé la polémique en Occident sur la véritable nature du programme nucléaire du régime islamique.
AFP
|
Re: Géopolitique 20 novembre 2009, 06:47 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Nominations au sein de l'UE: l'occasion manquée
On aurait eu besoin, espéré, voulu de plus fortes personnalités. Un Premier ministre en fonction depuis moins d’un an comme premier président de l’Europe, cela fait plutôt léger. Une toute nouvelle commissaire européenne dont l’expérience diplomatique est simplement inexistante au poste de première Haute représentante, de ministres des Affaires étrangères de l’Union, cela surprend encore plus.
L’Europe déçoit. L'Europe rate là, l’occasion de se donner ce minimum d’éclat qui lui serait tant nécessaire. Elle accouche, en fin de compte, d’une souris car tant de batailles, le projet de Constitution puis ce traité de Lisbonne, pour arriver à cela… Non. Cela fait franchement misérable mais que s’est-il passé ?
Deux choses. La première est que, comme prévu, les dirigeants des pays membres n’ont pas voulu d’hommes ou de femmes qui auraient eu suffisamment de poids pour affirmer l’Union contre les Etats qui la composent. Comme toujours, ils ont voulu garder la main, freiner toute dynamique fédérale, empêcher que l’ensemble ne prenne le pas sur ses parties car leur hantise à tous, de gauche ou de droite, du nord, de l’est ou du sud, est que leurs Etats finissent par moins compter que l’Union et que des dirigeants européens échappent à leur contrôle et relativisent leur pouvoir.
Quant au second élément qui a fait cette décision, il est que les Etats membres ont, comme toujours, cherché un consensus a minima entre des visions contraires. Les Belges sont d’inclination fédérale, beaucoup plus éloignés, donc, des Britanniques que des Français et des Allemands qui, pour imposer un Belge à la présidence, Herman Van Rompuy, ont cédé le poste de Haut représentant à la Grande-Bretagne, pays qui ne veut pas de politique étrangère européenne. C’est du donnant-donnant, un jeu à somme nulle qui évite à chaque camp de se compter et fait l’économie d’un débat public, de fond, sans lequel l’Europe restera étrangère aux Européens.
L’Europe n’en est pour autant pas morte. Pour n’être pas illustres, aucune de ces deux personnes n’est indigne de sa nouvelle fonction.
L’une avait surpris, comme commissaire au Commerce, par sa capacité à faire avancer des dossiers totalement bloqués. L’autre avait si bien navigué entre les écueils des déchirements belges qu’il n’est pas exclu qu’il devienne un bon conciliateur européen, un "facilitateur" dit-il, mais, bien au-delà d’eux, l’Europe n’avancera, maintenant, qu’à deux conditions. La première est que la France et l’Allemagne parviennent réellement, comme elles le souhaitent, à se rapprocher assez pour donner un exemple d’unité économique et politique à l’Union. La seconde est que les grands courants politiques européens forment des partis paneuropéens, unis par des propositions pour l’Europe et entre lesquels l’électorat européen puisse trancher en constituant une majorité parlementaire européenne à même d’imposer aux Etats une Commission, un gouvernement européen, reflétant les choix populaires.
Après la déception d’hier, l’Europe a plus que jamais besoin d’une direction et de démocratie.
|
Re: Géopolitique 23 novembre 2009, 10:22 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les gesticulations iraniennes
D’un côté, mais d’un côté seulement, le ton monte à Téhéran. Comme si la République islamique s’attendait à une attaque aérienne sur ses sites nucléaires, elle a entamé, hier, cinq jours de « grandes manœuvres » militaires accompagnées de menaces à l’égard d’Israël.
« Les F-15 et les F-16 – ceux de l’aviation israélienne en clair – seront piégés par notre défense et annihilés », a déclaré le commandant des forces aériennes des Gardiens de la Révolution avant d’ajouter : « Et s’ils s’échappent, ce sont les bases d’où ils ont décollé qui seront frappées par nos missiles sol-sol avant qu’ils n’aient pu atterrir ». Le représentant du Guide suprême auprès de ces mêmes Gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, a annoncé, pour sa part, que « si les ennemis attaquent l’Iran, nos missiles frapperont le cœur de Tel Aviv », mais est-on vraiment à la veille d’une telle confrontation ?
En fait, non. Les Gardiens de la Révolution, les plus durs des plus durs, veulent envoyer le signal que la République islamique serait décidée à ne rien céder et prête à un bras de fer avec les grandes puissances ou Israël mais c’est bien plutôt une totale confusion que laissent voir les responsables iraniens.
Après des semaines d’atermoiements, leur ministre des Affaires étrangères avait semblé enterrer, mercredi, le projet de compromis auquel son pays avait pourtant souscrit, début octobre, à Genève. C’était « non », non à l’idée que l’Iran puisse confier la majeure partie de son stock d’uranium à la Russie puis à la France pour l’enrichir à un niveau interdisant un éventuel usage militaire.
C’est ce qu’on appelle une « mesure de confiance », qui était envisagée, une étape permettant d’ouvrir des discussions sur un compromis global entre l’Iran et les Etats-Unis au premier chef. Un espoir était né à Genève que cette déclaration était venue tuer mais hier, au moment même où commençaient ces manœuvres, le représentant iranien auprès de l’Agence pour l’énergie atomique faisait machine arrière en expliquant que Téhéran était toujours disposé à manifester une « approche positive » mais qu’il lui fallait des « garanties » sur les délais de restitution de son uranium après traitement par la Russie et la France.
La musique n’était plus la même et le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité iranien a enfoncé le clou en déclarant que l’Iran avait une « approche stratégique » dans ses discussions avec les grandes puissances, qu’elles relevaient, autrement dit d’un choix de fond, et qu’elles « servaient les intérêts de toutes les parties ». Après son « non », l’Iran est repassé au « oui, si… » car ses dirigeants se déchirent sur les avantages et inconvénients, en termes intérieurs, d’un compromis sur le nucléaire.
A rien de bon pour ce régime. Le paradoxe est que l’Iran, à force de souffler le chaud et le froid, est en train de resserrer les rangs des grandes puissances en rapprochant la Russie des Occidentaux. A ce rythme, l’unanimité se dégagera bientôt au Conseil de sécurité en faveur de nouvelles sanctions qui, pour le coup, mettraient les dirigeants iraniens dans de vraies difficultés.
|
Re: Géopolitique 25 novembre 2009, 03:20 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'équation asiatique des Etats-Unis
En visite à Pékin il y a huit jours après une escale à Tokyo, Barack Obama reçoit, aujourd’hui, le Premier ministre indien à la Maison-Blanche. En à peine plus d’une semaine, le président américain se sera ainsi entretenu avec les dirigeants des trois plus grandes puissances asiatiques, décidément bien plus présentes à son esprit, et pour des raisons claires, que l’Union européenne ou aucun de ses pays membres.
Il n’y a pas de guerre en Europe. L’Union s’affirme bien trop lentement pour poser le moindre défi politique aux Etats-Unis qui n’ont pas même besoin d’elle face à une Russie dont ils se rapprochent à grands pas. Pour l’Amérique, l’Europe est un allié tranquille qui ne lui demande pas beaucoup d’attention alors que l’Asie est un concentré de difficultés pour la diplomatie américaine.
Désormais gouverné par le centre gauche, le Japon ne veut plus être un simple vassal des Etats-Unis qui l’avaient reconstruit après sa défaite. Bastion avancé des Occidentaux en Asie durant tout l’après-guerre, alors uni à l’Amérique par une même crainte de la Chine communiste et de l’Inde tiers-mondiste, à l’époque alliée de l’URSS, le Japon veut désormais s’émanciper, renégocier ses accords avec Washington et jouer sa propre carte en Asie en trouvant un modus vivendi politique avec la Chine dont il est d’ores et déjà l’un des tout premiers partenaires commerciaux. Ce n’est pas que le Japon rompe avec les Etats-Unis mais son évolution leur fait craindre de ne plus beaucoup peser, un jour, dans la région face à une connivence sino-japonaise qui, paradoxalement, s’affirme. Quant à l’Inde et à la Chine, c’est l’inverse. Ce sont leurs rivalités et leurs tensions qui posent problème à Barack Obama.
Dans l’absolu, les Etats-Unis ne devraient avoir qu’à se réjouir des divisions entre ces deux pays les plus peuplés du monde – un milliard quatre cent millions d’habitants pour la Chine, un milliard deux cents millions pour l’Inde. C’est si vrai qu’ils s’étaient résolus, sous Georges Bush, à lever toutes les sanctions qu’ils avaient prises contre l’Inde après qu’elle eut entamé sa marche vers l’arme atomique. Les Etats-Unis avaient alors voulu se réconcilier avec New Delhi afin de ne pas s’enfermer dans un tête-à-tête avec Pékin mais la crise de Wall Street les a rendus si économiquement dépendants de la Chine qu’ils ont désormais du mal à tenir la balance égale entre ces deux géants.
Les Indiens ne veulent pas d’un axe privilégie entre l’Amérique et la Chine qui demeure leur grande rivale continentale. C’est ce que leur Premier ministre, avec toute la subtilité requise, dira à Barack Obama qui n’est pas en situation d’ignorer ce message non seulement parce que les Etats-Unis ont plus que jamais besoin d’un contrepoids face à la Chine mais aussi parce qu’il y a l’Afghanistan. Dans cette guerre tellement incertaine, l’Inde est indispensable aux Etats-Unis dans la mesure où elle ne voudrait à aucun prix que le Pakistan, allié de la Chine avec lequel elle est en conflit depuis 1947, reprenne pied à Kabul à la faveur d’une victoire des taliban. L’Amérique ne peut pas se passer de l’Inde. L’équation asiatique est, pour elle, plus que complexe.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.