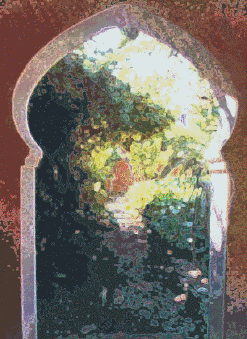|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 08 janvier 2010, 01:24 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Tractations secrètes au Proche-Orient
D’abord les faits, pièces d’un puzzle particulièrement ardu. Les ministres des Affaires étrangères de deux pays arabes, l’Egypte et la Jordanie, seront demain à Washington pour des consultations sur le conflit israélo-palestinien. Ces visites font suite à une impressionnante série de rencontres diplomatiques sur le même dossier puisqu’en l’espace de dix jours, on a vu le Premier ministre israélien se rendre au Caire et les chefs de file du Hamas en Arabie saoudite, les dirigeants égyptiens et saoudiens s’entretenir à haut niveau et le président palestinien se concerter longuement, en tête-à-tête, avec le président égyptien.
Parallèlement les interminables négociations indirectes entre le Hamas et Israël sur l’échange de prisonniers qu’il projette depuis des mois se poursuivent sans se rompre. Georges Mitchell, l’émissaire américain pour le Proche-Orient est à nouveau attendu dans la région la semaine prochaine après un passage par Paris et Bruxelles. Washington annonce sa détermination à « s’engager plus encore », cette année, dans la recherche d’un règlement et une phrase, surtout, retient l’attention. Commentant ce qu’il venait d’entendre de la bouche de Benjamin Netanyahu lors de sa visite au Caire, le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré : « Je ne peux pas parler des détails mais le Premier ministre a discuté de positions qui surpassent ce que nous avons entendu de leur part depuis longtemps. Je ne peux pas dire qu’il a changé de position mais il avance », a-t-il ajouté en disant avoir le sentiment que « tout était sur la table ». Or ces derniers mots sont d’autant plus frappants qu’avant même cette visite au Caire, l’ancien ministre Yossi Beilin, une figure de la gauche, la principale personnalité du camp de la paix israélien, croyait savoir, et le disait, que Benjamin Netanyahu, le héros de la droite, était décidé à rouvrir des pourparlers de paix visant à la création d’un Etat palestinien et acceptait que la question du statut de Jérusalem soit « sur la table ».
Tout cela est naturellement à prendre avec la plus extrême prudence mais le fait est qu’il s’est produit, en 2009, avant même tous ces échanges diplomatiques, leur ouvrant la voie peut-être, plusieurs changements de fond susceptibles de modifier la donne proche-orientale. Les Etats-Unis ont fait comprendre qu’ils ne se satisferaient plus du statu quo et obtenu des Israéliens un gel provisoire de la colonisation qui, bien qu’il ne concerne pas Jérusalem est, est une nouveauté assez totale pour valoir des menaces de mort au ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Benjamin Netanyahu s’est publiquement rallié, en juin, au principe de la création d’un Etat palestinien qu’aucune grande force politique israélienne ne refuse ainsi plus et il cherche maintenant à ouvrir son gouvernement au centre, comme s’il préparait un changement de politique.
L’immense majorité, surtout, des Israéliens, à gauche comme à droite, a désormais intégré l’idée qu’il n’y avait, à terme, qu’une seule alternative pour leur pays : la création d’un Etat palestinien ou celle d’un Etat binational, israélo-palestinien, dans lequel ils deviendraient vite minoritaires. Les pièces du puzzle sont à assembler. C’est un puzzle, mais les pièces sont là.
|
Re: Géopolitique 08 janvier 2010, 01:49 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Des soldats égyptiens casqués et arme à la main sont nerveux. Une douzaine d'entre eux sont postés à faible distance de la ligne de démarcation avec Gaza. Le terminal de Rafah a été ouvert lundi, mais, ce mercredi 6 janvier, le maigre trafic des passagers, que l'Egypte autorise en général une fois par mois, est interrompu.
La tension qui ne cesse de monter entre le gouvernement du Mouvement de la résistance islamique (Hamas), qui contrôle Gaza, et l'Egypte, depuis que Le Caire a entrepris de construire une barrière métallique souterraine pour endiguer le flot de marchandises acheminées par les tunnels de contrebande, vient de dégénérer. Un échange de tirs entre gardes-frontières égyptiens et policiers du Hamas a fait un mort et une demi-douzaine de blessés côté égyptien, et une quinzaine de blessés côté palestinien.
CORDON OMBILICAL
L'incident s'est produit à un peu plus d'un kilomètre de là, à la porte Salahuddin, le long du "couloir de Philadelphie" qui marque la frontière entre les deux territoires. Des manifestants palestiniens s'étaient rassemblés pour protester contre la construction de la barrière égyptienne. Les slogans hurlés par les adolescents palestiniens se sont accompagnés de jets de pierres, auxquels ont répondu des tirs de semonce, et puis tout s'est embrasé.
Les gardes-frontières égyptiens avaient été rendus nerveux par la perspective de l'arrivée imminente d'un convoi humanitaire international à destination de Gaza, bloqué dans le port égyptien d'Al-Arich mercredi soir.
Chez les Gazaouis, l'incompréhension le dispute à une sourde appréhension devant l'avenir : l'"économie des tunnels" est le cordon ombilical de la bande de Gaza.
A Rafah, Ghazi Hamad, responsable de tous les points de passage officiels reliant Gaza à Israël et l'Egypte, se désole : "Nous espérons que nos frères égyptiens vont renoncer, insiste-t-il, qu'ils vont se souvenir que nous sommes comme eux des Arabes et des musulmans et qu'ils doivent nous aider, parce que la relation entre nos deux territoires est stratégique."
Dans la ville de Gaza, Ahmad Youssef, conseiller politique du premier ministre du Hamas, Ismaïl Haniyeh, ne décolère pas : "Pourquoi les Egyptiens apportent-ils leur concours aux efforts des Israéliens pour nous étrangler ? Dans tout le monde arabe, on nous soutient, sauf en Egypte. J'espère que les Egyptiens vont comprendre que cette attitude nuit à leur image."
M. Youssef remarque que "les gens" en concluent que Le Caire cède aux pressions des Etats-Unis et d'Israël.
L'EGYPTE INQUIÈTE DE L'INFLUENCE DU HAMAS
Cette vox populi sonne juste : l'administration américaine a manifestement décidé de rappeler à l'Egypte qu'en échange de son aide annuelle de quelque 1,7 milliard de dollars, elle attend du Caire une attitude plus ferme contre la contrebande d'armes, laquelle emprunte aussi le réseau des tunnels. L'Egypte se fait d'autant moins prier qu'elle s'inquiète depuis longtemps de l'influence du Hamas.
Le régime du président égyptien Hosni Moubarak a, d'autre part, été ulcéré par l'attitude du mouvement, qui, contrairement au Fatah de Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, a refusé de signer un plan de réconciliation interpalestinien négocié par l'Egypte.
Omar Shaban, qui dirige à Gaza le centre d'analyses Pal Think, n'a aucun doute : il y a bien, selon lui, une coordination entre Israël, l'Egypte et les Etats-Unis contre le Hamas : "L'Egypte n'avait pas besoin de construire un tel mur, au risque de précipiter une nouvelle catastrophe humanitaire à Gaza, pour adresser un message politique au Hamas. Si elle le fait, c'est parce que tout cela fait partie d'un plan plus vaste."
Pour compenser à terme cet étranglement de la frontière, Israël, assure-t-il, va relâcher l'étreinte du blocus, dans le cadre d'un accord avec le Hamas sur la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Cette perspective reste incertaine.
La réalité, les adolescents de Rafah l'observent en grimpant sur les monticules de terre qui bordent la frontière: la "machine de guerre" égyptienne, cette gigantesque foreuse qui creuse la terre pour y enfouir des panneaux d'acier de 18 mètres de hauteur, poursuit son travail de sape contre les tunnels de Gaza.
|
Re: Géopolitique 11 janvier 2010, 01:20 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Obama, tel qu'en lui-même
Toujours plus pénétré, toujours plus prof, infiniment précis dans son expression et à mille lieux de toute démagogie, Barack Obama était, hier, soir, l’exact contraire de ce qu’est, aujourd’hui, un dirigeant politique.
A fortiori aux Etats-Unis, le président d’un grand pays est aujourd’hui supposé réagir dans l’heure à tout événement susceptible de marquer l’opinion mais ce n’est que plus de deux semaines après la tentative d’attentat contre le vol Amsterdam Detroit qu’il en tirait les conclusions dans une déclaration diffusée en direct par les télévisions. Dans un pays démocratique au moins, lorsque le temps médiatique définit le temps politique et que toute question appelle réponse immédiate, un chef d’Etat contemporain est supposé apporter une réponse miracle et définitive à tout nouveau problème, sortir une solution de son chapeau, mais qu’a dit, hier, Barack Obama ?
Au lieu de limoger quelques responsables des services secrets, de nommer un M. Sécurité aérienne ou d’annoncer un projet de loi, au lieu de prendre des mesures qui auraient pu faire illusion mais n’auraient rien résolu, au lieu de faire de la « com », comme on dit, il s’est adressé, fidèle à sa règle, à l’intelligence de ses compatriotes. Il a détaillé les erreurs et négligences – manque de coordination, d’attention et de rapidité – qui avaient permis de laisser monter dans cet avion un homme pourtant archi suspect et dont le nom était signalé. Il a déclaré être « moins intéressé par les reproches que d’apprendre de ces erreurs et de les corriger », rappelé qu’il était « responsable quand le système échouait », dit qu’il n’existait pas de « solution miracle » à la menace terroriste et réaffirmé que, dans cette « guerre » avec al Qaëda, ce n’était pas cette « petite bande d’hommes qui veulent tuer des innocents mais nous (les Américains) qui définissons le comportement de notre pays ».
Barack Obama a dit, en un mot, que les Etats-Unis ne devaient pas réagir mais agir, ne pas se laisser dicter leur agenda par Oussama ben Laden, faire de la politique, dans la durée, sur le fond, et non pas du coup par coup, dicté par la peur et l’émotion, mais a-t-il convaincu, demandera-t-on ?
La certitude est, qu’à faire le contraire, il aurait menti. La certitude est que la démocratie se porterait mieux si les électeurs étaient traités en citoyens et non pas en consommateurs mais, au-delà de ces évidences fondamentales, tentons un premier bilan de Barack Obama.
Il devrait avoir bientôt doté tous les Américains d’une couverture médicale, réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Depuis son adresse du Caire au monde musulman, il est devenu nettement plus difficile aux illuminés de l’islamisme de faire des Etats-Unis des ennemis naturels de l’Islam. Sans cette adresse, les Iraniens seraient sans doute aujourd’hui moins nombreux à dénoncer leur régime. Sans l’exigence de ce président, les militaires américains auraient probablement été moins enclins à dire des choses intelligentes et courageuses sur la manière de mener la guerre en Afghanistan et, sans lui, les choses bougeraient moins sur le front israélo-palestinien, puisqu’elles y bougent et que cela pourrait se confirmer sous deux semaines.
|
Re: Géopolitique 14 janvier 2010, 02:14 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Meurtre et manipulations à Téhéran
Les faits sont clairs, ou le semblent en tout cas. Hier matin, Massoud Ali Mohammadi, 50 ans, professeur de physique nucléaire à l’Université de Téhéran, sort de chez lui et vit ses derniers instants. Commandée à distance, une moto piégée explose sur son passage, le tuant net, faisant exploser toutes les fenêtres à 50 mètres à la ronde et blessant de nombreux passants.
Ce n’est pas le genre d’assassinat qu’organise un mari jaloux. C’est un travail de professionnel, l’œuvre de services secrets, mais lesquels ?
Pour le ministère iranien des Affaires étrangères, pas de doute. « Les premiers éléments de l’enquête, affirme son porte-parole, révèlent des signes de l’action maléfique du triangle formé par les Etats-Unis, le régime sioniste et leurs mercenaires ». « D’un côté, renchérit le gouvernement, l’Amérique enlève des Iraniens dans des pays tiers pour le transférer aux Etats-Unis et, de l’autre, ses agents stipendiés en Iran assassinent un citoyen érudit ».
La Maison-Blanche a aussitôt démenti, parlant d’accusations « absurdes » mais peut-être.
Il n’est peut-être pas impossible que les Etats-Unis ou Israël soient impliqués puisque l’élimination physique fait partie de l’arsenal de leurs services comme de nombreux autres, que ces deux pays cherchent à freiner le développement du programme nucléaire iranien, que l’assassinat de scientifiques peut y contribuer et qu’il est hautement vraisemblable que les Etats-Unis aient non pas enlevé mais organisé la fuite, durant un voyage en Arabie saoudite, d’un autre physicien nucléaire iranien, Sharam Amiri.
Peut-être les autorités iraniennes ont-elles donc raison, sauf que Massoud Ali Mohammadi n’était pas engagé, à en croire l’agence iranienne de l’énergie atomique, dans le programme nucléaire de la République islamique, que le retournement d’un scientifique iranien peut apporter beaucoup d’informations mais sa mort aucune et que cet enseignant n’était pas un proche du régime puisqu’il avait signé, avant la présidentielle de juin, une déclaration de soutien au principal candidat de l’opposition, Mir Hossein Moussavi.
Manipulations et provocations en tout genre, tout est possible au royaume des barbouzes et de la basse police. Absolument tout est envisageable dans une situation aussi incertaine que celle que traverse l’Iran alors, tentons une hypothèse.
Les ultras du régime viennent d’être rappelés à l’ordre par le Guide suprême qui s’est distancé d’eux à demi mots. Dominé par l’aile modérée des conservateurs, le Parlement tente de restreindre leur marge de manœuvres. Les ultras pourraient très bien avoir organisé cet assassinat dont ils ont tous les moyens pour faire monter la tension, accréditer leur thèse selon laquelle opposition et services étrangers ne font qu’un et réussir ainsi à durcir encore la répression comme ils la souhaitent.
Ce n’est pas moins plausible, pas plus prouvé mais pas plus invraisemblable non plus que la thèse des autorités iraniennes. La seule certitude est que ce genre d’assassinats n’annonce jamais rien de bon.
|
Re: Géopolitique 14 janvier 2010, 11:14 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
|
Re: Géopolitique 15 janvier 2010, 03:11 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Grandeur et difficultés de l'ingérence
Massif, émouvant, rassurant sur la nature humaine, l’élan de solidarité est tel qu’Haïti ne peut déjà plus absorber l’aide mobilisée en sa faveur. Tout manque à ces survivants, perdus, hagards, désespérés – des médecins, surtout, des médicaments, surtout, des hôpitaux de campagne, surtout, des grues, surtout, pour dégager les ruines sous lesquelles tant de gens restent ensevelis et s’éteignent lentement, inexorablement, sans eau, dans le noir et la puanteur des cadavres.
Tout manque, mais l’aéroport de Port-au-Prince, trop petit, trop endommagé, peine grandement à accueillir les avions prêts à décoller d’Europe et d’Amérique. Les routes sont trop embouteillées de réfugiés pour que les équipes arrivées sur place puissent aussitôt être opérationnelles et la misère et la faim sont trop grandes pour que la sécurité des sauveteurs soit pleinement assurée. Torrents d’horreur et de bonne volonté, c’est le chaos, en un mot, cette « deuxième catastrophe » que Bernard Kouchner craignait dès hier matin, sur cette antenne.
Il faudrait organiser, planifier, « prioriser », comme on dit, mais qui doit le faire ? Ce devrait être les autorités nationales mais, outre que le séisme n’a pas épargné ministres et fonctionnaires, l’appareil d’Etat haïtien est pauvre, faible, sans moyen de le faire. L’Onu, alors ? Elle s’y efforce mais l’Onu est en deuil de dizaines, peut-être 200 de ses représentants en mission à Haïti et son bilan dans ce pays, loin d’être nul, n’est pas non plus probant. Les grandes puissances, alors, les Etats-Unis et l’Union européenne ? Oui, bien sûr, mais qui, précisément ? L’Amérique ou l’Europe ? Le voisin ou le vieux continent d’où l’Espagne et la France étaient parti coloniser cette île ?
Entre Washington et Bruxelles, il y a, là, comme un grondement de rivalité et, même si les deux grands, le petit grand et l’autre, parviennent à se coordonner, restera la grande question. Comment, de quel droit, dans quelles limites et sur quelles bases, prendraient-ils l’ordre et l’économie en charge, tout en main, dans un pays défait mais souverain ? Devant l’urgence, parce qu’il ne peut pas en être autrement, les choses se mettront en place, un équilibre se trouvera, mais observons ce moment. En vingt-quatre heures, viennent de se poser en Haïti des problèmes qui se rencontrent périodiquement aux quatre coins du monde.
Parce que l’instantanéité des communications fait que nous vivons, en direct, les malheurs les plus lointains, parce que la générosité a permis l’essor des organisations humanitaires et que les opinons somment les Etats de faire au moins autant que les ONG, les pays riches interviennent, pas partout mais souvent. C’est bien, c’est mieux que de détourner son regard, mais, dès lors que des Etats ou l’Onu interviennent, ils ont une obligation de résultats, sur la durée, et le fait est que, sauf à en revenir _ et encore _ aux mandats d’antan, à la mise de pays sous tutelle, on ne peut exporter et enraciner la paix civile, le bien être et la stabilité. C’est affaire de longs processus internes et, au-delà des secours d’urgence, on risque, là, de le vérifier à nouveau.
|
Re: Géopolitique 18 janvier 2010, 02:13 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'Europe et ses immigrés
C’est un débat qui n’est pas que franco-français. Lorsque Eric Besson et Martine Aubry relancent l’idée d’un droit de vote des immigrés aux élections locales, ils pensent, bien sûr, image, avantages et tactiques politiques. L’un veut se démarquer du Front national, dire que ce n’est pas à une présence étrangère qu’il s’oppose mais seulement à l’immigration clandestine. L’autre veut prendre la droite à ses contradictions – si vous pensez que c’est bien, pourquoi ne pas le faire, sans plus attendre ? C’est l’aspect national de ce débat mais, sur le fond, les questions qu’il pose concernent tous les pays développés, européens au premier chef.
Au-delà des problèmes et malaises qu’elle suscite, qu’ils soient réels ou infondés, exagérés ou sous-estimés, l’immigration est un fait. Non seulement l’Europe est devenue terre d’immigration, comme les Etats-Unis ou l’Australie, mais ce phénomène s’amplifiera dans les décennies à venir parce que les Européens font de moins en moins d’enfants, qu’ils vieillissent, qu’il faudra bien des actifs pour payer leurs retraites, que le chômage de nos pays ne sera pas éternel, que nos industries auront, à nouveau, des besoins de main-d’œuvre comme elles en avaient eu pendant les Trente Glorieuses et que le travail attire inexorablement ceux qui en cherchent.
Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer la force de l’immigration latino-américaine vers les Etats-Unis et la catastrophe économique que constituerait son tarissement mais comment canaliser ce mouvement ? Comment éviter, autrement dit, que les immigrés restent d’étranges étrangers, des parias s’installant dans un statut de « classes dangereuses », comme les riches disaient des pauvres il y a deux siècles ?
On comprend bien l’idée du droit de vote aux élections locales qui n’est ni française ni nouvelle. Elle est d’intégrer les immigrés à la vie de la cité, d’entendre leurs besoins et de leur permettre de les faire entendre avant que leurs enfants ne croient plus qu’à la fureur comme moyen d’expression. Généreuse, cette idée est si loin d’être absurde que beaucoup y adhèrent, à droite comme à gauche, mais elle pourrait bien être profondément perverse.
Petite ou grande, une ville n’est pas une association, de locataires ou de parents d’élèves. C’est le premier échelon de la vie démocratique, d’institutions dans lesquelles le droit de vote, comme à tout échelon, découle de la citoyenneté dont il est l’instrument. S’il s’agit – et c’est toute la question – d’intégrer les immigrés à leur nouvelle communauté nationale, française ou autre, quel sens y aurait-il à en faire de demi citoyens, niveau local mais pas national ? Quel sens y aurait-il à les installer dans un statut particulier, dérogatoire, totalement contraire à des institutions auxquelles il faut, au contraire, les familiariser ? Dès lors qu’un étranger vit et travaille dans un pays dont il observe les lois, il a vocation à en devenir citoyen, à en avoir tous les droits et devoirs. C’est cela qu’il faut viser et non pas multiplier les obstacles à la naturalisation tout en créant des droits attentatoires à l’égalité des citoyens, fondement de toute démocratie.
|
Re: Géopolitique 19 janvier 2010, 02:46 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Des kamikazes à Kaboul
Cela s’appelle un démonstration de force et les taliban l’ont réussie. A 9h50, hier matin, en plein cœur de la capitale afghane, un kamikaze se fait exploser devant la Banque centrale, à deux pas du palais présidentiel. Dans les minutes qui suivent, dans le même quartier, périmètre le plus protégé de tout le pays, des taliban miliciens et deux ou trois autres kamikazes s’emparent d’un centre commercial surplombant le palais présidentiel, s’en prennent à d’autres bâtiments officiels et au Serena, l’hôtel cinq étoiles des visiteurs de marque.
C’est un piège. Alors que les forces de sécurité encerclent le centre commercial, une ambulance s’approche, comme tant d’autres, mais conduite par un attaquant qui se fait exploser à son tour, avec son véhicule.Traque, prise d’otages, odeur de poudre sur une large partie de la ville, les combats dureront jusqu’à 15h, plus de cinq heures de bataille rangée en plein Kaboul.
Menée de main de maître, l’opération a été, qui plus est, minutée pour débuter au moment même où les quatorze ministres dont le Parlement avait fini par approuver, samedi, la nomination s’apprêtaient à prêter serment. Avec onze autres ministres sur le choix desquels le président et les élus ont encore à trouver un accord, cette cérémonie n’installait pas un gouvernement. Elle ne marquait qu’une trêve entre l’exécutif et le législatif mais, là dans le fracas des explosions, elle a tournée à l’humiliation du pouvoir, giflé jusque dans ses quartiers.
Le coup est indiscutablement rude, d’autant mieux pensé que c’est dans huit jours exactement que s’ouvre, à Londres, la conférence internationale au cours de laquelle les pays européens devraient apporter leur appui à la nouvelle stratégie afghane des Etats-Unis et annoncer, peut-être, l’envoi de renforts. Cibles et moment, les taliban n’ont pas frappé au hasard mais, d’un autre côté, ce n’est pas la première fois qu’ils opèrent à Kaboul.
C’est la septième en un an. Les forces afghanes ont plutôt mieux réagi que les fois précédentes, plus vite, plus efficacement, moins surprises peut-être. C’est un coup d’éclat mais qui ne change pas fondamentalement les termes du débat entre ceux, en Europe et aux Etats-Unis, qui voudraient arrêter cette guerre au plus vite car ils la considèrent comme déjà perdue et ceux qui estiment que, si difficile et compromise qu’elle soit, on ne peut pas laisser les taliban l’emporter en Afghanistan et déstabiliser plus encore le Pakistan.
Ce qui changerait la donne d’un coup, ce serait une hécatombe parmi les soldats de l’Otan, des attentats du genre de ceux que les services syriens avaient réussis, dans les années 80, contre les forces américaines et françaises du Liban. Les Américains s’étaient, alors, précipitamment retirés de ce pays, obligeant les Français à les suivre mais, expérience aidant, ils ont appris à se protéger de ce type d’attaque, non pas impossibles mais improbables. Le débat afghan va se poursuivre, mais à bas bruit.
|
Re: Géopolitique 19 janvier 2010, 03:02 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 1 445 |
"Menée de main de maître"
Pour des gens qui envoient d'autres se suicider pendant qu'eux sont bien planques, ce n'est pas etonnant.
Un jour viendra ou la verite eclatera, et tous ces manipules comprendront trop tard leurs erreurs.
Ceux qui ecrivent ces articles avec jubilation, se font complices des talibans, et sont pires qu'eux.
Pour des gens qui envoient d'autres se suicider pendant qu'eux sont bien planques, ce n'est pas etonnant.
Un jour viendra ou la verite eclatera, et tous ces manipules comprendront trop tard leurs erreurs.
Ceux qui ecrivent ces articles avec jubilation, se font complices des talibans, et sont pires qu'eux.
|
Re: Géopolitique 27 janvier 2010, 04:52 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'aube d'une nouvelle ère économique
Il ne s’agit pas de vraies propositions, moins encore de décisions, mais de signes, intéressants, frappants, d’une évolution générale des idées.
Dans une tribune parue, hier, dans le Guardian, le secrétaire d’Etat britannique chargé du secteur financier écrit que son gouvernement entend œuvrer à un accord international sur la manière de faire financer par les banques le coût de leur sauvetage en cas de nouvelle crise. « Si les banques bénéficient ne serait-ce que d’un soupçon de garantie publique implicite, elles doivent payer pour cette aide », écrit Lord Myners, en ajoutant qu’il « ne sera pas facile de trouver le moyen d’empêcher que ce ne soit au contribuable de payer la facture des futurs plans de sauvetage mais que ce problème ne peut être résolu que par un accord mondial ».
Le même jour, le secrétaire d’Etat avait présidé, à Londres, une réunion de hauts fonctionnaires du G7 et d’organisations financières internationales consacrée à cette question sur laquelle le FMI doit présenter un rapport dans trois mois. Trois idées y ont été évoquées – celle d’une taxe sur les transactions financières internationales, communément dite « taxe Tobin », celle d’un prime d’assurances qui aurait les faveurs du FMI et celle, enfin, d’un renforcement obligatoire des fonds propres des banques qui leur permettrait de faire face, par elles mêmes, à une période de difficultés.
La veille, Alistair Darling, le ministre britannique des Finances, avait déploré, lui, que les mesures annoncées la semaine dernière par Barack Obama sur la limitation de la taille et des activités des banques n’aient pas été coordonnées au niveau international. « Si chacun s’occupe de ses affaires dans son coin, on n’aboutira à rien du tout », avait-il estimé et, hier encore, la ministre espagnole des Finances, Elena Salgado, a plaidé, quant à elle, pour une coordination, à l’échelle européenne, de toute augmentation ou création d’impôts dans les pays de l’Union. Il faut une « harmonisation », avait-elle dit dans La Tribune, pour éviter une stimulation de l’évasion fiscale ».
Toutes ces déclarations ont une musique commune qui marque une profonde rupture avec les grands dogmes de l’ère du libéralisme triomphant. Hier, l’idée reçue était que la concurrence la plus totale et, notamment, la concurrence fiscale entre les Etats, favorisait l’entreprise et, donc, l’emploi, que les réglementations n’étaient qu’un frein à la croissance et que trop d’impôts tuait l’impôt en faisant diminuer les profits et, par voie conséquence, les ressources fiscales.
Aujourd’hui, l’idée qui monte est que l’autorégulation du marché est un mythe coûteux, comme on vient de le voir, que l’impôt et les réglementations doivent réguler le fonctionnement de l’économie, que les Etats ont un rôle économique et que, face à un marché mondialisé, ils ne peuvent l’exercer qu’en prenant des mesures harmonisées, au niveau mondial ou continental au moins. Rien ne se fera en un jour, pas même en une poignée d'années mais, depuis septembre 2008, on y va. On entre dans une nouvelle ère.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.