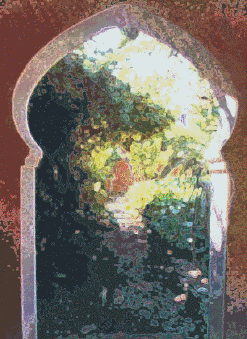|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 28 janvier 2010, 03:57 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les Etats contre le marché roi
Les mêmes causes produisent les mêmes effets ; la même crise, le même besoin d’Etat. D’Amérique en Europe, les dirigeants politiques affirment la même volonté de reprendre la main face à l’argent et l’on retrouvait ainsi la même défense des petits contre les gros, du travail contre le marché roi, dans les discours prononcés, hier, par Barack Obama et Nicolas Sarkozy.
L’un s’adressait au Congrès américain, l’autre aux plus grands patrons du monde réunis, à Davos, pour leur symposium annuel. Le premier était plus précis, chiffres et lois à passer ; l’autre plus général, parlant plus vision globale et nécessité de régulations mondiales que mesures concrètes, mais écoutons.
« Nous ne pouvons pas nous permettre, dit le président américain, une soit disant expansion de plus, du genre de celle de la dernière décennie où l’emploi s’est moins développé que durant toutes les périodes de croissance précédentes, où le revenu moyen des foyers américains a décliné et où la prospérité était fondée sur une bulle immobilière et la spéculation financière ».
« La finance, le libre-échange, la concurrence sont des moyens, pas des fins en soi, dit le président français. La mondialisation a engendré un monde où tout était donné au capital financier, tout et presque rien au travail ».
« Le pire de la tourmente est passé mais les dévastations sont là, dit le premier. Un Américain sur dix ne peut pas trouver de travail. Pour ceux qui connaissaient déjà la pauvreté, la vie est devenue encore plus dure et ceux des Américains pour lesquels le changement se fait attendre ne comprennent pas pourquoi il semble que les mauvaises pratiques de Wall Street sont récompensées alors que le dur travail de tous de l’est pas ».
« Ou bien nous changerons, dit le second, ou bien les changements nous seront imposés, par les crises économiques, les crises politiques, les crises sociales. Faisons le choix de l’immobilisme, le système sera balayé et il l’aura mérité ».
« Si une chose réunit Démocrates et Républicains, c’est que nous avons tous détesté le sauvetage des banques, dit le premier. Le chômage aurait pu être double si nous n’avions pas empêché la faillite du système financier mais, si les compagnies de Wall Street peuvent, à nouveau, se permettre de distribuer de gros bonus, elles peuvent se permettre de payer un modeste honoraire aux contribuables qui les ont sauvées ».
« Le métier des banques, dit le second, n’est pas de spéculer mais de financer le développement de l’économie. Je suis d’accord avec le président Obama quand il juge nécessaire de dissuader les banques de spéculer pour elles-mêmes ou de financer des fonds spéculatifs ».
Chez l’un et l’autre, le diagnostic est semblable, les craintes économiques et politiques sont les mêmes. L’ère n’est plus la même, les gouvernements changent d’approche, mais les intérêts des Etats ne sont pas forcément convergents, pas à court terme en tout cas. De nouveaux équilibres se cherchent mais ce n’est qu’un début, plutôt spectaculaire mais encore bien incertain.
|
Re: Géopolitique 01 février 2010, 14:50 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Obama met l'Iran sous cloche
Les Etats-Unis prennent les devants. A défaut de progrès dans les négociations sur le programme nucléaire iranien, ils ont fait savoir samedi, par le canal du New York Times, qu’ils entreprenaient le déploiement de forces anti-missiles au Proche-Orient.
En plus de l’Arabie saoudite et d’Israël qui en sont déjà équipés, quatre des Etats du Golfe, le Qatar, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït, seront chacun dotés de deux batteries de missiles anti-missiles Patriot tandis que deux navires américains, également à mêmes d’intercepter des tirs iraniens, croiseront désormais en permanence au large des côtes de la République islamique.
Le premier objectif de ce déploiement serait de dissuader les Iraniens de s’attaquer à ces alliés sunnites des Etats-Unis au cas où le Conseil de sécurité - ou les Occidentaux seuls - prendraient de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran. Le deuxième serait de suffisamment rassurer ces pays sur leur sécurité pour qu’ils ne veuillent pas, à leur tour, acquérir la bombe et ouvrir, par là, un nouveau cycle de dissémination nucléaire mais ce n’est pas tout. A en croire un officiel américain anonymement cité par le New York Times, les Etats-Unis voudraient également « calmer » les Israéliens, les convaincre, autrement dit, que leur protection est assurée et qu’ils n’ont, donc, pas besoin de lancer une attaque préventive contre les sites atomiques de l’Iran.
Ce déploiement signifie avant tout que Barack Obama ne croit plus guère que l’Iran voudra saisir la main qu’il lui avait tendue et que les négociations en cours, pas totalement rompues, pourront aboutir mais cela ne veut, pour autant, pas dire que la tension monte, au sens militaire du terme.
Paradoxalement cela pourrait montrer, au contraire, que l’Amérique s’apprête à « vivre avec le programme iranien », à ne pas tenter d'empêcher son développement par la force parce qu’elle ne sait pas si d’éventuelles frappes aériennes pourraient l’anéantir et parce qu’elle craint, aussi, qu’une telle escalade ne suscite des représailles iraniennes en Irak et en Afghanistan et n’ait pour premier effet de tripler, dans l’heure, les prix du pétrole et d’instantanément ruiner tous les efforts de relance économique, aux Etats-Unis comme ailleurs.
Officiellement, « toutes les options sont sur la table » à Washington, y compris l’option militaire, mais, dès le mois d’octobre, dans un article longuement cité ici, le président de l’influent Council on foreign relations de New York, Richard Haas, avait publiquement exclu cette option comme irréaliste.
Si les négociations n’aboutissent pas, avait-il alors expliqué, il faudra que les Etats-Unis, dans le même temps, offrent leur protection militaire à leurs alliés de la région et imposent au régime iranien, seuls ou à plusieurs, des sanctions économiques assez fortes pour le mettre en difficultés sur sa scène intérieure. C’est, semble-t-il, ce qu’ils commencent à faire.
|
Re: Géopolitique 03 février 2010, 09:50 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
|
Re: Géopolitique 03 février 2010, 11:22 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 2 787 |
freddyb a écrit:
-------------------------------------------------------
> reportage musulman en belgique.envoyé par
> saffwan.
On se demande pourquoi elles veulent faire des études ces filles, quels métiers espèrent elles exercer en Europe?
N'empêche que l'intégrisme gagne du terrain et que c'est très inquiétant.
Les musulmans dits "modérés" paieront très cher leur silence s'ils s'obstinent à ne pas prendre ce problème à bras le corps.
Quand la Belgique se fache, elle ne plaisante pas.
En France, hélas, nous faisons la part belle à l'UOIF, c'est à dire les Frères Musulmans - Imprudence d'Etat d'un ministre de l'intérieur qui avait cru intelligent d'essayer de s'en faire des alliés - C'était plus qu'une imprudence c'était une faute et il n'est toujours pas sûr que, en tant que Président, il l'ait réalisé, malgré ce qui vient de se passer avec l'imam de Drancy!!!
-------------------------------------------------------
> reportage musulman en belgique.envoyé par
> saffwan.
On se demande pourquoi elles veulent faire des études ces filles, quels métiers espèrent elles exercer en Europe?
N'empêche que l'intégrisme gagne du terrain et que c'est très inquiétant.
Les musulmans dits "modérés" paieront très cher leur silence s'ils s'obstinent à ne pas prendre ce problème à bras le corps.
Quand la Belgique se fache, elle ne plaisante pas.
En France, hélas, nous faisons la part belle à l'UOIF, c'est à dire les Frères Musulmans - Imprudence d'Etat d'un ministre de l'intérieur qui avait cru intelligent d'essayer de s'en faire des alliés - C'était plus qu'une imprudence c'était une faute et il n'est toujours pas sûr que, en tant que Président, il l'ait réalisé, malgré ce qui vient de se passer avec l'imam de Drancy!!!
|
Re: Géopolitique 03 février 2010, 14:33 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le cinglant message d'Obama
On ne le prononce pas à haute voix. Le mot n’est que murmuré mais on l’entend partout à Bruxelles. « Camouflet », y dit-on de toute part depuis que Barack Obama a fait savoir par ses porte-parole, lundi, que, non, son emploi du temps ne lui permettrait pas de prendre part au sommet qui devait réunir l’Union européenne et les Etats-Unis, fin mai, à Madrid.
La situation est d’autant plus humiliante pour l’Europe que le président américain n’a ni pris la peine de décrocher son téléphone pour s’excuser ni même fait valoir un réel empêchement. Il a seulement et crûment fait comprendre qu’il avait mieux à faire, que ce sommet n’était pas sa priorité et, pire encore, ce n’est pas la première fois qu’il snobe l’Europe puisqu’il n’avait pas jugé nécessaire de se rendre à Berlin pour l’anniversaire de la chute du Mur, qu’il n’avait consacré que 90 minutes, en novembre, au précédent sommet euro-américain qui se tenait, pourtant, à Washington et que c’est avec l’Inde et la Chine, pas avec l’Europe, qu’il avait tenté de négocier un véritable accord à Copenhague.
Tout cela fait effectivement beaucoup mais ce camouflet – car c’en est un – ne relève aucunement d’une volonté de gifler l’Union mais de réalités qu'elle tarde un peu trop, beaucoup trop, à prendre en compte. La première est que la Guerre froide est terminée et que l’Europe n’est plus un enjeu pour les Etats-Unis qui ont de bien plus grands soucis avec le Proche-Orient, l’Asie du sud-ouest, la Chine ou, même, l’Amérique latine.
La deuxième est que ça y est, que les Américains ont désormais un président bien trop jeune pour avoir été marqué par la Deuxième Guerre mondiale et qui s’est, en revanche, formé dans les décennies de l’essor asiatique, de la concurrence japonaise et des flots d’importations chinoises qui ont tellement contribué à la désindustrialisation de l’Amérique.
La troisième est que les Etats-Unis préfèrent, désormais, se réconcilier avec la Russie qu’aller la provoquer en étendant l’Otan jusqu’à ses frontières et que l’Europe centrale n’a donc plus guère d’intérêt à leurs yeux.
Quant à la quatrième réalité, la plus dure à admettre pour l’Europe, elle est qu’on ne peut pas compter sans exister. A lui seul, aucun des pays européens, n’est de taille à s’imposer en interlocuteur privilégie des Etats-Unis. L’Union européenne le pourrait, bien sûr, mais comme aucun de ses Etats membres ne veut qu’elle s’affirme, en elle-même, sur la scène internationale, elle ne le peut pas non plus et Barack Obama ne fait qu’en tirer les conséquences.
Si l’Europe ne veut pas être, si elle n’a ni rôle international ni position commune sur le Proche-Orient, l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan, pas même sur Haïti, si l’Europe s’est mise aux abonnés absents, pourquoi aller perdre tant de temps dans tant de sommets sans objets ? C’est cela que Barack Obama dit aux Européens, rien d’autre, et ils devraient, au fond, l’en remercier car les gifles, ça vexe, ça fait mal, mais il arrive qu’à force d’en prendre, à la cinquième, à la dixième, à la vingtième peut-être, on se réveille.
|
Re: Géopolitique 03 février 2010, 22:41 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
girelle a écrit:
-------------------------------------------------------
> freddyb a écrit:
> --------------------------------------------------
> -----
> > reportage musulman en belgique.envoyé
> par
> > saffwan.
>
> On se demande pourquoi elles veulent faire des
> études ces filles, quels métiers espèrent elles
> exercer en Europe?
> N'empêche que l'intégrisme gagne du terrain et que
> c'est très inquiétant.
> Les musulmans dits "modérés" paieront très cher
> leur silence s'ils s'obstinent à ne pas prendre ce
> problème à bras le corps.
> Quand la Belgique se fache, elle ne plaisante
> pas.
>
J'ai la réponse a ta question Girelle,par cette vidéo.
Ces pauvres pimbêches soutiennent les gens , qui veulent las remettre dans une situation , que l'Europe a mis tans d'efforts a les en tirer .
Merci Pierre
-------------------------------------------------------
> freddyb a écrit:
> --------------------------------------------------
> -----
> > reportage musulman en belgique.envoyé
> par
> > saffwan.
>
> On se demande pourquoi elles veulent faire des
> études ces filles, quels métiers espèrent elles
> exercer en Europe?
> N'empêche que l'intégrisme gagne du terrain et que
> c'est très inquiétant.
> Les musulmans dits "modérés" paieront très cher
> leur silence s'ils s'obstinent à ne pas prendre ce
> problème à bras le corps.
> Quand la Belgique se fache, elle ne plaisante
> pas.
>
J'ai la réponse a ta question Girelle,par cette vidéo.
Ces pauvres pimbêches soutiennent les gens , qui veulent las remettre dans une situation , que l'Europe a mis tans d'efforts a les en tirer .
Merci Pierre
|
Re: Géopolitique 04 février 2010, 03:38 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La carte syrienne
Alors qu’ils n’en avaient plus depuis cinq ans, les Etats-Unis viennent de nommer un nouvel ambassadeur en Syrie. Simultanément annoncée, hier, à Damas et Washington, cette décision vise à relancer les tentatives de négociations entre Israéliens et Syriens, à parvenir à un accord aux termes duquel Israël, en échange de sa reconnaissance par la Syrie, lui restituerait les plateaux du Golan, annexés en 1981.
Ce serait la percée, le grand deal, dont les Américains, les Français et nombre des dirigeants israéliens rêvent aujourd’hui car la stabilisation du Proche-Orient aurait beaucoup à y gagner. En paix avec Israël et réconciliée avec les Occidentaux qui l’avaient ostracisée après l’assassinat, en 2005, de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, la Syrie s’éloignerait, de fait, de l’Iran dont elle le seul allié au Proche-Orient. Le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien en seraient affaiblis puisque c’est essentiellement par la Syrie que transitent aujourd’hui les livraisons d’armes iraniennes à ces mouvements islamistes. L’Autorité palestinienne en serait renforcée et cela pourrait ainsi contribuer à une reprise des pourparlers israélo-palestiniens et à la conclusion de cet accord de paix fondée sur la coexistence de deux Etats auquel Barack Obama ne désespère pas d’aboutir.
Cette carte syrienne aurait tellement d’avantages qu’on se dispute même l’honneur de la favoriser. Membre de l’Otan et candidate à l’entrée dans l’Union européenne, la Turquie voudrait reprendre sa mission de bons offices entre Israël et la Syrie qui avait été interrompue, il y a un an, par la guerre de Gaza. La Turquie voudrait devenir le pays qui aurait permis cette percée car le prestige qu’elle en retirerait jouerait en sa faveur à Bruxelles et renforcerait encore son influence dans l’ensemble d’une région sur laquelle son ancien empire, l’Empire ottoman, s’était étendu jusqu’à la Première Guerre mondiale.
La France voudrait, elle, utiliser les relations de confiance qu’elle a renouées avec Israël comme avec la Syrie pour s’imposer, là, en acteur de la scène internationale, en puissance médiatrice dans la région de tous les conflits. Quant aux Etats-Unis, ils voudraient évidemment trouver dans un accord israélo-syrien le succès qui se fait attendre sur le front israélo-palestinien.
Avec autant de parrains, la voie syrienne paraît être une autoroute pour la paix. Elles est d’autant plus prometteuse que la Syrie semble impatiente de récupérer le Golan et, surtout, de normaliser ses relations avec les Occidentaux car ses milieux d’affaires et sa classe moyenne voudraient réinscrire leur pays dans l’économie mondiale. Les militaires israéliens, l’état-major comme le ministre de la Défense, Ehud Barak, plaident en faveur d’un accord avec Damas mais Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien est, lui, beaucoup moins allant. Il craint que la Syrie ne veuille jouer sur les deux tableaux, se réconcilier avec les Etats-Unis mais ne pas s’éloigner, pour autant, de l’Iran. Il hésite et prend son temps, comme il le fait avec les Palestiniens.
|
Re: Géopolitique 05 février 2010, 01:45 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La locomotive relancée
Il y a fallu du temps. Ca manque d’éclat, de symboles forts, de mesures propres à frapper les imaginations et faire voir la réalité de ce nouveau rapprochement franco-allemand mais, sur le fond, c’est bien, solide et prometteur, pour les deux pays comme pour l’Union européenne.
C’est d’autant mieux que l’on revient de loin puisque, dans les premiers temps de son mandat, Nicolas Sarkozy n’avait d’yeux que pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, pour ce modèle anglo-saxon qu’il rêvait d’importer en France. En ce temps-là, le président de la République ne cachait pas qu’il se sentait plus à l’aise non seulement avec le libéralisme qu’avec le modèle européen mais avec les Britanniques qu’avec les Allemands.
Angela Merkel, de son côté, n’appréciait pas la familiarité de Nicolas Sarkozy et n’aimait pas, surtout, cette manière qu’il avait de tout tirer à lui, d’agir d’abord et de consulter ensuite. Ce moment a, évidemment, pesé sur la concrétisation du tournant pris, au début de l’été, par le président français, lorsqu’il s’est résolu – complet tête-à-queue – à ressouder le couple franco-allemand pour le faire parler d’une seule voix, dans l’Union comme sur la scène internationale.
La chancelière n’avait rien contre. Elle y était absolument favorable mais ne voulait ni d’emballements ni d’envolées lyriques. Elle voulait du sérieux, du concret, du vissé, pas de ce ministre commun aux deux gouvernements que proposait Paris, mais des projets dont il était sûr qu’ils puissent être menés à bien.
Les 80 mesures qui ont été dévoilées, hier, à Paris, à l’issue du douzième conseil des ministres franco-allemand, sonnent, ainsi, plus Merkel que Sarkozy mais n’en sont pas moins le fruit d’une impulsion donnée par le président de la République. Depuis la crise de Wall Street, Nicolas Sarkozy a tourné sa page libérale et dérégulatrice. Il a vu les dangers économiques d’une totale liberté du marché. Il a compris le risque politique qu’il y aurait à ne pas rééquilibrer le partage des richesses. Il s’est fait avocat d’une régulation du capitalisme qu’il veut promouvoir sur les cinq continents et c’est pour cela qu’il a conçu cette « volonté, disait-il hier, de mettre l’Allemagne et la France au service de l’Europe et d’une nouvelle régulation dans le monde ».
Si elles sont vraiment appliquées, ces 80 mesures ne vont pas seulement rapprocher la France et l’Allemagne. Elles portent en elles une dynamique – naturellement incertaine mais nouvelle – d’unité politique entre les deux pays qui se sont engagés, hier, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques au sein de l’Union. Le fonctionnement et le visage de l’Union européenne pourraient en être modifiés. La direction prise est la bonne et l’on pourra très vite juger sur pièces puisque la chancelière et le président ont annoncé, pour bientôt, des propositions communes sur le gouvernement économique de l’Union, des initiatives sur le Proche-Orient et une réflexion commune sur la réforme du système monétaire international. Cela fera autant de tests, d’occasions de ne pas décevoir.
|
Re: Géopolitique 08 février 2010, 10:01 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
La dernière manoeuvre de l'Iran
Mardi dernier, Mahmoud Ahmadinejad tendait la main. L’Iran n’a « pas de problème », disait-il, avec l’idée de faire enrichir son uranium à l’étranger. Le président iranien semblait ainsi relancer, et finalement accepter, le compromis envisagé au mois d’octobre, l’enrichissement, en Russie, puis le conditionnement, en France, du stock d’uranium iranien à un niveau et dans des conditions qui auraient interdit son usage militaire mais permis l’utilisation médicale que l’Iran souhaitait, officiellement, en faire.
Trois jours, plus tard, vendredi, son ministre des Affaires étrangères enfonçait le clou. « Un accord est proche », affirmait-il mais, hier, Mahmoud Ahmadinejad a refermé la porte qu’il venait d’entrouvrir en annonçant que son pays allait lui-même enrichir son uranium à 20%, pas encore le niveau nécessaire à la production d’armes atomiques mais un nouveau pas, néanmoins, vers la bombe puisque rien n’empêchera, ensuite, l’Iran d’aller vers les 80% nécessaires. Non seulement ce régime a dit blanc et noir en six jours mais, passant des mots aux actes, il a aussitôt annoncé que ces opérations d’enrichissement commenceraient dès demain, mardi, sur le site de Natanz.
Contrairement aux apparences, il n’y a rien d’irrationnel dans ces allers-et-retours. C’est sciemment, avec deux objectifs en tête, que les dirigeants iraniens soufflent alternativement le chaud et le froid. Depuis quatre mois, d’abord, ils font tout pour diviser les grandes puissances et éviter qu’elles ne prennent de nouvelles sanctions contre la République islamique. Lorsqu’ils paraissent envisager des mesures de confiance comme cet enrichissement à l’étranger, ils veulent faire renaître un espoir à la Maison-Blanche qui souhaiterait tant parvenir à une solution diplomatique ; freiner le durcissement de la Russie à leur égard et donner, surtout, des arguments à la Chine qui n’est pas du tout chaude pour de nouvelles sanctions car elle ne dédaigne aucun fournisseur de pétrole et n’a aucune envie de prêter la main aux Etats-Unis avec lesquels elle voudrait, au contraire, établir un rapport de force en profitant de leurs difficultés économiques et diplomatiques.
C’est ainsi que l’Iran dit « oui », « non », puis « oui » puis « non » depuis octobre en cherchant, à la fois, à retarder les sanctions et à poursuivre sa marche vers la bombe. C’est un jeu maintenant clair mais ce dernier épisode relève, lui, de la politique intérieure. En deux jours, ce régime a tout fait pour agiter le chiffon rouge et faire monter la tension internationale car, non content de son annonce sur l’enrichissement d’uranium, il a rendu public, hier également, une déclaration du Guide suprême, Ali Khamenei, affirmant, qu’avec « la volonté de Dieu, la destruction d’Israël sera imminente ». Tout cela ne vise qu’à une chose, amener l’Occident à hausser le ton contre l’Iran afin de pouvoir déclarer la patrie en danger et désigner comme des agents de l’étranger, des traîtres passibles de la peine de mort, les opposants qui s’apprêtent à manifester jeudi. C’est une provocation d’un nouveau genre – diplomatico-policière.
|
Re: Géopolitique 10 février 2010, 01:30 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Peut-être, un déblocage proche-oriental
Ce n’est pas officiellement confirmé, ni par Israël, ni par l’Autorité palestinienne, ni par les Etats-Unis. Comme tant de fois, cet espoir peut donc être déçu mais, après quinze jours de rumeurs concordantes, un haut responsable palestinien a indiqué, hier, à l’Agence France Presse, que des pourparlers indirects entre Israéliens et Palestiniens s’ouvriraient le 20 février prochain.
Les délégations ne seront pas face à face mais dans des pièces séparées. C’est le représentant spécial des Etats-Unis pour le Proche-Orient, Georges Mitchell, qui fera la navette entre elles car le président palestinien, Mahmoud Abbas, refuse de reprendre des pourparlers directs tant qu’Israël n’aura pas suspendu ses constructions dans l’ensemble des Territoires occupés, Jérusalem-est comprise. Il s’agit là d’un point hautement sensible pour les deux parties puisque les Palestiniens ne veulent pas d’un accord de paix qui ne leur restituerait pas les quartiers arabes de la ville alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ne veut pas, lui, sembler s’engager sur un partage de Jérusalem qui ne pourrait être, à ses yeux, et il ne le dit même pas officiellement, qu’un aboutissement des négociations et non pas constituer un préalable à leur ouverture.
Benjamin Netanyahu ne veut pas risquer un éclatement de sa coalition avec l’extrême droite tant qu’un éventuel progrès des pourparlers ne lui aura pas permis de trouver de nouveaux alliés au centre. Mahmoud Abbas, pour sa part, ne veut pas sembler renoncer à Jérusalem de peur d’être accusé de traîtrise par les plus radicaux des Palestiniens. C’est ce qui explique cette étrange régression des pourparlers indirects alors qu’Israéliens et Palestiniens sont en contacts directs et permanents depuis près de 20 ans mais, sur le fond, les Etats-Unis pourraient bien avoir fait avancer les choses.
Au prix de cette contorsion formelle, les deux parties devraient débattre pendant trois mois des frontières de l’Etat palestinien dont Benjamin Netanyahu a accepté le principe en juin dernier sans que son parti ni sa coalition n’en explosent. En parallèle à ces discussions, à la demande des Etats-Unis, Israël devrait libérer des prisonniers palestiniens, transférer le contrôle de nouvelles zones à l’Autorité palestinienne, cesser ses incursion dans celles qu’elle contrôle déjà, permettre l’entrée de matériaux de construction à Gaza et autoriser la réouverture de bureaux palestiniens à Jérusalem.
Pour la suite, on ne sait pas. Des plus roses aux plus sombres, tous les scénarios sont possibles mais, à ce stade, trois choses sont à retenir. Tous les grands partis israéliens acceptent, désormais, l’idée de la solution à deux Etats. Israël craint aujourd’hui moins la création d’un Etat palestinien que la menace iranienne et ne veut donc pas laisser se dégrader ses relations avec les Etats-Unis. Loin de renoncer à parvenir au règlement de ce conflit, Barack Obama non seulement n’a pas lâché prise mais va directement engager la crédibilité américaine dans ces pourparlers indirects. S’ils s’ouvrent réellement, si cet espoir n’est pas déçu, qui sait ? Peut-être…
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.