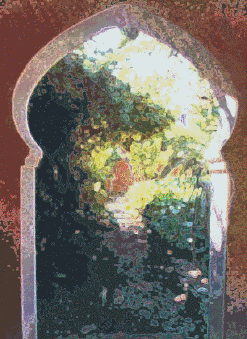|
|
Géopolitique
Envoyé par ladouda
|
Re: Géopolitique 11 février 2010, 01:47 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'Europe à l'heure du choix
Un enfant le comprendrait. On ne peut pas durablement avoir une monnaie commune sans avoir de politiques communes, des fiscalités au moins convergentes, une politique industrielle, des choix budgétaires compatibles et des niveaux de protection sociale comparables. On ne peut pas, en un mot, avoir d’union monétaire sans union politique et les dirigeants européens qui avaient lancé l’euro ne l’ignoraient évidemment pas.
Européens convaincus, Helmut Kohl et François Mitterrand, les pères de la monnaie unique, le comprenaient très bien mais ils avaient fait un pari. Puisque l’Europe n’était pas prête à l’unité politique, ils allaient créer, par la monnaie, la situation qui finirait par imposer un jour, nécessité faisant loi, une marche vers le fédéralisme. C’était un pari, mais on y est.
On y est parce qu’aucun des pays européens ne peut faire face à la crise à lui seul, pas même les plus puissants ; que le acteurs de ce nouveau siècle seront les Etats continents, Etats-Unis bien sûr mais aussi Chine, Inde ou Brésil ; que des puissances moyennes comme la France, l’Allemagne ou la Grande-Bretagne ne peuvent pas peser seules sur la scène internationale et que l’Espagne, la Pologne ou l’Italie le peuvent encore moins.
On y est parce que les révolutions technologiques à venir exigent des investissements et des efforts de recherche que les pays européens ne pourront pas consentir en ordre dispersé. On y est, enfin, parce que les maillons les plus faibles de l’eurozone sont confrontés, en ce moment même, à des attaques spéculatives auxquelles ils ne pourront pas faire face sans la solidarité de l’ensemble des pays de l’euro, que la monnaie unique en est virtuellement menacée et que les traités sont donc à revoir, ou à contourner, puisqu’ils interdisent explicitement que l’appartenance à l’euro puisse servir d’assurance vie à ceux des Etats qui n’auraient pas respecté la discipline commune ou, pire encore, triché comme le précédent gouvernement grec l’avait fait.
Raisons de court terme et de long terme, l’Europe n’a plus le choix. Ou bien elle se laisse défaire et laisse distancer chacun de ses membres, ou bien elle constate que l’euro l’a sauvée d’une tourmente dévastatrice après les faillites de Wall Street et prend le tournant nécessaire, marche, maintenant, vers l’élaboration de politiques communes, fatalement timides dans un premier temps mais qui finiront par la conduire à une forme ou l’autre de fédéralisme.
La réponse n’est pas donnée. L’Europe peut avoir peur d’elle-même, ne pas aller assez loin assez vite. On ne peut pas exclure le pire mais il est rassurant que l’Allemagne et la France aient décidé, avant même ces attaques spéculatives, de se rapprocher pour se mettre « au service de l’Europe et d’une nouvelle régulation dans le monde » ; que le Conseil européen de demain paraisse s’orienter vers un soutien collectif à la Grèce ; que l’on n’ait jamais autant parlé de coopération dans les capitales de l’Union et que les Européens se décident à œuvrer ensemble à la conception d’une voiture électrique, l’un des grands enjeux industriels du moment. On va voir mais c’est l’heure du choix.
|
Re: Géopolitique 11 février 2010, 11:49 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 1 517 |
Corruptions de toutes sortes de la part , des plus haut placés de l'autorité palestinienne.
Peut être pour ne pas renforcer le Hamas , qui n'est pas moins corrompu .
En bref c'est des millions européens ,qui passent dans les poches insatiables, des gens sensés sortir les palestiniens , de leur précarité.
On peut aussi voire l'adjoint D'Abou Mazen , chez une candidate pour obtenir un job.
Les conditions sont posées , et il l'attends dans le plumard de sa propre ,chambre a coucher.
Et la c'est un surprise qui l'attend .
[news.nana10.co.il]
|
Re: Géopolitique 12 février 2010, 14:44 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le pas franchi par l'Europe
L’idée faisait peur, dans presque dans toute l’Union et, notamment, en Allemagne. Ces mots mêmes de « gouvernement économique » de l’Europe étaient considérés comme des gros mots à ne pas employer, trop étatistes, trop dirigistes, trop français, mais, hier, au Conseil européen, avant, pendant et après ce conclave des 27 chefs d’Etat et de gouvernement, on n’entendait qu’eux et Angela Merkel elle-même, les a prononcés, comme si de rien n’était.
C’est elle qui a dit : « L’Union européenne doit mieux coopérer ce qui signifie que nous, les chefs d’Etat et de gouvernement, nous considérons comme un gouvernement économique des 27 ». C’est encore elle qui a dit : « Nous sommes d’accord pour nous concentrer sur un petit nombre de points mais qu’il faudra mettre en application ensemble. La crédibilité est la chose la plus importante pour un gouvernement économique européen » et Nicolas Sarkozy, bien sûr, n’était pas en reste.
Président de la République française, du pays qui a toujours défendu cette idée avec le seul appui ou presque de la Belgique et du Luxembourg, lui-même convaincu de longue date de cette nécessité pour l’Europe, a renchéri : « Ce qui s’est passé est très important car je n’ai pas entendu un seul pays contester la nécessité du gouvernement économique de l’Europe. Tout le monde est bien d’accord, a-t-il ajouté. C’est l’une des leçons de la crise et le gouvernement économique, cela veut dire que l’on va évaluer la situation, coordonner les politiques, organiser des initiatives dans le cadre du Conseil ».
Rien ne se fait jamais d’un coup dans l’Union car elle est composée de 27 Etats, tous à cheval sur leur souveraineté et confrontés à des cultures politiques et des niveaux de développement différents, mais Nicolas Sarkozy a raison d’insister sur l’importance de ce qui vient de se produire là. On n’en est pas encore à l’harmonisation des fiscalités ou des systèmes de protection sociale. On n’évoque pas même encore ce qui aurait dû être fait depuis longtemps dès lors qu’il y a un marché commun et une monnaie unique mais, oui, les défis de la crise de Wall Street et les attaques spéculatives lancées contre les maillons faibles de l’Union, Grèce en tête, ont précipité l’acceptation de cette idée d’un directoire économique, constitué par les 27 chefs d’Etat et de gouvernement et centré sur des objectifs acceptés par tous, essentiellement proposés par la France et l’Allemagne, toujours en cours de négociations mais qui devraient être assez prochainement annoncés, au printemps sans doute.
Bien plus qu’à moitié vide -ce qu'il est-, le verre est à moitié plein, non seulement parce qu’un pas essentiel vient d’être fait mais, surtout, parce qu’il porte en lui une dynamique d’harmonisation des politiques et d’ambitions communes dont le manque est la grande faiblesse de l’Europe. C’est un coup d’accélérateur qui vient d’être donné à l’Union, voulu par son nouveau président, Herman van Rompuy, permis par la France et l’Allemagne qui y travaillaient depuis l’été et accepté, c’est un fait, par tous les pays membres, y compris la Grande-Bretagne – celle, il est vrai, d’une majorité travailliste dont les mois paraissent comptés.
|
Re: Géopolitique 16 février 2010, 02:02 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le test du Helmand
La province afghane du Helmand s’étend au sud du pays, entre les frontières iranienne et pakistanaise. Verdoyante, vallonnée, c’est une riche région agricole, devenue l’un des bastions des taliban qui y ont fait main basse sur la culture du pavot, leur grande source de financement. C’est dans le Helmand que se rode la nouvelle stratégie afghane des Etats-Unis.
Quinze mille hommes de l’Otan, essentiellement américains et britanniques, y ont lancé, samedi, une offensive d’ampleur, lente, prudente, non pas un raid visant à infliger pertes et destructions aux taliban mais une entreprise de reconquête durable, menée pour le compte du gouvernement afghan dont plus de 2500 soldats participent à l’opération.
Des plans de reconstruction de la province sont prêts. Le projet est de la doter d’infrastructures, routes, écoles et dispensaires, qui devraient convaincre sa population qu’elle aurait plus intérêt à vivre sous l’administration de Kaboul que sous l’autorité des taliban qui, eux, n’ont pas de capitaux à investir. Une région après l’autre, des opérations de ce type devraient se multiplier en Afghanistan où le commandant en chef des forces de l’Otan, le général McChrystal, ambitionne de reprendre le contrôle du « pays utile » plutôt que de poursuivre la chasse aux taliban qu’il veut isoler et non plus traquer de cols montagneux en villages reculés.
Ce que ce général tente de faire aujourd’hui, c’est ce que les Américains auraient dû faire après avoir renversé les taliban aux lendemains des attentats du 11 septembre. S’ils avaient, alors, pris en main ce pays misérable et détruit par l’intervention soviétique et les guerres civiles qui lui avaient succédé, s’ils avaient consacré à sa reconstruction et sa modernisation ce qu’ils ont dépensé en opérations militaires inutiles, les Américains y seraient devenus aussi populaires qu’ils l’ont été en Europe après la Libération.
Las des taliban, les Afghans ne demandaient qu’à croire en l’Amérique et ses dollars mais Georges Bush avait aussitôt investi en Irak les hommes et les budgets qui auraient été nécessaires à l’Afghanistan. Les Afghans n’avaient rien vu venir, rien d’autre ou presque que des bombardements aveugles qui faisaient autant de victimes dans la population que parmi les taliban qui ont repris, aujourd'hui, le contrôle de plus de la moitié du pays.
Là, dans le Helmand, les Américains progressent sur le terrain et organisent, quartier après quartier, des réunions ouvertes où ils exposent à la population leur buts et leurs projets d’investissement. Il y a eu peu de victimes civiles depuis samedi mais l’heure de vérité sonnera quand les troupes de l’Otan laisseront la place aux soldats et policiers afghans dont la corruption est plus grande que l’efficacité et quand il faudra passer, surtout, à la destruction des cultures de pavot qui rapportent infiniment plus que tout ce qu’on pourra leur substituer. Plus intelligemment conduite, cette guerre reste à gagner.
|
Re: Géopolitique 17 février 2010, 13:16 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Les vrais enjeux d'une crise
Tout concourt à obscurcir la crise grecque et ses répercussions sur l’Union. Paris et Berlin en tête, les grandes capitales européennes s’acharnent, en premier lieu, à cacher leurs divergences sur les remèdes à y apporter. Les 27 ne peuvent pas publiquement dire, en deuxième lieu, ce qu’ils sont prêts à faire pour aider la Grèce à résister à l’inflation des taux d’emprunt qui lui sont demandés car il ne s’agit pas de rassurer mais d’inquiéter les marchés, non pas de fournir une feuille de route à la spéculation mais de la laisser dans le noir. Et puis, en troisième lieu, feutrée, non dite mais évidente, une bataille se joue derrière cette crise sur des enjeux aussi fondamentaux que le pacte de stabilité sur lequel est fondé l’union monétaire ou l’ampleur des mesures à prendre, dans chacun des pays membres, pour réduire des déficits et un endettement publics que les faillites de Wall Street ont singulièrement aggravés.
Reprenons. Premier point, soutenue par l’Italie, l’Espagne et le Portugal, la France plaide pour que les brutales mesures de réduction de ses déficits que l’Europe impose à la Grèce ne le soient pas trop alors que l’Allemagne, soutenue par la Suède, l’Autriche et les Pays-Bas, se montre intraitable. Tous les Européens – ils l’ont redit hier – veulent que la Grèce commence par s’aider elle-même, qu’elle assainisse ses finances pour pouvoir emprunter à des taux normaux, ne pas entraîner l’euro dans sa tourmente et ne pas obliger ses partenaires de l’Union à l’aider à fonds perdus. Cette exigence est drastique puisque la Grèce est sommée de ramener, dès cette année, son déficit de 12,7% à 8,7% de son produit intérieur brut et de le faire passer sous la barre des 3% en 2012 mais l’unité européenne s’arrête là. Parce qu’elle craint des troubles sociaux à Athènes et ne voudrait pas être, un jour, confrontée à d’aussi dures exigences, la France prône une souplesse dans l’application de ces mesures. En coulisses, elle s’oppose ainsi, à l’Allemagne qui veut, elle, profiter de cette crise pour rappeler les pays de l’euro à la rigueur et doit compter, avec ses libéraux, partenaires de la démocratie chrétienne dans la coalition d’Angela Merkel.
Deuxième point, non seulement les 27 ne veulent pas faciliter la tâche des spéculateurs en détaillant les mesures qu’ils seraient prêts à prendre pour soutenir la Grèce mais, à l’instar des Allemands, les plus rigoristes des Européens ne veulent pas non plus donner d’assurances au gouvernement grec tant qu’il n’aura pas bu le calice de l’austérité jusqu’à la lie.
Ce qui se joue, enfin, derrière tout cela, c’est la définition des politiques économiques communes dont l’Union veut désormais se doter. Ces politiques communes sont devenues nécessaires. Chacun finit par en convenir mais toute la question est de savoir ce qu’elles doivent être, si elles doivent se fonder sur une proscription des déficits publics et une réduction de la protection sociale, comme le souhaitent les plus rigoristes, ou sur plus de souplesse comme le voudraient d’autres. C’est aux balbutiements de l’Europe politique qu’on assiste là et, dans la bataille qu’ils suscitent, chacun veut faire de la Grèce un exemple, un précédent qui fixerait un standard.
|
Re: Géopolitique 02 mars 2010, 09:54 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'ami russe de l'Elysée
L’expression est bien trop pompeuse. « Partenariat stratégique », dit-on de ce rapprochement franco-russe marqué par la visite à Paris de Dmitri Medvedev alors qu'il ne s’agit pas de l’instauration d’un lien privilégié entre les deux pays, d’une alliance fondée sur des vues et des politiques communes telle qu’il en existe, par exemple, entre la France et l’Allemagne.
Avec la Russie, c’est autre chose. Il y a, oui, c’est vrai, comme une résurgence d’une constante connivence historique, celle des alliances de revers contre l’Allemagne, celle de la carte russe dont De Gaulle avait joué pour affirmer l’indépendance française au sein de l’Alliance atlantique ou, plus récemment, celle de la convergence entre Paris et Moscou dans l’opposition à l’aventure irakienne. Ce passé inscrit le rapprochement présent dans une continuité singulière mais, sur le fond, la France n’est pas seule à se rapprocher de la Russie.
L’Allemagne l’a largement précédée sur cette voie et acquis à Moscou des positions économiques que Paris n’y a pas. La plupart des capitales européennes entretiennent les meilleures relations avec le Kremlin. Depuis l’élection de Barack Obama, les Etats-Unis, surtout, ont rompu avec tout ce qui pouvait fâcher la Russie dans leur politique, aussi bien avec l’idée d’installation d’un bouclier antimissiles en Europe centrale qu’avec le projet d’intégration de l’Ukraine et de la Géorgie à l’Otan.
Ce tournant, les Etats-Unis l’ont pris lorsqu’ils ont réalisé que la Russie était indispensable à la solution des crises internationales les plus brûlantes, crise iranienne en tête. Toutes les capitales occidentales font désormais ce même constat qu’Allemands et Français avaient été les premiers à formuler. Nicolas Sarkozy ne fait aujourd’hui qu’en tirer les conséquences en recevant Dmitri Medvedev avec une chaleur rare mais le fait est que, politiquement et humainement parlant, il a su prendre une longueur d’avance dans la relation avec son hôte.
Considérable, son avantage est d’avoir très vite pris, à l’été 2008, la dimension de ce si jeune président russe, tout juste élu par la grâce de Vladimir Poutine qui en avait son successeur faute de pouvoir briguer un troisième mandat consécutif. Alors président de l’Union européenne, Nicolas Sarkozy avait décidé de s’entremettre dans la crise géorgienne et, au lieu d’ignorer Dmitri Medvedev, au lieu de ne voir en lui qu’une simple « marionnette » de son prédécesseur, au lieu de commettre l’erreur que chacun ou presque faisait jusqu’il y a deux mois encore, c’est avec lui qu’il avait négocié et conclu le moins mauvais des compromis possibles.
Nicolas Sarkozy est le premier chef d’Etat à avoir traité Dmitri Medvedev en président de la Russie et, à l’heure où cet homme s’affirme sur sa scène intérieure en y faisant entendre une autre voix, moins autoritaire et plus ouverte à l’Occident que celle de Vladimir Poutine, cela donne des atouts à la France. Entre ces deux hommes, il y a une vraie confiance, personnelle, et cela compte.
|
Re: Géopolitique 04 mars 2010, 15:40 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Le pari proche-oriental d'Obama
Rien ou beaucoup de choses, la question est, désormais, de savoir sur quoi cela peut déboucher. Maintenant que le président palestinien, Mahmoud Abbas, a obtenu, hier, le feu vert qu’il souhaitait de la Ligue arabe, maintenant que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, s’en est félicité et que les Etats-Unis s’en sont déclarés « très contents », il ne fait plus de doute qu’Israéliens et Palestiniens vont très bientôt ouvrir des pourparlers indirects, comme on l’avait annoncé, dans cette chronique, il y a presque un mois.
Ils ne seront pas face-à-face. C’est Georges Mitchell, le représentant spécial des Etats-Unis pour le Proche-Orient, qui fera la navette entre eux car les Palestiniens ne voulaient pas reprendre de pourparlers directs tant que les Israéliens n’auront pas définitivement arrêté, y compris à Jérusalem-est, la colonisation des Territoires occupés. Il y a, là, une sorte de régression puisqu’il y a plus de vingt ans que dirigeants israéliens et palestiniens se parlent et se rencontrent quotidiennement mais le fait est qu’ils vont ainsi rouvrir, indirectement ou pas, les pourparlers de paix qui avaient été interrompus, il y a quatorze mois, par l’offensive israélienne contre Gaza.
Fragile mais réel, c’est un progrès mais il y a deux manières de l’analyser. Les pessimistes diront que cela ne peut déboucher sur rien car les Palestiniens, et la Ligue arabe derrière eux, n’ont accepté cette contorsion que sous la pression américaine, parce qu’ils ne voulaient ni affaiblir Barack Obama qui aurait été humilié par un échec de ses efforts de relance du processus de paix ni risquer, surtout, de paraître responsables de cet échec alors que Benjamin Netanyahu avait d’ores et déjà accepté cette formule.
Palestiniens, Arabes et Américains sauvent la face, disent les pessimistes, mais cela ne pourra mener à rien, expliquent-ils, car ce gouvernement israélien, le plus à droite qu’ait jamais connu le pays, ne voudra rien céder sur Jérusalem alors que les Palestiniens font du partage de cette ville de toutes les discordes la condition sine qua non d’un règlement. Il est très possible qu’ils aient raison. S’il fallait parier aujourd’hui, c’est avec eux qu’il faudrait le faire mais les optimistes, ou les moins pessimistes, ne manquent pas non plus d’arguments.
Tous les grands partis israéliens acceptent, désormais, l’idée de la solution à deux Etats à laquelle le Likoud de Benjamin Netanyahu s’est finalement rallié, en juillet dernier. Il l’a fait pour deux raisons de fond qui sont, premièrement, qu’Israël craint aujourd’hui moins la création d’un Etat palestinien que la menace iranienne et ne veut donc pas laisser se dégrader ses relations avec Washington et, deuxièmement, que tous les grands partis israéliens ont maintenant compris que, faute d’un Etat, les Palestiniens demanderaient, un jour, à devenir citoyens d’Israël où il seraient vite majoritaires.
Israël évolue et, dernier motif d’optimisme, c’est la crédibilité des Etats-Unis que Barack Obama engage dans ces pourparlers indirects. L’Amérique peut difficilement se permettre de complètement échouer.
|
Re: Géopolitique 05 mars 2010, 01:10 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
Fragile renaissance en Irak
Ces bombes sont trompeuses. Trois sanglants attentats ont marqué, hier, le début des élections parlementaires irakiennes qui s’achèveront dimanche. Il est malheureusement improbable que le couvre-feu et les mesures de sécurité exceptionnelles qui entourent ce scrutin empêchent qu’il ne s’en produise d’autres mais les choses s’améliorent en Irak et ce vote pourrait les améliorer encore.
L’Irak reprend espoir pour trois raisons. La première est, que dès la seconde moitié du dernier mandat de Georges Bush, les Etats-Unis y avaient corrigé la plus grave de leurs erreurs en cessant d’ostraciser la minorité sunnite, un quart de la population, au motif que c’était sur elle que s’était appuyé Saddam Hussein. Jamais dite mais bel bien appliquée par le biais du renvoi de tous les fonctionnaires et militaires qui avaient appartenu au parti Baath, celui de l’ancien régime, cette politique avait privé le pays de ses meilleurs cadres, incité nombre de militaires à rejoindre les réseaux d’al Qaeda et dressé la majorité des sunnites contre les Américains et le pouvoir qu’ils mettaient en place.
C’est ainsi que s’étaient instaurées les années de chaos et de tueries quotidiennes mais cette page est aujourd’hui tournée. Dès que les Américains leur ont donné des assurances sur leur sort, les sunnites ont rompu avec le terrorisme, isolé al Qaeda et ainsi contribué à un retour au calme, bien relatif, fragile mais réel.
La deuxième raison de l’amélioration en cours et que les élections de 2005 avaient permis l’émergence d’un premier ministre, Nouri al-Maliki, issu de la majorité chiite mais, l’un dans l’autre, respectueux des autre communautés, qui a su petit à petit imposer l’autorité de son gouvernement et commencer à remettre l’Irak en marche. C’est si vrai que troisième raison d’espérer, les sunnites participent à ces élections alors qu’ils avaient boycotté les précédentes.
S’il n’y a pas trop d’attentats d’ici dimanche soir et qu’une coalition majoritaire peut se dégager de ce vote – deux conditions de poids – Barack Obama aurait alors la possibilité de tenir son engagement, réitéré, en janvier, dans le discours sur l’état de l’Union, d’avoir rappelé toutes les troupes américaines d’ci la fin de l’année prochaine après avoir retiré, dans six mois, les troupes opérationnelles. L’Amérique peut être bientôt sortie du guêpier irakien et avoir laissé derrière elle une démocratie naissante mais, même alors, deux grandes questions resteraient posées.
La première est de savoir si chiites, Kurdes et sunnites sauront parvenir à un partage durable du pouvoir et des richesses pétrolières avant que les pays limitrophes ne transforment l’Irak en champ de leurs affrontements. Rien ne le garantit encore et la seconde question est de savoir comment l’Irak, majoritairement chiite, pourra échapper à la force d’attraction de l’Iran, pays phare du chiisme qui compte bien y prendre la place des Etats-Unis. Y compris chez les chiites, il y a un nationalisme irakien d’autant plus vif que l’Iran n’est, aujourd’hui, guère séduisant. Rien n’est joué pour Téhéran mais ses agents sont très actifs en Irak et son argent y coule à flots.
|
Re: Géopolitique 06 mars 2010, 07:22 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 3 376 |
La cause perdue de Biden - Par CAROLINE GLICK - Pour Jerusalem Post - 5 Mars 2010
[www.jpost.com]
Adaptation française de Sentinelle 5770
La tâche du vice-président des USA Joseph Biden va cesser d’être aisée. En fait, elle va devenir impossible.
Lundi, il va venir en Israël pour une visite de trois jours. Biden, qui va rencontrer les dirigeants d’Israël, sera l’officiel de plus haut rang dans la cavalcade des officiels américains venus en Israël ces dernières semaines. Il suivra le sénateur John Kerry, président du comité sénatorial des affaires étrangères, qui était là cette semaine. Kerry lui-même succédait à l’amiral Michael Mullen, chef d’Etat Major Général des armées, qui était là il y a deux semaines.
Dans sa conférence de presse lundi, Kerry expliquait l’objectif de ces visites : « Je suis là et d’autres sont venus et le vice-président Biden va venir sous peu… pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’ondes et que nous sommes d’accord sur [l’Iran] ».
Bien que Biden soit simplement le dernier officiel américain en visite en Israël pour tenter de contraindre le gouvernement à ne pas empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire, sa visite est une nouveauté en un sens. En plus de ses rencontres avec le Premier Ministre Benyamin Netanyahou et le reste des officiels israéliens de haut rang, Biden a l’intention de défendre le dossier de la politique du gouvernement Obama envers l’Iran, les Palestiniens et Israël, directement devant le public israélien. Pendant son voyage, il délivrera ce qui est qualifié de discours politique majeur à l’Université de Tel Aviv.
A la lumière de la disparité croissante entre la politique du gouvernement Obama et celle du gouvernement israélien, l’objectif apparent du discours de Biden est d’étayer la position de la Gauche israélienne comme alternative à Netanyahu. Apparemment, le tableau qui ressort de toutes les rencontres des officiels américains de haut rang avec Netanyahu, c’est que le dirigeant d’Israël continue d’être à l’aise en les défiant. Sans doute croient-ils maintenant que la seule manière de l’obliger à marcher droit, c’est de lui faire croire que le prix du défi sera son poste de Premier Ministre.
Il s’agit bien sûr d’une tâche difficile. Après tout la Gauche a été largement battue lors de l’élection l’an passé. En faire une alternative crédible n’est pas une tâche aisée.
La Gauche israélienne de son côté fait de son mieux pour lier ses propres destinées au gouvernement US. La chef de l’opposition, Tzipi Livni s’est elle-même carrément placée dans le camp d’Obama cette semaine pendant sa confrontation avec Netanyahou à la Knesset. Négligeant les résultats du sondage Gallup du mois dernier montrant qu’Israël bénéficie du soutien des deux tiers de Américains, (et de 80 % des Républicains contre 53 % des Démocrates), Livni a reproché au Premier Ministre l’image internationale d’Israël.
En ne s’inclinant pas devant les exigences d’Obama, en ne mettant pas fin à toute construction juive à Jérusalem et en n’acceptant pas les propositions radicales de paix qu’elle et son ancien premier ministre Ehud Olmert avaient faites aux Palestiniens pendant leur mandat aux responsabilités, Livni a déclaré que Netanyahou ruine la position diplomatique d’Israël aux USA et à travers le monde.
Il n’y a rien de neuf ou de surprenant quant à l’usage que Livni fait de l’animosité du gouvernement Obama envers notre gouvernement comme moyen de se positionner en alternative au gouvernement. Superficiellement, cela fait sens pour elle de l’utiliser. Après tout, c’était en construisant un partenariat avec l’administration Clinton contre Netanyahou la dernière fois qu’il était au pouvoir que la Gauche israélienne a pu faire tomber son gouvernement et gagner l’élection de 1999.
L’espoir de la Gauche de former une coalition avec Obama contre Netanyahou a reçu son expression la plus explicite en juillet dernier dans un éditorial de couverture d’Aluf Benn du journal ‘Haaretz’s’ publié dans le ‘New York Times’. Après s’être exprimé en faveur de la politique d’Obama, Benn déplorait que du fait des faibles taux d’approbation d’Obama parmi les Juifs israéliens (à l’époque ils étaient de 6 % et les derniers ont plongé à 4 %), il serait difficile pour lui de convaincre le public israélien d’abandonner son soutien à Netanyahou en faveur de la politique d’Obama – c'est-à-dire pour la Gauche israélienne. Pour améliorer cet état de choses lamentable, Benn suggérait qu’Obama avait seulement besoin de défendre son cas devant le public israélien, qui « l’écoutera sûrement ».
En ce qui concerne Benn et ses amis gauchistes, les problèmes de crédibilité d’Obama n’étaient pas liés à sa politique, que la Gauche soutient. Bien plutôt, ils étaient liés à son incapacité à éblouir le peuple israélien avec la même magie rhétorique que celle utilisée avec les Arabes et les Européens. C’était le ton d’Obama, pas ses programmes, qui devait être amélioré.
Argumentant ainsi, Benn et Livni et leurs collègues de la Gauche, agissent en mémoire de leurs jours de gloire avec l’administration Clinton. Comme président, Bill Clinton était capable d’étreindre simultanément Yasser Arafat, et de faire tomber Netanyahou sans que jamais personne ne le mît en question sur son amour éternel pour Israël et les Juifs. De ce fait, il devint le héros de la Gauche israélienne qu’il fit revenir au pouvoir en 1999.
Comme la Gauche le voit, Clinton conserva sa réputation de plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche, bien que sa politique fût la plus hostile des USA jamais adoptée envers Israël, parce qu’il savait comment charmer l’électorat israélien. Ses fréquentes visites en Israël et son susucre, ses déclarations la bouche en coeur pour Yitzhak Rabin et Israël étaient tout ce qu’il fallait dans leur opinion pour convaincre le public de rejeter la Droite. Si Obama se contentait de répéter les pratiques de Clinton, lui aussi pourrait faire tomber Netanyahou et convaincre le public israélien de lui faire confiance.
Quand l’article de Benn a été publié, sa recommandation a été ignorée par le gouvernement US. De même, la Maison Blanche rejeta des demandes répétées des media locaux d’entretiens avec le président. Maintenant cependant, avec les taux de soutien américain d’Obama en chute et sa politique avec l’Iran en lambeaux, la Maison Blanche a semble-t-il décidé qu’elle doit lancer une offensive de charme en Israël pour rendre Netanyahou plus vulnérable à la coercition.
Biden a été retenu pour cette tâche parce qu’il est largement perçu comme le plus pro israélien des membres de haut rang du gouvernement. Le fait qu’avant de devenir vice président, Biden disposait du taux le plus élevé d’approbation en faveur de l’Iran au Sénat n’a rien fait pour tempérer cette perception.
De fait, bien que Biden ait voté de façon répétée contre des sanctions envers l’Iran et déclaré que la recherche par l’Iran d’une bombe nucléaire était compréhensible, et appelé les USA à signer un pacte de non agression avec la mollahcratie, tout en menaçant de mettre en oeuvre une procédure “d’impeachment” à l’encontre du président George W. Bush s’il devait ordonner une frappe militaire contre les armes nucléaires de l’Iran, Biden continue d’être considéré comme un solide partisan d’Israël.
De fait, en ligne avec cette perception, on peut s’attendre à ce qu’il déclare plusieurs fois son amour éternel pour l’Etat juif pendant son discours à l’Université de Tel Aviv. Pourtant, et malheureusement pour la Gauche israélienne et le gouvernement Obama, son offensive de charme échouera à séduire la promise. Le mieux que sa visite puisse obtenir est une hausse momentanée du soutien des Israéliens qui redescendra bien vite. Il y a quatre raisons à cela.
D’abord, Obama lui-même est beaucoup plus faible que ne l’était Clinton. Ses tentatives obséquieuses de chercher à se faire bien voir des Arabes et de l’Iran ont été encore plus troublantes pour les Israéliens que son refus de visiter le pays. De plus, à l’inverse de Clinton, populaire avec les Israéliens avant même son élection, Obama n’a jamais été populaire en Israël. Cela peut être dû en partie au timing. Bien sûr Clinton a succédé à George H.W. Bush (père), profondément impopulaire en Israël. Obama a remplacé son fils – considéré comme un grand ami d’Israël.
Selon la faiblesse d’Obama, il est difficile de voir comment il peut convaincre le public israélien qu’il sera capable de protéger le pays d’un Iran doté de l’arme nucléaire ou qu’il pourra obliger les Palestiniens et les Syriens à mette fin à leur soutien au terrorisme dans l’hypothèse d’un retrait israélien de Judée, de Samarie ou des Hauteurs du Golan.
Ensuite, le Netanyahou auquel Obama est confronté n’est pas celui auquel Clinton était confronté dans les années 1990. Aujourd’hui, le Premier Ministre dirige une coalition beaucoup plus large que dans son précédent gouvernement. Elle est aussi beaucoup plus stable. Le ministre de la défense, Ehud Barak, chef du Parti Travailliste, sait qu’il ne peut déloger Netanyahu. En fait, il sait qu’il ne peut même pas se fier à son parti pour continuer à le soutenir s’il abandonne le gouvernement Netanyahou. De même, pour Tzipi Livni, chef de l’opposition, les derniers sondages montrent qu’elle se traîne loin derrière Netanyahou dans le choix du public comme Premier Ministre. Le niveau de popularité de son parti diminue. Celui du Likoud monte.
Troisièmement, il y a le fait qu’aujourd’hui la Gauche ne contrôle pas l’opinion publique au point où elle y parvenait la dernière fois que Netanyahou était au pouvoir. Pendant son premier gouvernement, du fait en grande partie de la délégitimation de la Droite par les media à la suite de l’assassinat de Rabin, les media étaient en mesure de vendre l’OLP comme partenaire de paix crédible. Yasser Arafat lui-même était dépeint par une émission de télévision populaire comme une adorable marionnette pacifiste qui ne voulait que faire la paix avec un Netanyahou lâche et belliqueux.
Par conséquent, il devenait socialement inacceptable dans les cercles bien élevés d’admettre qu’Arafat et les Palestiniens étaient moins dédiés à la notion de coexistence pacifique avec Israël, ou que Netanyahou avait raison de ne pas abandonner la boutique. De même, il était socialement inacceptable dans certains quartiers de critiquer Clinton, qui se présentait comme le plus grand ami de Rabin. Aujourd’hui, le public est bien moins embarrassé pour faire ces remarques.
C’est le cas bien sûr pour la quatrième raison de l’échec de la mission Biden. Au cours des onze années depuis que Netanyahou a été chassé de son poste, la plateforme politique de la Gauche a été discréditée par les évènements. Depuis 1999, les Palestiniens – de même que les Libanais – ont démontré que la politique de compromis de la Gauche est désastreuse. Les 1.500 Israéliens qui ont été tués depuis lors par les Palestiniens et le Hezbollah, la transformation du Sud Liban et de Gaza après le retrait israélien en enclaves jihadistes, la montée de l’Iran, et le rejet ouvert par le Fatah du droit à l’existence d’Israël ont tous contribuer à rendre inacceptable la politique de la Gauche pour une large majorité d’Israéliens.
Le rejet par le public de la politique de la Gauche est si impressionnant qu’il y a même rejet de la déclaration centrale actuelle de la Gauche – à savoir qu’Israël va perdre sa majorité juive s’il refuse de rendre la Judée et la Samarie. Selon une répartition de 53 contre 28 %, un sondage du Haaretz le mois dernier a montré que les Israéliens ne croient pas que la présence continue d’Israël dans ces régions conduira à sa destruction comme Etat juif.
Ce que tout cela démontre bien sûr, c’est qu’il va falloir bien plus qu’un changement de ton au gouvernement Obama pour gagner le public israélien. L’hostilité ouverte d’Obama envers Netanyahou a été probablement un facteur significatif pour étayer le taux d’approbation publique dans ses réalisations à son poste.
Le public israélien n’est pas intéressé par un changement de ton – de la part d’Obama ou de la Gauche israélienne. Il est intéressé par un changement de politique. Jusqu’à ce qu’il l’obtienne, le public, selon toute probabilité, restera loyal à Netanyahou
[www.jpost.com]
Adaptation française de Sentinelle 5770
La tâche du vice-président des USA Joseph Biden va cesser d’être aisée. En fait, elle va devenir impossible.
Lundi, il va venir en Israël pour une visite de trois jours. Biden, qui va rencontrer les dirigeants d’Israël, sera l’officiel de plus haut rang dans la cavalcade des officiels américains venus en Israël ces dernières semaines. Il suivra le sénateur John Kerry, président du comité sénatorial des affaires étrangères, qui était là cette semaine. Kerry lui-même succédait à l’amiral Michael Mullen, chef d’Etat Major Général des armées, qui était là il y a deux semaines.
Dans sa conférence de presse lundi, Kerry expliquait l’objectif de ces visites : « Je suis là et d’autres sont venus et le vice-président Biden va venir sous peu… pour s’assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’ondes et que nous sommes d’accord sur [l’Iran] ».
Bien que Biden soit simplement le dernier officiel américain en visite en Israël pour tenter de contraindre le gouvernement à ne pas empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire, sa visite est une nouveauté en un sens. En plus de ses rencontres avec le Premier Ministre Benyamin Netanyahou et le reste des officiels israéliens de haut rang, Biden a l’intention de défendre le dossier de la politique du gouvernement Obama envers l’Iran, les Palestiniens et Israël, directement devant le public israélien. Pendant son voyage, il délivrera ce qui est qualifié de discours politique majeur à l’Université de Tel Aviv.
A la lumière de la disparité croissante entre la politique du gouvernement Obama et celle du gouvernement israélien, l’objectif apparent du discours de Biden est d’étayer la position de la Gauche israélienne comme alternative à Netanyahu. Apparemment, le tableau qui ressort de toutes les rencontres des officiels américains de haut rang avec Netanyahu, c’est que le dirigeant d’Israël continue d’être à l’aise en les défiant. Sans doute croient-ils maintenant que la seule manière de l’obliger à marcher droit, c’est de lui faire croire que le prix du défi sera son poste de Premier Ministre.
Il s’agit bien sûr d’une tâche difficile. Après tout la Gauche a été largement battue lors de l’élection l’an passé. En faire une alternative crédible n’est pas une tâche aisée.
La Gauche israélienne de son côté fait de son mieux pour lier ses propres destinées au gouvernement US. La chef de l’opposition, Tzipi Livni s’est elle-même carrément placée dans le camp d’Obama cette semaine pendant sa confrontation avec Netanyahou à la Knesset. Négligeant les résultats du sondage Gallup du mois dernier montrant qu’Israël bénéficie du soutien des deux tiers de Américains, (et de 80 % des Républicains contre 53 % des Démocrates), Livni a reproché au Premier Ministre l’image internationale d’Israël.
En ne s’inclinant pas devant les exigences d’Obama, en ne mettant pas fin à toute construction juive à Jérusalem et en n’acceptant pas les propositions radicales de paix qu’elle et son ancien premier ministre Ehud Olmert avaient faites aux Palestiniens pendant leur mandat aux responsabilités, Livni a déclaré que Netanyahou ruine la position diplomatique d’Israël aux USA et à travers le monde.
Il n’y a rien de neuf ou de surprenant quant à l’usage que Livni fait de l’animosité du gouvernement Obama envers notre gouvernement comme moyen de se positionner en alternative au gouvernement. Superficiellement, cela fait sens pour elle de l’utiliser. Après tout, c’était en construisant un partenariat avec l’administration Clinton contre Netanyahou la dernière fois qu’il était au pouvoir que la Gauche israélienne a pu faire tomber son gouvernement et gagner l’élection de 1999.
L’espoir de la Gauche de former une coalition avec Obama contre Netanyahou a reçu son expression la plus explicite en juillet dernier dans un éditorial de couverture d’Aluf Benn du journal ‘Haaretz’s’ publié dans le ‘New York Times’. Après s’être exprimé en faveur de la politique d’Obama, Benn déplorait que du fait des faibles taux d’approbation d’Obama parmi les Juifs israéliens (à l’époque ils étaient de 6 % et les derniers ont plongé à 4 %), il serait difficile pour lui de convaincre le public israélien d’abandonner son soutien à Netanyahou en faveur de la politique d’Obama – c'est-à-dire pour la Gauche israélienne. Pour améliorer cet état de choses lamentable, Benn suggérait qu’Obama avait seulement besoin de défendre son cas devant le public israélien, qui « l’écoutera sûrement ».
En ce qui concerne Benn et ses amis gauchistes, les problèmes de crédibilité d’Obama n’étaient pas liés à sa politique, que la Gauche soutient. Bien plutôt, ils étaient liés à son incapacité à éblouir le peuple israélien avec la même magie rhétorique que celle utilisée avec les Arabes et les Européens. C’était le ton d’Obama, pas ses programmes, qui devait être amélioré.
Argumentant ainsi, Benn et Livni et leurs collègues de la Gauche, agissent en mémoire de leurs jours de gloire avec l’administration Clinton. Comme président, Bill Clinton était capable d’étreindre simultanément Yasser Arafat, et de faire tomber Netanyahou sans que jamais personne ne le mît en question sur son amour éternel pour Israël et les Juifs. De ce fait, il devint le héros de la Gauche israélienne qu’il fit revenir au pouvoir en 1999.
Comme la Gauche le voit, Clinton conserva sa réputation de plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche, bien que sa politique fût la plus hostile des USA jamais adoptée envers Israël, parce qu’il savait comment charmer l’électorat israélien. Ses fréquentes visites en Israël et son susucre, ses déclarations la bouche en coeur pour Yitzhak Rabin et Israël étaient tout ce qu’il fallait dans leur opinion pour convaincre le public de rejeter la Droite. Si Obama se contentait de répéter les pratiques de Clinton, lui aussi pourrait faire tomber Netanyahou et convaincre le public israélien de lui faire confiance.
Quand l’article de Benn a été publié, sa recommandation a été ignorée par le gouvernement US. De même, la Maison Blanche rejeta des demandes répétées des media locaux d’entretiens avec le président. Maintenant cependant, avec les taux de soutien américain d’Obama en chute et sa politique avec l’Iran en lambeaux, la Maison Blanche a semble-t-il décidé qu’elle doit lancer une offensive de charme en Israël pour rendre Netanyahou plus vulnérable à la coercition.
Biden a été retenu pour cette tâche parce qu’il est largement perçu comme le plus pro israélien des membres de haut rang du gouvernement. Le fait qu’avant de devenir vice président, Biden disposait du taux le plus élevé d’approbation en faveur de l’Iran au Sénat n’a rien fait pour tempérer cette perception.
De fait, bien que Biden ait voté de façon répétée contre des sanctions envers l’Iran et déclaré que la recherche par l’Iran d’une bombe nucléaire était compréhensible, et appelé les USA à signer un pacte de non agression avec la mollahcratie, tout en menaçant de mettre en oeuvre une procédure “d’impeachment” à l’encontre du président George W. Bush s’il devait ordonner une frappe militaire contre les armes nucléaires de l’Iran, Biden continue d’être considéré comme un solide partisan d’Israël.
De fait, en ligne avec cette perception, on peut s’attendre à ce qu’il déclare plusieurs fois son amour éternel pour l’Etat juif pendant son discours à l’Université de Tel Aviv. Pourtant, et malheureusement pour la Gauche israélienne et le gouvernement Obama, son offensive de charme échouera à séduire la promise. Le mieux que sa visite puisse obtenir est une hausse momentanée du soutien des Israéliens qui redescendra bien vite. Il y a quatre raisons à cela.
D’abord, Obama lui-même est beaucoup plus faible que ne l’était Clinton. Ses tentatives obséquieuses de chercher à se faire bien voir des Arabes et de l’Iran ont été encore plus troublantes pour les Israéliens que son refus de visiter le pays. De plus, à l’inverse de Clinton, populaire avec les Israéliens avant même son élection, Obama n’a jamais été populaire en Israël. Cela peut être dû en partie au timing. Bien sûr Clinton a succédé à George H.W. Bush (père), profondément impopulaire en Israël. Obama a remplacé son fils – considéré comme un grand ami d’Israël.
Selon la faiblesse d’Obama, il est difficile de voir comment il peut convaincre le public israélien qu’il sera capable de protéger le pays d’un Iran doté de l’arme nucléaire ou qu’il pourra obliger les Palestiniens et les Syriens à mette fin à leur soutien au terrorisme dans l’hypothèse d’un retrait israélien de Judée, de Samarie ou des Hauteurs du Golan.
Ensuite, le Netanyahou auquel Obama est confronté n’est pas celui auquel Clinton était confronté dans les années 1990. Aujourd’hui, le Premier Ministre dirige une coalition beaucoup plus large que dans son précédent gouvernement. Elle est aussi beaucoup plus stable. Le ministre de la défense, Ehud Barak, chef du Parti Travailliste, sait qu’il ne peut déloger Netanyahu. En fait, il sait qu’il ne peut même pas se fier à son parti pour continuer à le soutenir s’il abandonne le gouvernement Netanyahou. De même, pour Tzipi Livni, chef de l’opposition, les derniers sondages montrent qu’elle se traîne loin derrière Netanyahou dans le choix du public comme Premier Ministre. Le niveau de popularité de son parti diminue. Celui du Likoud monte.
Troisièmement, il y a le fait qu’aujourd’hui la Gauche ne contrôle pas l’opinion publique au point où elle y parvenait la dernière fois que Netanyahou était au pouvoir. Pendant son premier gouvernement, du fait en grande partie de la délégitimation de la Droite par les media à la suite de l’assassinat de Rabin, les media étaient en mesure de vendre l’OLP comme partenaire de paix crédible. Yasser Arafat lui-même était dépeint par une émission de télévision populaire comme une adorable marionnette pacifiste qui ne voulait que faire la paix avec un Netanyahou lâche et belliqueux.
Par conséquent, il devenait socialement inacceptable dans les cercles bien élevés d’admettre qu’Arafat et les Palestiniens étaient moins dédiés à la notion de coexistence pacifique avec Israël, ou que Netanyahou avait raison de ne pas abandonner la boutique. De même, il était socialement inacceptable dans certains quartiers de critiquer Clinton, qui se présentait comme le plus grand ami de Rabin. Aujourd’hui, le public est bien moins embarrassé pour faire ces remarques.
C’est le cas bien sûr pour la quatrième raison de l’échec de la mission Biden. Au cours des onze années depuis que Netanyahou a été chassé de son poste, la plateforme politique de la Gauche a été discréditée par les évènements. Depuis 1999, les Palestiniens – de même que les Libanais – ont démontré que la politique de compromis de la Gauche est désastreuse. Les 1.500 Israéliens qui ont été tués depuis lors par les Palestiniens et le Hezbollah, la transformation du Sud Liban et de Gaza après le retrait israélien en enclaves jihadistes, la montée de l’Iran, et le rejet ouvert par le Fatah du droit à l’existence d’Israël ont tous contribuer à rendre inacceptable la politique de la Gauche pour une large majorité d’Israéliens.
Le rejet par le public de la politique de la Gauche est si impressionnant qu’il y a même rejet de la déclaration centrale actuelle de la Gauche – à savoir qu’Israël va perdre sa majorité juive s’il refuse de rendre la Judée et la Samarie. Selon une répartition de 53 contre 28 %, un sondage du Haaretz le mois dernier a montré que les Israéliens ne croient pas que la présence continue d’Israël dans ces régions conduira à sa destruction comme Etat juif.
Ce que tout cela démontre bien sûr, c’est qu’il va falloir bien plus qu’un changement de ton au gouvernement Obama pour gagner le public israélien. L’hostilité ouverte d’Obama envers Netanyahou a été probablement un facteur significatif pour étayer le taux d’approbation publique dans ses réalisations à son poste.
Le public israélien n’est pas intéressé par un changement de ton – de la part d’Obama ou de la Gauche israélienne. Il est intéressé par un changement de politique. Jusqu’à ce qu’il l’obtienne, le public, selon toute probabilité, restera loyal à Netanyahou
|
Re: Géopolitique 08 mars 2010, 10:39 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 4 194 |
L'enjeu islando-grec
Cela impliquait que chaque Islandais, enfants et adultes, actifs et retraités, riches et pauvres, ait à payer 99€ par mois pendant 8 ans. A plus de 93%, l’Islande a donc dit « non », samedi, au projet de loi qui lui était soumis, par référendum, après que son président eut refusé de signer ce texte aux termes duquel le pays aurait du rembourser aux Etats néerlandais et britannique les quelque 4 milliards d’euros qu’ils avaient avancés à leurs citoyens victimes de la faillite des banques islandaises, elle–même provoquée par le krach de Wall Street.
Bien qu’il soit encore plus ample que prévu, l’étonnant n’est pas ce rejet. Lorsqu’on vous demande si vous êtes, oui ou non, disposé à payer, et beaucoup, sur vos propres deniers, pour des fautes que vous n’avez pas vous-même commises, la réponse est, évidemment, attendue. Elle est tellement logique que l’issue de ce référendum a été saluée par une véritable liesse populaire dans les rues de Reykjavik, embrassades, bières et feux d’artifice, mais l’étonnant est l’extrême modération des réactions internationales.
« Le point fondamental, pour nous, est de revoir notre argent mais nous sommes prêts à être flexibles », déclarait hier soir le ministre britannique des Finances, Alistair Darling, en ajoutant que la Grande-Bretagne ne pouvait pas dire à un petit pays comme l’Islande : « Remboursez-nous immédiatement », ce qu’elle avait, pourtant, exigé jusque ces derniers jours. Quant à la Commission européenne, directement concernée puisque l’Islande est candidate à l’entrée dans l’Union depuis que la crise financière l’a pratiquement mise en faillite, elle s’est empressée de dire que le règlement de cette affaire et les négociations d’adhésions constituaient « deux processus séparés ».
La Commission s’est, autrement dit, abstenue de mettre la moindre pression sur l’Islande alors que les Pays-Bas avaient clairement lié, avant le référendum, leur feu vert à l’adhésion islandaise et la récupération des sommes avancées à leurs citoyens.
Dans cette affaire, tout le monde marche sur des œufs parce que les Pays-Bas et la Grande-Bretagne votent au printemps, que la dette islandaise pourrait y devenir un enjeu électoral, particulièrement aux Pays-Bas, et qu’aucun gouvernement européen, surtout, ne souhaite que l’Islande n’en vienne à se radicaliser, ne devienne un symbole du refus de la rigueur par les opinions publiques et ne crée, par là, un effet de contagion dans toute l’Union. Cette hypothèse préoccupe d’autant plus les gouvernements qu’il y a, parallèlement, la Grèce, elle aussi sommée de se serrer la ceinture.
Aucun Etat ne lui réclame de remboursement. Les partenaires européens ont seulement exigé de la Grèce qu’elle mette de l’ordre dans ses comptes, trafiqués par ses précédents gouvernements, avant que l’Union ne lui accorde des garanties bancaires mais, l’un dans l’autre, l’ombre de l’austérité plane sur tous les pays européens, même les plus riches, et leurs dirigeants ne voudraient pas qu’une maladresse, vis-à-vis d’Athènes ou de Reykjavik, n’y provoque une réaction en chaine.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.