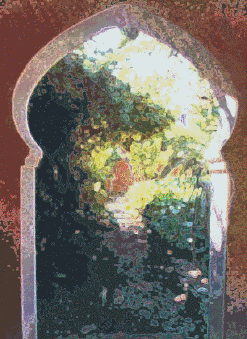|
|
Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri.
Envoyé par ladouda
|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 15 juin 2012, 02:50 |
Membre depuis : 14 ans Messages: 818 |
Je me souviens de ce "boussadiai" et effectivement il nous terrorisait et c'est vrai que nos restions devant lui fascinés par ses danses..
nos parents nous disait toujours "je vais appeler le boussadiai" lorsque nous n'étions pas sages..
notre dernière femme de ménage qui était de Zarziz et son mari du Soudan
ne manquait jamais de lui faire la conversation par le balcon lorsqu'il passait dans notre rue car c'était son beau-frère....(un d'entre-eux, ils étaient plusieurs je pense)
dialecte compris que par eux deux..
par contre je ne connaissais pas ces merveilleuses légendes..encore une marque de notre culture si riche et variée.
Chabbat Chalom
nos parents nous disait toujours "je vais appeler le boussadiai" lorsque nous n'étions pas sages..
notre dernière femme de ménage qui était de Zarziz et son mari du Soudan
ne manquait jamais de lui faire la conversation par le balcon lorsqu'il passait dans notre rue car c'était son beau-frère....(un d'entre-eux, ils étaient plusieurs je pense)
dialecte compris que par eux deux..
par contre je ne connaissais pas ces merveilleuses légendes..encore une marque de notre culture si riche et variée.
Chabbat Chalom
|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 17 juin 2012, 11:22 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

Après bien des jours de marche, lui et de nombreux autres villageois furent triés et revendus au Grand Marché aux esclaves de Ghadamès (en Lybie).
Un autre groupe de caravaniers arabes l’acheta et repris une longue marche jusqu’à Tunis. C’est là dans la médina au Marché aux esclaves de Tunis qu’il fut vendu à une princesse beylicale. Moncef connaissait parfaitement le grand bâtiment et sa cour à arcades sous lequel s’entassaient ces pauvres malheureux. Du haut du grand escalier central, un homme à la voix forte lançait les enchères. Dès l’achat réalisé, on remettait l’esclave à l’acheteur. Le grand père de Moncef fut donc employé aux tâches ménagères dans la grande maison de la princesse, après vingt ans de loyaux services la princesse mourut ; les plus fidèles serviteurs furent affranchis.
C’est ainsi que le père de Moncef naquit et vécu en citoyen libre. De cette douloureuse histoire Moncef en garda une trace indélébile : il devint excessivement méfiant à l’égard des autres, et il garda la marque du pays de ses ancêtres, Le Mali : la peau noire.
Il y avait en Tunisie une population noire peu nombreuse, mais très bien intégrée. Tous descendants d’esclaves africains ; à l’origine animistes leurs parents s’étaient convertis à l’islam. Cependant ils n’occupaient pas de postes importants et n’exerçaient aucune fonction officielle.
C’est donc vers ce qu’on appelle aujourd’hui ‘les petits boulots’ que se tournait cette population : ils étaient portefaix au marché, parfois ‘homme de peine’ auprès d’un maçon, ou alors conducteur de charrette et pour ceux qui avaient le goût du spectacle : Boussadia ou musiciens.
Le père de Moncef avait travaillé toute sa vie au marché, il portait des caisses de marchandises qui l’avaient marqué physiquement pour un très maigre salaire, tout au plus le seul vrai avantage dont il bénéficiait, était celui de pouvoir se procurer gratuitement, des légumes et des fruits pour nourrir la famille.
Enfant, Moncef était un garçon vif et intelligent, à l’école franco-arabe il avait appris à lire le coran, il était le seul de la famille à pouvoir lire l’Arabe et un tout petit peu le Français, mais c’était suffisant pour la vie courante. Tout en respectant les traditions familiales, son caractère indépendant le conduisait à se distinguer de ses frères et sœurs. Son plus grand plaisir était de descendre de la médina et de déambuler attentif au spectacle de la rue. Il suivait parfois les musiciens de rue ou le Boussadia et ne perdait rien de leurs gestes, de leurs manières, de leur savoir-faire.
Un jour en se promenant il crut reconnaître l’un de ces musiciens, il l’interpela et il put ainsi engager une conversation avec lui. Moncef lui raconta qu’il aurait bien aimé comme lui jouer de la musique et danser. Sans le dissuader l’homme lui fit part de la difficulté de l’entreprise. Il lui proposa néanmoins de le revoir et lui donna rendez-vous pour le lendemain dans un café maure non loin de la place Halfaouine.
Le lendemain après-midi, Moncef, ponctuel se rendit jusqu’à Halfaouine, le musicien qui était également noir lui montra dans une petite salle une sorte de castelet et lui dit que le propriétaire du café pour attirer les clients, animait le soir un théâtre de marionnettes, or pour assurer son spectacle il avait besoin d’un complice qui devait lui passer les personnages et faire quelques bruits pour rendre le spectacle plus vivant.
Or le jeune qui assurait cette mission devait se rendre à Sfax où son père venait de trouver du travail, l’occasion était belle, Moncef sans consulter ses parents accepta ; pour la peine on lui promit quelques pièces et le droit de boire une limonade de temps en temps.
Il rentra chez lui le cœur en joie et fit part de son nouveau travail à son père ; celui-ci fronça les sourcils et prit la mine sombre et renfrognée de quelqu’un qui vient d’apprendre une mauvaise nouvelle, puis il donna toutes les raisons qui montraient que c’était une mauvaise idée et qu’à son âge il valait mieux qu’il trouve un travail au souk ou au marché parce qu’il serait ainsi assuré de manger toujours un morceau de pain. Mais rien n’y fit, Moncef avait depuis longtemps décidé de devenir artiste et tant pis s’il fallait commencer par passer des marionnettes.
Le café Ben Tahar, vu de l’extérieur ne payait pas de mine, aux beaux jours on déployait quelques tables sur une terrasse particulièrement étroite. L’intérieur était plus spacieux, mais meublé sobrement : à côté de la salle principale il y avait une autre salle où était installé le théâtre de marionnettes ; une douzaine de chaises bien fatiguées était rangées pour le spectacle.
La Tunisie avait une longue tradition du spectacle de marionnettes.
Les tous premiers spectacles mettaient en scène des figurines venues d’Orient. Mais c’est avec l’arrivée des Siciliens que le théâtre de marionnettes prit son essor. Ils développèrent leur fameux ‘opera dei pupi’ qui raconte les exploits du chevalier Roland face aux infidèles à Roncevaux. La passion sicilienne pour les aventures de Roland leur vient des longues périodes de domination normande sur l’île.
Plusieurs théâtres de marionnettes avaient vu le jour, et le public petit à petit s’était diversifié : et même s’ils ne comprenaient rien à l’Italien ou au Sicilien, les Français, les Arabes, les Juifs, étaient assidus à ces spectacles où l’on retrouvait ‘Orlando furioso’ (Roland), le félon Ganelon et le petit chat malin, Verticchio à qui on faisait les tours les plus pendables, mais qui savait redresser toutes les situations et retombait comme tous les chats du monde sur ses pattes. Le marionnettiste s’appelait ‘un pupazzaro’ (dérivé du mot ‘pupa’ : marionnette); une histoire suave se racontait à Tunis à son propos.
Un jour qu’il magnifiait un récit où Roland faisait face aux Sarrazins il déclara dans son emportement: « Roland prit son épée Durandal et tua d’un seul coup trente trois infidèles », la salle protesta et lui dit : « baisse un peu le nombre, ça fait trop », imperturbable le ‘pupazzaro’ reprit « Roland pris son épée Durandal et tua vint cinq infidèles » ; le chahut repris de plus belle, le ‘pupazzaro’ dépité se tourna vers la salle et dit : « vous n’avez qu’à le dire vous-même le nombre », il reprit sa phrase « Roland prit son épée Durandal et tua…….. » , il marqua un arrêt et la salle reprit en chœur : « trois infidèles ».
Ce théâtre était si populaire qu’un théâtre s’ouvrit dans le café maure de la place Halfaouine, les marionnettes siciliennes étaient transportées et servaient aux marionnettistes tunisiens qui s’exprimaient en arabe et célébraient les exploits des combattants arabes contre les croisés. Ainsi s’était développé tout un contexte qui célébrait le courage, la vaillance et l’énergie de la nation arabe face à l’envahisseur chrétien.
Ce théâtre devint très populaire au point qu’il effraya les autorités françaises qui l’interdirent sauf pendant les fêtes de ramadan.

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 18 juin 2012, 14:14 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

Ce personnage venait de la tradition turque et ottomane, mais contrairement aux ‘pupi’ c’était un théâtre d’ombres, les figurines étaient dessinées et découpées dans le modèle du costume turc : pantalon bouffant et fez ottoman ; le héros principal était Karakouz, il avait un complice Hachiwaz personnage gauche et hideux, ils formaient ensemble un couple de joyeux lurons.
Karakouz était le polichinelle musulman, comme le guignol lyonnais il avait une liberté de ton telle qu’il pouvait reprendre toutes les rumeurs, les petites histoires, les dérisions mais aussi les poncifs sur les femmes qui se murmuraient de la médina à la kasbah.
Les propos des personnages étaient ponctués par le rythme de la Derbouka qui venait couvrir les rires des spectateurs. Karakouz était si célèbre qu’il avait franchi les frontières de la langue arabe et était devenu une sorte d’archétype pour la manière de s’habiller, de parler, de se comporter.
C’est ce Karakouz que Moncef devait contribuer à faire vivre. Petit à petit il avait appris la technique du mouvement des figurines, il connaissait tous les textes de base qui constituaient l’architecture des récits, il savait aussi que tous les jours il fallait apporter des anecdotes, des indiscrétions des faits divers bref tout ce qui bruissait dans les ateliers des souks et dans les rues de la ville européenne.
Moncef n’avait pas son pareil pour rapporter à son maître le bon mot, la bonne histoire tout ce qui allait alimenter le débit improvisé mais continu de la parole du marionnettiste. Cela faisait huit mois que Moncef était voué à son occupation lorsque le propriétaire et acteur du théâtre resta alité, il demanda à Moncef d’ouvrir le café et s’il s’en sentait le courage d’animer le théâtre de marionnettes.
Rien ne pouvait faire autant plaisir au jeune garçon, non pas la maladie du patron, que le fait de jouer enfin pour un public, de mettre sa voix sur le mouvement des figurines.
Le soir Moncef d’une voix mal assurée donna vie à Karakouz, à son compère Hachiwaz à la bourgeoise à la capeline, à la femme maladroite et empruntée qui essuyait les moqueries des deux compères. Toutes les hésitations et maladresses donnaient corps aux personnages, les rendaient plus fragiles, mais aussi plus ridicules et plus comiques. La soirée se solda par un triomphe, lorsque Moncef sortie du castelet ce fut un tonnerre d’applaudissements.
Les jours qui suivirent furent tout autant réussis. Le patron revint quelques jours après, il apprit très vite que Moncef s’était tiré d’affaire. Le soir Moncef reprit son rôle d’apprenti, mais dès les premières phrases la salle protesta vigoureusement : « on veut l’autre, on veut l’autre ! » criait-elle, le patron du café eut beau expliquer que son aide était encore jeune et inexpérimenté, il n’y eut rien à faire, Moncef passa derrière le castelet et avec sa voix mal assuré et encore plus hésitant que les autres jours mit en scène ses personnages, leur donna vie, les faisant passer tantôt pour des imprudents, d’autres fois pour des maladroits, sa propre maladresse se confondait avec celle de ses figurines et ses erreurs devenaient les erreurs de Karakouz, le public riait de bon cœur, la soirée était avancée ; de loin, le cafetier-marionnettiste lui fit signe d’arrêter, Moncef était grisé, il aurait voulu que ces instants ne s’arrêtent jamais.
Pourtant il fallut conclure pour laisser aux spectateurs le temps de devenir des clients du café et consommer.
Lorsque le dernier client quitta l’établissement et qu’il fallut terminer le nettoyage du café, pendant qu’il s’affairait, Moncef sentit une main se poser sur son épaule, son patron lui demanda alors de devenir le marionnettiste ; après tout, cela lui donnait plus de temps pour s’occuper des boissons et du service. C’est ainsi que Monsef devint l’un des marionnettistes les plus prisés de la capitale.
En cette année 1935 les spectacles prenaient une tournure plus politique, les théâtres, les cabarets les spectacles ne manquaient pas d’allusions à la volonté d’indépendance ; un parti nationaliste le néo-destour prônait, un certain desserrement de l’autorité que faisait peser la France, on parlait d’autonomie interne du pays, des négociations furent entreprises entre le gouvernement du front populaire et Bourghiba le nouveau leader du néo-destour.
L’échec de ces négociations donna lieu à des révoltes sanglantes réprimées durement. Bourghiba arrêté, fut assigné à résidence en France, tous les spectacles, y compris les spectacles de marionnettes et de théâtre d’ombre, qui avaient introduit depuis longtemps des dialogues qui moquaient le policier et toute autre forme d’autorité, furent rigoureusement interdits et Karakouz fut considéré comme trop subversif pour poursuivre sa carrière.
Celle de Moncef s’arrêta net, désormais il ne lui restait plus que son intelligence et sa très grande habileté à s’exprimer devant un public ; Il fallut se reconvertir et comme certains de ses camarades d’infortune issus de cette Afrique plus méridionale qu’on appelle l’Afrique noire, il devint Boussadia.
Moncef traina ainsi son amertume et sa nostalgie, il inventa une danse faite de mouvements saccadés et de gestes suggestifs qui mimaient l’homme qui suffoque, il était le seul Boussadia à exécuter cette danse mystérieuse; tous les spectateurs connaissaient Monsef l’ancien marionnettiste devenu Boussadia et tous lui réclamaient à la fin de son numéro: la danse du diable.

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 20 juin 2012, 06:01 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

Le paradis des Lotophages
- Saviez-vous qu’Ulysse au cours de son voyage a débarqué en Afrique, précisément en Tunisie?
- Oui bien sûr non seulement cet épisode est connu, mais les romains connaissaient Ulysse, notamment ceux qui ont occupé Carthage et sa région ; celui-ci est représenté dans une mosaïque romaine du musée du Bardo trouvée à Dougga, attaché au mat de son navire résistant au chant des sirènes.
Le périple d’Ulysse à travers la méditerranée orientale et centrale fait suite à la guerre de Troie. Ulysse roi d’Ithaque avait rejoint la coalition des Achéens commandée par Agamemnon, cette guerre dura dix ans et se termina par la défaite des Troyens. La guerre finie Ulysse à la tête de sa flotte de douze bateaux prit la mer pour rentrer chez lui. Une tempête obligea les navires à se réfugier sur l’île aux cyclopes qui n’ont qu’un seul œil au milieu du front.
Pour échapper à la mort et en utilisant un stratagème dont il avait le secret il crève l’unique œil du roi Polyphème et s’enfuit. Il est obligé alors d’affronter le courroux de Poséidon dieu de la mer et père de Polyphème, qui en dépit de l’accord de Zeus et des autres dieux qui l’autorisèrent à retourner dans son pays s’acharna sur Ulysse et ses hommes. Tous ses bateaux se fracassèrent sur les récifs, sauf le sien.
Alors commence un long voyage qui va durer dix autres années où il va connaître avec ses compagnons des aventures extraordinaires. Parmi celles-ci figure la courte halte qu’il effectue sur l’île de Djerba.
Lorsqu’Ulysse aborda cette terre inconnue, il ne pouvait se douter que trois de ses marins, ceux qui furent désignés pour débarquer et faire le récit de leur rencontre avec les habitants qu’ils soient hospitaliers ou hostiles, refuseraient de reprendre la mer, oubliant le nom de leurs compagnons, le but de leur mission, les aventures qui les avaient conduits là et jusqu’à leur propre nom.
Retrouvés par des émissaires envoyés pour les rechercher, ils étaient dans un état de demi-inconscience. Ils prononçaient avec insistance le mot ‘lotos’. Lorsque Ulysse et ses compagnons entreprirent d’interroger ces hommes dépourvus de mémoire et de volonté ils apprirent peu de choses ou plutôt ils découvrirent que les trois marins ne savaient plus d’où ils venaient, que leur seul souhait était de rester dans cet extraordinaire pays dont les habitants étaient très accueillants et hospitaliers et se nourrissaient d’un petit fruit sucré qu’ils appelaient ‘lotos’.
C’est ainsi que cette terre inconnue fut nommée l’île aux Lotophages.
Selon toutes les études entreprises par les spécialistes et les historiens sur le parcours d’Ulysse en méditerranée, cette île est identifiée comme l’île de Djerba (c’est la seule halte en terre d’Afrique que le roi d’Ithaque ait effectué).
Selon la légende, les Lotophages étaient donc des mangeurs de lotos.
Contrairement à ce que l’orthographe de ce mot peut laisser penser les lotos ne sont pas les fruits du lotus (plante aquatique endémique des zones humides et marécageuses) mais des petits fruits très sucrés, dont les vertus sont telles qu’elles vous font oublier d’où vous êtes venu et vous incitent à demeurer parmi ces populations du reste accueillantes et paisibles.
Dans les explications les plus contemporaines, on définit le lotos, comme pouvant être la datte du palmier dattier (phœnix dactylifera) présente sur l’île de Djerba, d’autres pensent qu’il s’agit du jujube, le fruit du jujubier, peut-être parce que cet arbre est très répandu sur l’île mais sans doute aussi parce qu’il évoque l’ascension nocturne de Mahomet accompagné de l’Ange Gabriel vers le ciel, où ils virent le jujubier, ‘cet arbre immense et magnifique dont les fruits ressemblaient à des papillons d’or’.
Une autre interprétation tout autant intéressante m’a été délivrée par des habitants de Djerba, il s’agirait d’une toute petite pomme, pas plus grosse qu’une cerise de couleurs verte et rouge extrêmement exquise et sucrée et que l’on ne trouve qu’à cet endroit.

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 20 juin 2012, 06:10 |
Membre depuis : 14 ans Messages: 818 |
il pourrait s'agir du "zarour" acérole en français qui est effectivement
une petite pomme que l'on mangeait à Roch-Achanah
on disait toujours "aneb ou zarour" : en français les jujubes et les acéroles.
l'acérola est très à la mode en ce moment pour sa valeur nutritionnelle
une petite pomme que l'on mangeait à Roch-Achanah
on disait toujours "aneb ou zarour" : en français les jujubes et les acéroles.
l'acérola est très à la mode en ce moment pour sa valeur nutritionnelle
|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 21 juin 2012, 14:46 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

Mais plus que le mot lui-même, arrêtons-nous sur la symbolique que la mythologie a caché derrière cette escale djerbienne. Pour ceux qui font un long voyage n’oublions jamais d’où l’on vient. La maxime, bien entendu, peut aisément se transposer dans la vraie vie, mais comme dans toutes les légendes laissons l’imagination voguer et vagabonder
Si les lotophages étaient si paisibles et accueillants c’est parce que leur terre et leur mer sont un véritable don du ciel. Ils vivent sur une terre plutôt aride dont ils ont su récupérer et préserver l’eau des très rares mais violentes pluies par un système sophistiqué de bassins souterrains.
Mais ils ont su aussi exploiter la configuration du sous sol qui leur donne des puits artésiens, ces puits ont été réalisés bien des siècles avant que les moines d’Artois ne mettent en évidence ce phénomène.
Si bien que les lotophages essentiellement cueilleurs et cultivateurs était un peuple heureux et sans histoire. Zeus avait doté ce petit paradis d’un arbre mythique, le lotos dont les fruits avaient ce pouvoir magique d’effacer de la mémoire des visiteurs qui faisaient halte dans l’île, tout ce qu’ils avaient appris d’avant de déguster les fameux fruits.
Si bien que les nouveaux venus devenaient à leur tour des lotophages aussi calmes et paisibles que leurs hôtes. Ceci perpétuait la douceur de vivre qui envahissait les habitants de cette île.
Les lotophages étaient aussi des pêcheurs, mais ils ne jetaient pas comme tous les pêcheurs leurs filets. Ils avaient inventé un stratagème grâce aux branches de leur arbre miracle, le lotos, qu’ils enfonçaient dans les eaux peu profondes de leur rivage afin d’établir un couloir qui entraînait progressivement, les poissons qui s’y risquaient à ne plus retrouver leur chemin et à devoir seulement avancer jusqu’à un vaste enclos en forme de nasse dont ils ne pouvaient s’échapper.
Ainsi le mythe du lotos se poursuivait, atteignait les poissons et l’abondant vivier permettait à chacun de se nourrir à sa faim. Ce principe est très connu et encore utilisé à Djerba et dans de nombreuses contrées dans le monde, il nous vient pourtant de cette très lointaine antiquité.
Homère dans le chant IX de l’Odyssée consacre à peine quelques lignes aux Lothophages, il s’éloigne très vite de cette terre de l’oubli et son héros nous laisse sur notre faim, mais nous en savons assez pour nous laisser entraîner vers les rives de l’imaginaire et laisser libre cours à nos rêves.
Bien des années plus tard les romains en entreprenant leur voyage vers le sud de la Tunisie et la Lybie où ils créèrent la province de Cyrénaïque, firent halte à Djerba pour y fonder plusieurs comptoirs.
La voie romaine qu’ils créèrent et qui rattacha l’île à la terre ferme, de Zarzis à El Kantara, est toujours utilisée de nos jours.

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 22 juin 2012, 14:50 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

Ali Riahi
- en cherchant sur mon téléviseur une chaîne musicale, j’ai entendu un air qui m’a rappelé étrangement une chanson arabe que l’on entendait à la radio en Tunisie
- c’était l’époque ou radio Tunis reprenait les chansons de Oum Kalthoum et les airs de Ali Riahi. Tout le monde chantonnait les chansons d’Ali Riahi ; mais l’avez-vous connu ?
Ali Riahi était une espèce de dandy au visage poupin, qui promenait son embonpoint dans les rues de Tunis, avec bonne humeur.
A son passage, ses plus fervents admirateurs, lui baisait la main en signe de respect et de reconnaissance, il se laissait faire de bonne grâce et poursuivait sa conversation avec l’ami qui lui tenait compagnie.
J’ai croisé en été, Ali Riahi, une ou deux fois sur l’avenue Jules Ferry, en fin d’après midi quand la chaleur décline et que les marchands arrosent les trottoirs surchauffés, pour apporter un peu de fraîcheur, il était vêtu d’une Djellaba très légère d’un blanc immaculé, comme en portaient les arabes importants, les cheveux brillantinés étaient tirés en arrière, il avait un sourire éclatant, souligné par une dent en or sur le devant de la mâchoire.
Je ne connaissais pas Ali Riahi, des copains tunisiens du lycée m’en avaient parlé, et j’ai su, qui il était, grâce à un passant complaisant qui m’en a fait part au moment où nous l’avons croisé.
J’avais sans doute entendu chanter Ali Riahi à Radio Tunis, mais à cette époque je n’étais pas sensible aux mélodies langoureuses de la musique arabe.
Pourquoi faire revivre ce personnage alors que des milliers de chanteurs beaucoup plus célèbres se partagent les antennes des radios et des télévisions.
Ali Riahi était sans doute le chanteur le plus représentatif de la chanson arabe tunisienne, il a beaucoup fait pour le renouveau de cette musique parce qu’il a su faire converger la puissance de la musique arabo-musulmane, et les rythmes chaloupés du malouf issu de la musique arabo-andalouse.
Ali Riahi était un mythe vivant, lorsqu’il montait sur scène, c’était le délire. Le public se levait et applaudissait de très longues minutes, Ali Riahi avec son sourire coutumier attendait patiemment la fin de cette longue ovation qui allait être suivie par bien d’autres tout au long de la soirée ; il n’était pas rare que des spectateurs montent sur scène pour le supplier de chanter leur chanson favorite, alors c’était le signal pour beaucoup d’autres de venir exprimer leur ferveur au plus près de leur chanteur favori.
Ali Riahi se tournait vers ses musiciens et commençait alors ce long dialogue entre la musique et la voix douce et riche du chanteur. Ali Riahi chantait le ‘malouf’ car c’était la musique traditionnelle arabe et tunisienne. Le malouf est né en Espagne, il signifie en arabe ‘fidèle à la tradition’ fidèle au patrimoine musical qui s’est enrichi dans l’Andalousie du VIIIème au XVème siècle dans les cours royales et les jardins des délices de Grenade de Cordoue et de Séville.
Après l’expulsion des juifs et des musulmans par Isabelle La Catholique à la fin de l’année 1492, une nouvelle page de la musique arabo-andalouse s’est ouverte en Tunisie et dans le reste du Maghreb, c’est la raison pour laquelle juifs et musulmans ont toujours été associés dans l’interprétation de cette musique.
La complicité entre Ali Riahi et ses musiciens était totale, parfois l’orchestre s’arrêtait, Ali en faisait autant, la salle était suspendue, alors ‘l’oud’ (ancêtre du luth) égrenait quelques notes suivi du ‘nay’ (flûte de roseau appelée aussi la flûte bédouine) puis le violon et l’alto, Ali reprenait la mélodie ponctuée par le rythme de la ‘darbouka’ (sorte de tambour réalisé à partir d’une poterie), le public chavirait.
Parmi les chansons réclamées par le public l’une d’entre elle était devenue incontournable ‘thlath ouardat’ qui signifiait trois roses.

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 24 juin 2012, 07:14 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

C’est lui qui prenait un grand soin à les apporter et ne chantait jamais thlath ouardat sans tenir ses roses à la main. Un jour qu’il chantait dans une salle d’Halfaouine (quartier de Tunis) il oublia ses roses et ne chanta pas sa chanson fétiche, l’insistance du public frisa l’émeute ; Ali Riahi envoya son chauffeur chez lui, il habitait en ce temps là à Salammbô soit à plus de 20 kilomètres de
Tunis.
Le concert prit fin, dans un délire, avec thlath ouardat et Ali Riahi tenant au dessus de sa tête les trois roses.
CHAPITRE 6
Les nuits de ramadan à Halfaouine
- J’avoue ne pas bien connaître la religion musulmane, et je n’ai jamais compris si le ramadan était une période triste ou agréable.
- je n’en mais rien moi-même mais on m’a rapporté que les nuits de ramadan était longues et un bon prétexte à faire la fête.
Le ramadan est une période importante pour tout musulman, au moment du ramadan, Tunis et la Tunisie changeait totalement d’atmosphère.
Chedli aimait beaucoup le ramadan, à son âge, il avait 10 ans, on ne faisait pas le ramadan, mais cette effervescence qui gagnait la famille le rendait joyeux. Pourtant le ramadan est une épreuve pour tous les adultes qui le pratiquent. Mais savait-il ce qu’était le ramadan en dehors de voir ses parents jeûner toute la journée sans même boire une goutte d’eau, son père qui habituellement était fumeur laissait ses cigarettes dans un tiroir.
Chedli fréquentait l’école franco-tunisienne de son quartier et c’est pendant le cours d’arabe que son professeur qui remplaçait parfois le mufti à la mosquée, lui avait appris l’histoire de la venue du prophète. Du départ des disciples de Mohamed de la Mecque pour rejoindre Yathrib (Médenine) qui marque le début de l’hégire (début du calendrier musulman).
Il savait aussi que le ramadan vient du mot arramad ce qui signifie en arabe sol brûlant, et absence de nourriture, et que bien avant l’islam cette période était celle du 9ème mois lunaire. Dans le coran Mohamed a rendu le jeûne obligatoire, précisément pour respecter la tradition de ces contrées comme le faisait auparavant les juifs se référant au jeûne durant le yom kippour.
Le jeûne commençait, à l’aube, dès la disparition du premier croissant de lune du 9ème mois du calendrier lunaire et se terminait chaque soir dès l’apparition du croissant de lune dans les lueurs crépusculaires du soleil couchant. Enfin le nombre de jours du calendrier lunaire étant inférieur à celui du calendrier solaire, le ramadan se décale chaque année de dix à douze jours si bien qu’il peut survenir dans chaque saison.
A Tunis la rupture du jeûne était annoncée par un coup de canon tiré sur les hauteurs de la Kasbah.
Le père de Chedli était dinandier au souk En Nhas, appelé aussi le souk du cuivre. C’était un artisan réputé, car certaines des pièces qu’il avait réalisées se trouvaient dans des palais beylicaux. Le soir à la fin du ramadan il aimait boire un café dans l’un des bars de Halfaouine tout en fumant une cigarette.
Chedli qui avait arpenté les souks et les rues de la médina venait le rejoindre, son père lui commandait une grenadine qu’il se délectait à déguster.
Il faut dire que pendant le mois de ramadan, à quelques heures de la rupture du jeûne, un véritable cérémonial se mettait en route. Sa maman à la maison commençait la cuisine, elle préparait la très fameuse ‘chorba’. Chedli qui adorait l’observer pendant son travail connaissait la recette par chœur. Elle commençait toujours par couper l’oignon en lamelles ce qui faisait pleurer tout le monde ; dans la marmite en terre placée sur le ‘canoune’ chaud (foyer en terre dans lequel brûle du charbon de bois ) elle mettait l’huile d’olive et faisait revenir les oignons, l’odeur emplissait la grande pièce qui servait de salle à manger, et qui le soir venu, une fois les couvertures dressées par terre, devenait la chambre des enfants, car il y avait deux pièces dans la maison de Chedli.
Le WC se trouvait dehors ainsi qu’un robinet qui servait à la toilette quotidienne. Pour la grande toilette il fallait se rendre au hammam. Dés que l’oignon embaumait il fallait verser les épices dont Zohra la maman de Chedli avait le secret d’abord le tabel-karouia l’épice reine de la cuisine tunisienne, le curcuma, la zayana (plus connue sous le nom de paprika), une cuillère d’harissa sans laquelle tout bon tunisien ne trouve pas de goût à ce qu’il mange, elle écrasait l’ail et versait le concentré de tomate, très vite les ingrédients en se mélangeant exhalaient des odeurs et des parfums qui se propageaient de maisons en maisons car la chorba était la soupe du ramadan.
Elle plongeait ensuite la viande d’agneau coupée en dés, parfois Zohra remplaçait l’agneau par le poulet, mais la famille préférait l’agneau car le liquide était plus onctueux. C’est seulement après que la viande ait pris une belle couleur qu’on ajoutait l’eau, et les épinards.
Il fallait alors oublier la marmite qui mijotait deux bonnes heures avant que la cuisinière ne verse le ‘chirr’ aussi appelé ‘t’chicha’ (graines d’orge grillés) et les pois chiches. La marmite mijotait encore une heure, alors on versait les langues d’oiseau (pâtes) et un peu de ‘smen’ (beurre clarifié).
L'enfant des terrasses - les nuits de Halfaouine.
Ourili cacaouéia !!!

|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 25 juin 2012, 14:51 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

La chorba n’était pas le seul met des repas de ramadan. Il fallait aussi préparer le repas de la nuit. Une heure après la chorba qui calait le ventre, après une journée de jeûne, il fallait se remettre à table.
Dans la famille de Zohra et Mohamed (le père de Chedli s’appelait ainsi) on prenait du lait caillé et des pâtisseries les ‘makrouts’ et les ‘zlabia’ qui sont de merveilleux gâteaux au miel.
Toute la famille allait se coucher et le matin avant que le soleil ne se lève on se remettait à table pour avaler une soupe un peu plus claire préparée avec des carottes des pommes de terre et des navets ; c’était la soupe que Chedli aimait le moins mais il savait aussi qu’il pouvait manger, après la soupe, selon la saison une orange, une figue de barbarie ou un bol de droo (crème réalisée avec la farine de sorgho qui tient si bien à l’estomac).
Le père préparait minutieusement le thé, qu’il versait d’une théière à l’autre en levant la théière pour mieux aérer le breuvage.
La fin du repas correspondait à l’annonce du ‘muetzin’ qui appelait les fidèles à la prière du matin.
Ce rite familial était immuable il donnait, un vrai bonheur aux enfants et aux adultes et il rendait les nuits du ramadan les plus belles nuits de l’année.
Au dehors au cours de ces années 50, où le ramadan se déroulait au printemps, laissant plus de temps avant la nuit noire, juste avant la rupture du jeûne, on assistait à tout un cérémonial, dans les cafés maures les employés commençaient par rafraîchir et nettoyer les trottoirs en jetant de l’eau, cette pratique était habituelle dès que la chaleur envahissait Tunis, même, hors période de ramadan.
Ensuite on préparait les narguilés, cette préparation nécessitait une attention particulière, les cafés étaient souvent choisis en fonction de la qualité de leur narguilé, en arabe on l’appelait ‘shicha’ ce mot vient du persan et signifie verre, matériau dans lequel était réalisé le corps du narguilé qui contient l’eau. Le narguilé est une pipe à eau au sommet de laquelle se trouve un récipient de métal relié au réservoir, par une longue cheminée qui trempe dans l’eau.
Dans le récipient au sommet de la cheminée on place le ‘tabamel’ un mélange de tabac fermenté et de mélasse parfumée aux essences de fruits sur lequel on dépose des braises. Un long tuyau souple terminé par un embout permet d’aspirer l’air empli de la fumée filtrée par l’eau qui occupe la moitié du réservoir.
Certains poussaient l’esthétique jusqu’à parfumer l’eau à l’eau de rose. Fumer le narguilé est sans doute la pratique la plus répandue de l’Orient. Dès le son du canon, qui annonçait la fin du jeûne, les terrasses des cafés étaient envahies par des hommes (il faut dire que les femmes préparaient le repas familial), alors commençait le frénétique ballet des garçons qui apportaient les différentes boissons aux clients ; ce qu’on buvait volontiers c’était soit un café soit une boisson sucrée avec de la limonade jamais d’alcool proscrit chez les musulmans surtout en période de ramadan.
Puis arrivaient les narguilés, tous les gestes étaient lents, on savourait chaque bouffée de tabac, chaque gorgée de liquide, on effaçait très progressivement, petit à petit, la dureté de la journée de jeûne et d’abstinence.
Après une heure ou deux, les hommes mûrs rentraient à la maison pour partager avec la famille la longue nuit. Les jeunes hommes se réunissaient dans de petites gargotes qui exhalaient l’odeur renversante des soupes longuement mijotées, des épices ou du méchoui qui grillait lentement (en général on utilise le mot méchoui pour la cuisson de l’agneau entier ; mais le mot méchoui hérité du mot arabe ‘sawa’ indique toute viande grillée ou rôtie).
Dans ces gargotes on préparait aussi la méchouia sorte de salade de poivrons, tomates et oignons grillés et finement découpés, qui accompagnait les morceaux de viande et les très odorants ‘tajines de loubia à la tomate’ (haricots longuement mijotés). Derrière une vitre qui faisait usage de vitrine s’empilaient les ‘khobz tabouna’, galette de pain qui a pris le nom du four traditionnel tunisien dans lequel elle est cuite, le four est un grand trou à même la terre, fortement chauffé par un feu de bois, sur les bords duquel on faisait cuire les galettes de pain à la semoule et à l’huile d’olive.
|
Re: Des Nouvelles Du Boukornine,,, Les Aventures d'Humbert Gurreri. 26 juin 2012, 14:44 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 4 194 |

[www.dailymotion.com]
La plupart des hommes étaient soit vendeur, marchand ou portefaix au marché soit artisan ou apprenti artisan dans les souks, tous les métiers étaient représentés, les ferblantiers, les dinandiers, les graveurs sur cuivre, les fabricants de babouches, de chéchia, les tisserands, ils se côtoyaient le jour et dans une joie communicative communiaient aux mêmes plaisirs du repas pris en commun le soir.
Mais la soirée n’était assurément pas finie, après ce premier dîner la longue nuit du ramadan se poursuivait au spectacle, les tunisiens sont passionnés de musique et de chants, alors, Halfaouine devenait le centre artistique de Tunis.
Halfaouine est un quartier populaire bâti au cœur de la médina de Tunis. C’est une ville dans la ville avec ses marchands de légumes, ses épiciers djerbiens, ses cabarets et ses cafés maures. En outre il abrite le quartier général du club de football ‘l’Espérance Sportive de Tunis’ et ses milliers de supporters. Le quartier s’est développé autour d’une très belle place, la place Halfaouine, celle-ci est ornée d’une très élégante fontaine posée au centre d’une étoile à huit branches, (qui symbolise la déesse babylonnienne Ishtar déesse de l’amour, mais aussi il est dit dans l’islam que huit anges supportent le trône de dieu)), au fond se trouve la mosquée Saheb Ettabaâ et son haut minaret octogonal.
La place était le lieu le plus important du quartier, elle était le centre de la vie publique et sociale, on y discutait, on s’y disputait, on commentait les résultats de football et de l’équipe du quartier : ‘l’Espérance’, on faisait, on défaisait et on refaisait le monde, on se passionnait de politique (les Tunisiens ont toujours aimé la politique), enfin on se délectait de musique dans les petits cabarets de poche.
Les tunisiens étaient si passionnés de musique que dès la mise sur le marché des radio-transistors la médina s’est empli de la musique diffusée par les radios arabes, il n’y avait pas un seul atelier une seule boutique sans un poste de radio et comme ils se branchaient tous sur la même station, si d’aventure vous deviez traverser la médina vous pouviez écouter, tout en marchant, la même chanson sans en perdre une miette.
C’est à Halfaouine que les grandes voix de la chanson tunisienne ont fait leurs premières armes, c’est à Halfaouine que des musiciens avertis ont expérimenté les sonorités du malouf et de la chanson arabo-andalouse et arabo-berbère.
Dans les années vingt, une artiste exceptionnelle a enflammé les nuits d’Halfaouine. Aussi extraordinaire pour son talent que pour sa profonde liberté de vie : Habiba Msika de son vrai nom Marguerite Msika chanteuse d’origine juive a porté comme personne la musique arabo-andalouse ; née dans les tous derniers jours du XIXe siècle, dans une famille juive très modeste elle avait appris l’arabe littéraire et le chant avec le plus grand compositeur tunisien Khémaïs Tarnane.
Habiba était une sorte de Sarah Bernard et de Colette réunies ; elle faisait aussi du théâtre et avait même joué ‘Roméo et Juliette’ puisé dans le répertoire shakespearien. Elle avait un tel pouvoir de fascination que ses nombreux admirateurs s’appelaient ‘les soldats de la nuit’ ils l’entouraient, la protégeaient et surtout assuraient une présence constante à ses concerts.
Elle avait modifié son prénom à la demande de ses fans et s’était donné le prénom d’Habiba qui signifie en arabe ‘bien aimée’. En fait elle a connu une vie amoureuse tumultueuse, multipliant amants et époux ; pourtant ce qui fit scandale c’est le baiser langoureux qu’elle échangea au cours d’un spectacle à La Marsa avec l’actrice israélienne d’origine libyenne Rachida Lofti, la salle fut choquée et des spectateurs violents mirent le feu à la scène. Habiba Msika était aussi une figure politique, bien que de confession israélite elle était profondément nationaliste ; il lui arrivait parfois, au cours d’un concert de s’envelopper dans le drapeau tunisien, la salle croulait. Un soir que les autorités coloniales étaient venues l’arrêter, elle ne dut son salut qu’à ‘ses soldats de la nuit’.
Habiba Msika connut une fin tragique l’un de ses amants l’aspergea d’essence et la brûla vive. Au cimetière du Borgel, la pierre tombale d’Habiba Msika qui suscite toujours autant de vénération, est surmontée d’une colonne entourée de couronnes de lauriers.

[www.dailymotion.com]
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.