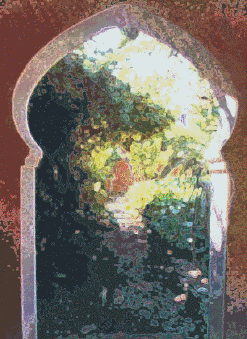|
|
Accueil des forums
>
ADRA - COMMENTAIRES
>
Discussion
Israël-Palestine : les deux versions, par Jean Daniel
Envoyé par Pauline
|
Israël-Palestine : les deux versions, par Jean Daniel 22 février 2008, 11:51 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 31 |
Israël-Palestine : les deux versions, par Jean Daniel
LE MONDE
Voici, en résumé, ce qui s'est passé au Proche-Orient depuis les débuts de l'implantation sioniste. Sous l'impulsion du mouvement des nationalités européen, des penseurs juifs ont émis l'idée que la seule manière d'en finir avec l'anomalie d'un peuple privé d'un chez-soi et persécuté par cela même serait de se mettre à l'écoute des peuples "normaux" et de s'autodéterminer, autrement dit de se donner un Etat souverain. On appela cette idéologie "sionisme", et "sioniste" le mouvement mondial qui devait s'en inspirer. "Sion", on le sait, est l'une des dénominations de Jérusalem dans la Bible, et, par extension, de la terre d'Israël, que les Romains ont appelée "Palestine", soit le pays des Philistins. Le mot dit bien l'alliance d'une aspiration antique et d'une idéologie moderne.
Le plus important de ces promoteurs, un juif viennois nommé Theodor Herzl, dramaturge et journaliste de talent, parfaitement assimilé par ailleurs, s'est converti au sionisme sous le choc de la dégradation du capitaine Dreyfus, à laquelle il a assisté en tant que correspondant d'un grand journal viennois. Herzl publia en 1896 un livre-programme au retentissement immense, L'Etat des juifs, convoqua l'année suivante à Bâle le premier congrès sioniste et fit ainsi d'une aspiration vague une véritable organisation politique. Le gros du judaïsme mondial était à l'époque entassé dans la zone de résidence, dans les marges méridionales et orientales de l'empire des tsars, où leur situation était proprement catastrophique, et où, par ailleurs, s'était développée une intelligentsia juive sécularisée et fortement imprégnée d'idéaux révolutionnaires. C'est donc là-bas que le mouvement sioniste eut le plus de succès, et c'est de là-bas que sont arrivés pour l'essentiel les immigrants venus par "vagues" ("montées", en hébreu) s'installer en Palestine à partir du dernier tiers du XIXe siècle.
Le pays, libéré de la tutelle ottomane dans la foulée de la première guerre mondiale, est passé sous tutelle britannique en vertu d'un mandat de la Société des nations. Or le gouvernement de Sa Majesté, avant même que ledit mandat ne lui fût accordé, avait reconnu officiellement, par la déclaration Balfour de novembre 1917, le droit du peuple juif d'établir un "foyer national" dans la terre de ses ancêtres. Mais Londres, prise au piège de ses promesses contradictoires aux sionistes et aux Arabes, a vite fait de décevoir les uns comme les autres. En effet, les Anglais ne tardent pas à tourner le dos à leurs obligations à l'égard des juifs découlant tant des provisions du mandat que de leur propre déclaration Balfour, sans pour autant se gagner les grâces d'une population arabe en pleine effervescence nationaliste.
Les premiers troubles éclatent dès les années 1920 et culminent en 1929 avec le terrible pogrom d'Hébron, qui anéantit l'antique communauté juive de la cité des Patriarches. Mais c'est en 1936 qu'éclate la grande révolte, antijuive et antibritannique, des Arabes de Palestine. Dépêchée sur place, une commission royale d'enquête, la commission Peel, conclut à l'impossibilité de faire coexister les deux communautés au sein du même cadre étatique et préconise pour la première fois la partition du pays et la création de deux Etats, un Etat juif et un Etat arabe. Les Arabes refusent. L'Agence juive, le "gouvernement" des juifs de Palestine, accepte.
A ce moment, Hitler est bien installé au pouvoir, et il ne fait nul mystère du sort qu'il entend réserver aux juifs, cependant que l'Occident tout entier, Etats-Unis compris, leur ferme ses portes. Aussi bien, pour les juifs européens, la Palestine devient-elle le seul havre de salut - ce qui n'empêche pas les Britanniques de publier en 1939 un Livre blanc qui limite de manière draconienne l'immigration en Palestine des juifs européens. Cependant, le Yishouv (la communauté juive de Palestine) va participer à l'effort de guerre britannique contre Hitler, tandis que le chef des Arabes palestiniens, le grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini, fait, lui, alliance avec Hitler.
Après la victoire, le combat juif pour l'indépendance reprend de plus belle. Le sionisme bénéficie désormais de la sympathie de l'opinion occidentale, qui vient de découvrir l'étendue de l'horreur des camps de la mort, et, ce qui est encore plus important, et nouveau, du soutien massif du peuple juif, ou plutôt de ce qui en reste. En désespoir de cause, Londres, dont le mandat est totalement discrédité, finit par porter la question palestinienne devant l'Assemblée générale des Nations unies, où la majorité des deux tiers en faveur de la partition du pays lui semble inatteignable. Mais, le 29 novembre 1947, le rapport favorable d'une commission d'enquête en Palestine et dans les camps des "personnes déplacées" (DP) en Allemagne et, surtout, une conjonction d'intérêts soviéto-américaine aussi miraculeuse qu'éphémère assureront en définitive la majorité requise.
L'Etat d'Israël, proclamé moins de six mois plus tard par Ben Gourion, naît ainsi dans la légalité internationale. Dans la légalité internationale, mais aussi dans la guerre - la guerre civile d'abord, dès l'annonce du vote du partage ; la guerre internationale ensuite, après la proclamation de l'Etat, avec l'invasion de six armées arabes. Contrairement à tous les pronostics, le jeune Etat tient bon et emporte une victoire militaire éclatante contre ses voisins coalisés. Au prix de six mille tués, soit un pour cent de sa population, Israël agrandit le territoire, en vérité indéfendable, que lui avait alloué le plan de partage, et signe avec ses voisins des accords d'armistice qu'il peut espérer transformer à terme en une paix en bonne et due forme.
Le prix le plus élevé de l'aventure arabe est payé par les Palestiniens : quelque sept cent mille d'entre eux doivent prendre le chemin de l'exil. Le problème des réfugiés palestiniens est né. Il sera soigneusement entretenu par les Etats arabes, avec la complicité d'une "communauté internationale" hypocrite et impuissante. A partir de ce moment, Israël ne connaîtra plus un jour de tranquillité. Jamais désigné par son nom, harcelé par une propagande incessante, soumis à des incursions d'éléments infiltrés d'Egypte par la bande de Gaza dans les années 1950, au terrorisme après, l'Etat hébreu ne devra sa survie qu'à la puissance de ses armes, à la cohésion de sa société, au soutien de son hinterland juif et à l'alliance, certes informelle, d'une grande puissance : la France de la IVe République, puis, après la volte-face du général de Gaulle, les Etats-Unis.
Avec la première, il s'est engagé dans la campagne de Suez de 1956, a mis en place son potentiel nucléaire et s'est donné les moyens de la victoire éclair de juin 1967. La seconde lui a fourni depuis l'argent, les armes et l'appui politique et moral dont il avait besoin. Justement, il en avait fort besoin depuis que, à la faveur de la guerre de six jours, Tsahal lui avait offert des territoires pris à l'ennemi : le Sinaï à un président Nasser décidément mal inspiré, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à un Hussein de Jordanie vassalisé et abusé par son confrère égyptien, le Golan aux Syriens, traditionnellement les plus haineux de ses voisins. Les Palestiniens, dont la plupart se trouvent désormais sous occupation militaire israélienne, en profitent pour se donner enfin les coudées franches par rapport à leurs patrons arabes. Objectivement, ils vivent mieux et plus libres sous l'"occupation libérale" israélienne qu'ils n'ont jamais vécu sous la loi de leurs "frères" arabes, et il leur arrive de le reconnaître, du moins en privé. Cela n'empêche pas l'OLP, qui porte à sa tête Yasser Arafat, de se livrer à une intense campagne de terrorisme, en inventant au passage le détournement d'avion, tout en affirmant vouloir détruire l'"entité sioniste" et la remplacer par un Etat palestinien démocratique, où juifs, musulmans et chrétiens vivraient en bonne intelligence et parfaite égalité - slogan que les progressistes européens, pleins de sollicitude pour les juifs morts ou menacés mais impitoyables lorsqu'ils sont victorieux, prennent au pied de la lettre.
Fondamentalement, malgré ses victoires et la puissance de son armée, Israël reste pathétiquement vulnérable. La preuve en est faite une fois de plus en octobre 1973, lorsque les armées égyptienne et syrienne réussissent à briser par surprise les lignes de défense israéliennes dans le Sinaï et sur le Golan, imposant pour la première fois à Israël une guerre défensive. Certes, Tsahal réussit, cette fois encore, à rétablir la situation et remporte même sa plus grande victoire militaire. Mais la crise morale et politique provoquée par ce que les Israéliens appellent désormais la "faillite" a deux conséquences majeures : à l'intérieur, l'arrivée aux affaires du Likoud de Menahem Begin au détriment des travaillistes, au pouvoir depuis toujours ; et, à l'extérieur, l'initiative spectaculaire d'Anouar el-Sadate, en 1977. Pour la première fois, Israël signe une paix en bonne et due forme avec un pays arabe, et pas n'importe lequel. Il lui faudra pour cela évacuer le Sinaï jusqu'au dernier grain de sable et démanteler les colonies qu'il y avait implantées.
Un modèle de comportement se met ainsi en place : à chaque fois qu'un leader arabe manifeste la volonté d'en finir avec l'état de guerre dans la région, Israël, quelle que soit la couleur de son gouvernement, se montre prêt à renoncer aux territoires chèrement acquis en juin 1967. Le premier Camp David, en septembre 1978, dans la foulée de la visite historique du président Sadate à Jérusalem, en a fourni la preuve avec l'Egypte ; le second Camp David, en juillet 2000, aurait pu la fournir avec les Palestiniens, sur un front pourtant autrement chargé de passion que le Sinaï. Malheureusement, aux propositions sans précédent du premier ministre Ehoud Barak, ces derniers ont répondu par la violence extrême de la seconde Intifada, avant de se livrer à Gaza à une véritable guerre civile qui s'est terminée par la victoire des islamistes du Hamas.
Les Palestiniens devraient savoir que, par une ruse cruelle de l'histoire, c'est grâce au sionisme, ce nationalisme en miroir du leur, et grâce à l'Etat d'Israël, à la fois modèle et repoussoir, qu'ils auront un jour cet Etat souverain que les frères arabes ne leur auraient jamais permis d'avoir. Pourtant, ils ne cessent d'illustrer tragiquement le mot fameux d'Abba Eban : "Les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une occasion." Et c'est ainsi que les Israéliens, promis à une mort certaine par le président de l'Iran, qui dispose d'un allié à leur porte (la Syrie), d'un bras armé au Liban (le Hezbollah) et d'alliés au sein même du peuple avec qui il est censé négocier (le Hamas et le Djihad islamique), se demandent avec angoisse si, entre la faiblesse des modérés et la folie meurtrière des islamistes, il reste des Palestiniens avec qui il est possible et vaut la peine de négocier. Nous en sommes toujours là.
Si vous ne trouvez pas tout à fait convaincante cette version de l'histoire du Proche-Orient contemporain, en voici une autre, point pour point.
Les sionistes ne débarquaient pas dans un désert. Non seulement le pays était occupé, mais la décomposition de l'Empire ottoman posait au Proche-Orient aussi, quoique avec retard, la question des nationalités. Si Moses Hess, considéré comme un précurseur du sionisme politique, intitule son ouvrage de 1862 Rome et Jérusalem. La dernière question nationale, c'est parce que, en bon Européen qu'il est, il n'imagine pas qu'il puisse y avoir de nation véritable en dehors de l'Europe. Il en est de même de la déclaration Balfour, qui est tout de même un étrange document : une puissance étrangère à la région, qui n'y exerce aucune responsabilité, promet d'aider à s'y implanter une organisation née sous d'autres cieux qui prétend parler au nom d'un peuple dispersé aux quatre coins du globe. Bien sûr, ce peuple a été avili, persécuté, massacré enfin. Mais on voit mal pourquoi les Arabes de Palestine, qui après tout n'ont rien à voir avec tout cela, devraient payer le prix d'atrocités commises en terre chrétienne. En fait, ces mêmes Européens qui ont soit massacré leurs juifs, soit les ont laissé massacrer, se sont déchargés sur les Arabes de leur mauvaise conscience.
Fruit de la culpabilité de l'Occident, Israël apparaît ainsi comme sa dernière entreprise coloniale. Dans ces conditions, il est trop facile d'accuser les Arabes de n'avoir pas su se résigner aux compromis nécessaires, là même où les sionistes semblaient si bien s'y résoudre : pour ceux-ci, chaque "compromis" était une victoire ; pour ceux-là, qui voyaient mal pourquoi il leur fallait partager avec des intrus leur bien ancestral, chaque concession s'apparentait à une défaite. Ainsi, ce qu'on peut leur reprocher légitimement est non d'avoir résisté à l'implantation sioniste, c'est de n'avoir pas su se donner les moyens de l'empêcher. Divisés, prétendant parler au nom de l'Umma arabe mais agissant en fait au bénéfice exclusif d'intérêts nationaux et ne se souciant des Palestiniens que dans la mesure où ils leur servaient d'idéologie unitaire et d'alibi à leurs faillites, les Arabes ne pouvaient que perdre. Les Palestiniens ont payé l'addition. La guerre de juin 1967 a été la défaite de trop.
A quelque chose malheur est bon : les Palestiniens ont gagné leur autonomie et décidé de mener leur lutte comme ils l'entendaient et le pouvaient. Terrorisme, dites-vous ? Lutte de libération plutôt, avec les armes dont on dispose. C'est que le peuple de trop sur terre, ce ne sont plus les juifs, mais les Palestiniens. Les mots de Leo Pinsker, le premier grand théoricien du sionisme, à propos des juifs, "nation fantôme", c'est aux Palestiniens qu'ils s'appliquent désormais. Car ce que le médecin d'Odessa demandait voici plus de cent ans pour les juifs, les Palestiniens ne l'ont pas encore : "Une terre à eux, un grand bout de sol dont ils auraient la propriété et dont nul étranger ne pourrait les chasser." En effet, ils ont eu beau reconnaître le fait national israélien, amender leur Charte, renoncer à leur aspiration à recouvrer leur patrie, ils n'ont toujours pas leur "bout de terre". Que leur reste-t-il pour bâtir leur "foyer national" ? La Cisjordanie, que les Israéliens appellent la Judée-Samarie, et la bande de Gaza, soit 22 % de la Palestine historique. Eh bien, qu'on leur donne ces 22 %. Que n'a-t-on dit de la générosité de Barak à Camp David. On oublie que c'est au cours de son mandat que le nombre de colons dans les territoires a pratiquement doublé ; si l'on continue dans cette veine, bientôt il n'y aura pas de territoire pour y implanter un Etat palestinien "viable", comme on dit. Il faut se mettre dans la peau du villageois terrorisé par les colons, coupé par ce que les Israéliens nomment par euphémisme la "clôture de sécurité" de son lopin de terre et qui contemple tous les jours faire tache d'huile les colonies qui l'enserrent. Faut-il chercher ailleurs les raisons de la montée en force du Hamas ? Bref, un peuple occupé et spolié de sa terre cherche à secouer l'occupation et à recouvrer ne serait-ce qu'une portion de cette terre. Nous en sommes toujours là.
Qu'y a-t-il de commun entre ces deux versions furieusement divergentes de la même histoire ?
D'abord, leur esprit : elles présentent la complainte des deux adversaires sans haine ni fanatisme, en refusant aussi bien le recours à l'intervention divine que la diabolisation de l'autre. Ensuite, et surtout, leur vérité, ou du moins leur moitié de vérité. Quiconque a eu l'occasion d'écouter les partisans de l'un et l'autre camp le sait bien : dans le meilleur des cas, c'est-à-dire entre thuriféraires de bonne compagnie, c'est à un dialogue de sourds de ce type qu'il assiste. Dans le pire...
En relisant la masse de textes que Jean Daniel a consacrés pendant un bon demi-siècle au couple maudit du Proche-Orient, j'ai été frappé par cette évidence : toute sa vie, cet homme a essayé, avec une passion lucide à nulle autre pareille, de coller ensemble ces deux moitiés de vérité. Comme dans le mythe platonicien du Banquet, il a tenté, encore et toujours, de refaire l'impossible unité des deux tronçons mutilés d'un récit qui ne se comprend que dans sa totalité.
(...) On ne saisit pleinement la continuité d'une pensée et la cohérence d'une attitude qu'en lisant ces chroniques de cette manière, l'une après l'autre, dans l'épaisseur de ce demi-siècle de sang, de larmes et d'espoirs engloutis. Remarquable continuité, formidable cohérence. En fait, Jean Daniel n'a jamais varié sur l'essentiel, car il n'a jamais choisi entre les camps en présence, ni n'a jamais été tenté de tenir la balance égale entre eux. Les coeurs petits ne sauraient contenir que la souffrance des uns à l'exclusion de celle des autres ; les coeurs secs confondent impartialité et froideur. Lui a été jusqu'au bout pour les uns et pour les autres, en essayant de comprendre de l'intérieur les ressorts politiques et psychologiques qui les animent. C'est cela, l'objectivité, la vraie : celle qui procède de l'empathie. C'est une excellente position pour prendre des coups de tous côtés ; mais aussi pour laisser une griffe sur le visage d'une époque bavarde jusqu'à la nausée, pétrie de haines recuites que masque mal l'étalage des bons sentiments. (...)
LE MONDE
Voici, en résumé, ce qui s'est passé au Proche-Orient depuis les débuts de l'implantation sioniste. Sous l'impulsion du mouvement des nationalités européen, des penseurs juifs ont émis l'idée que la seule manière d'en finir avec l'anomalie d'un peuple privé d'un chez-soi et persécuté par cela même serait de se mettre à l'écoute des peuples "normaux" et de s'autodéterminer, autrement dit de se donner un Etat souverain. On appela cette idéologie "sionisme", et "sioniste" le mouvement mondial qui devait s'en inspirer. "Sion", on le sait, est l'une des dénominations de Jérusalem dans la Bible, et, par extension, de la terre d'Israël, que les Romains ont appelée "Palestine", soit le pays des Philistins. Le mot dit bien l'alliance d'une aspiration antique et d'une idéologie moderne.
Le plus important de ces promoteurs, un juif viennois nommé Theodor Herzl, dramaturge et journaliste de talent, parfaitement assimilé par ailleurs, s'est converti au sionisme sous le choc de la dégradation du capitaine Dreyfus, à laquelle il a assisté en tant que correspondant d'un grand journal viennois. Herzl publia en 1896 un livre-programme au retentissement immense, L'Etat des juifs, convoqua l'année suivante à Bâle le premier congrès sioniste et fit ainsi d'une aspiration vague une véritable organisation politique. Le gros du judaïsme mondial était à l'époque entassé dans la zone de résidence, dans les marges méridionales et orientales de l'empire des tsars, où leur situation était proprement catastrophique, et où, par ailleurs, s'était développée une intelligentsia juive sécularisée et fortement imprégnée d'idéaux révolutionnaires. C'est donc là-bas que le mouvement sioniste eut le plus de succès, et c'est de là-bas que sont arrivés pour l'essentiel les immigrants venus par "vagues" ("montées", en hébreu) s'installer en Palestine à partir du dernier tiers du XIXe siècle.
Le pays, libéré de la tutelle ottomane dans la foulée de la première guerre mondiale, est passé sous tutelle britannique en vertu d'un mandat de la Société des nations. Or le gouvernement de Sa Majesté, avant même que ledit mandat ne lui fût accordé, avait reconnu officiellement, par la déclaration Balfour de novembre 1917, le droit du peuple juif d'établir un "foyer national" dans la terre de ses ancêtres. Mais Londres, prise au piège de ses promesses contradictoires aux sionistes et aux Arabes, a vite fait de décevoir les uns comme les autres. En effet, les Anglais ne tardent pas à tourner le dos à leurs obligations à l'égard des juifs découlant tant des provisions du mandat que de leur propre déclaration Balfour, sans pour autant se gagner les grâces d'une population arabe en pleine effervescence nationaliste.
Les premiers troubles éclatent dès les années 1920 et culminent en 1929 avec le terrible pogrom d'Hébron, qui anéantit l'antique communauté juive de la cité des Patriarches. Mais c'est en 1936 qu'éclate la grande révolte, antijuive et antibritannique, des Arabes de Palestine. Dépêchée sur place, une commission royale d'enquête, la commission Peel, conclut à l'impossibilité de faire coexister les deux communautés au sein du même cadre étatique et préconise pour la première fois la partition du pays et la création de deux Etats, un Etat juif et un Etat arabe. Les Arabes refusent. L'Agence juive, le "gouvernement" des juifs de Palestine, accepte.
A ce moment, Hitler est bien installé au pouvoir, et il ne fait nul mystère du sort qu'il entend réserver aux juifs, cependant que l'Occident tout entier, Etats-Unis compris, leur ferme ses portes. Aussi bien, pour les juifs européens, la Palestine devient-elle le seul havre de salut - ce qui n'empêche pas les Britanniques de publier en 1939 un Livre blanc qui limite de manière draconienne l'immigration en Palestine des juifs européens. Cependant, le Yishouv (la communauté juive de Palestine) va participer à l'effort de guerre britannique contre Hitler, tandis que le chef des Arabes palestiniens, le grand mufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini, fait, lui, alliance avec Hitler.
Après la victoire, le combat juif pour l'indépendance reprend de plus belle. Le sionisme bénéficie désormais de la sympathie de l'opinion occidentale, qui vient de découvrir l'étendue de l'horreur des camps de la mort, et, ce qui est encore plus important, et nouveau, du soutien massif du peuple juif, ou plutôt de ce qui en reste. En désespoir de cause, Londres, dont le mandat est totalement discrédité, finit par porter la question palestinienne devant l'Assemblée générale des Nations unies, où la majorité des deux tiers en faveur de la partition du pays lui semble inatteignable. Mais, le 29 novembre 1947, le rapport favorable d'une commission d'enquête en Palestine et dans les camps des "personnes déplacées" (DP) en Allemagne et, surtout, une conjonction d'intérêts soviéto-américaine aussi miraculeuse qu'éphémère assureront en définitive la majorité requise.
L'Etat d'Israël, proclamé moins de six mois plus tard par Ben Gourion, naît ainsi dans la légalité internationale. Dans la légalité internationale, mais aussi dans la guerre - la guerre civile d'abord, dès l'annonce du vote du partage ; la guerre internationale ensuite, après la proclamation de l'Etat, avec l'invasion de six armées arabes. Contrairement à tous les pronostics, le jeune Etat tient bon et emporte une victoire militaire éclatante contre ses voisins coalisés. Au prix de six mille tués, soit un pour cent de sa population, Israël agrandit le territoire, en vérité indéfendable, que lui avait alloué le plan de partage, et signe avec ses voisins des accords d'armistice qu'il peut espérer transformer à terme en une paix en bonne et due forme.
Le prix le plus élevé de l'aventure arabe est payé par les Palestiniens : quelque sept cent mille d'entre eux doivent prendre le chemin de l'exil. Le problème des réfugiés palestiniens est né. Il sera soigneusement entretenu par les Etats arabes, avec la complicité d'une "communauté internationale" hypocrite et impuissante. A partir de ce moment, Israël ne connaîtra plus un jour de tranquillité. Jamais désigné par son nom, harcelé par une propagande incessante, soumis à des incursions d'éléments infiltrés d'Egypte par la bande de Gaza dans les années 1950, au terrorisme après, l'Etat hébreu ne devra sa survie qu'à la puissance de ses armes, à la cohésion de sa société, au soutien de son hinterland juif et à l'alliance, certes informelle, d'une grande puissance : la France de la IVe République, puis, après la volte-face du général de Gaulle, les Etats-Unis.
Avec la première, il s'est engagé dans la campagne de Suez de 1956, a mis en place son potentiel nucléaire et s'est donné les moyens de la victoire éclair de juin 1967. La seconde lui a fourni depuis l'argent, les armes et l'appui politique et moral dont il avait besoin. Justement, il en avait fort besoin depuis que, à la faveur de la guerre de six jours, Tsahal lui avait offert des territoires pris à l'ennemi : le Sinaï à un président Nasser décidément mal inspiré, la Cisjordanie et Jérusalem-Est à un Hussein de Jordanie vassalisé et abusé par son confrère égyptien, le Golan aux Syriens, traditionnellement les plus haineux de ses voisins. Les Palestiniens, dont la plupart se trouvent désormais sous occupation militaire israélienne, en profitent pour se donner enfin les coudées franches par rapport à leurs patrons arabes. Objectivement, ils vivent mieux et plus libres sous l'"occupation libérale" israélienne qu'ils n'ont jamais vécu sous la loi de leurs "frères" arabes, et il leur arrive de le reconnaître, du moins en privé. Cela n'empêche pas l'OLP, qui porte à sa tête Yasser Arafat, de se livrer à une intense campagne de terrorisme, en inventant au passage le détournement d'avion, tout en affirmant vouloir détruire l'"entité sioniste" et la remplacer par un Etat palestinien démocratique, où juifs, musulmans et chrétiens vivraient en bonne intelligence et parfaite égalité - slogan que les progressistes européens, pleins de sollicitude pour les juifs morts ou menacés mais impitoyables lorsqu'ils sont victorieux, prennent au pied de la lettre.
Fondamentalement, malgré ses victoires et la puissance de son armée, Israël reste pathétiquement vulnérable. La preuve en est faite une fois de plus en octobre 1973, lorsque les armées égyptienne et syrienne réussissent à briser par surprise les lignes de défense israéliennes dans le Sinaï et sur le Golan, imposant pour la première fois à Israël une guerre défensive. Certes, Tsahal réussit, cette fois encore, à rétablir la situation et remporte même sa plus grande victoire militaire. Mais la crise morale et politique provoquée par ce que les Israéliens appellent désormais la "faillite" a deux conséquences majeures : à l'intérieur, l'arrivée aux affaires du Likoud de Menahem Begin au détriment des travaillistes, au pouvoir depuis toujours ; et, à l'extérieur, l'initiative spectaculaire d'Anouar el-Sadate, en 1977. Pour la première fois, Israël signe une paix en bonne et due forme avec un pays arabe, et pas n'importe lequel. Il lui faudra pour cela évacuer le Sinaï jusqu'au dernier grain de sable et démanteler les colonies qu'il y avait implantées.
Un modèle de comportement se met ainsi en place : à chaque fois qu'un leader arabe manifeste la volonté d'en finir avec l'état de guerre dans la région, Israël, quelle que soit la couleur de son gouvernement, se montre prêt à renoncer aux territoires chèrement acquis en juin 1967. Le premier Camp David, en septembre 1978, dans la foulée de la visite historique du président Sadate à Jérusalem, en a fourni la preuve avec l'Egypte ; le second Camp David, en juillet 2000, aurait pu la fournir avec les Palestiniens, sur un front pourtant autrement chargé de passion que le Sinaï. Malheureusement, aux propositions sans précédent du premier ministre Ehoud Barak, ces derniers ont répondu par la violence extrême de la seconde Intifada, avant de se livrer à Gaza à une véritable guerre civile qui s'est terminée par la victoire des islamistes du Hamas.
Les Palestiniens devraient savoir que, par une ruse cruelle de l'histoire, c'est grâce au sionisme, ce nationalisme en miroir du leur, et grâce à l'Etat d'Israël, à la fois modèle et repoussoir, qu'ils auront un jour cet Etat souverain que les frères arabes ne leur auraient jamais permis d'avoir. Pourtant, ils ne cessent d'illustrer tragiquement le mot fameux d'Abba Eban : "Les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une occasion." Et c'est ainsi que les Israéliens, promis à une mort certaine par le président de l'Iran, qui dispose d'un allié à leur porte (la Syrie), d'un bras armé au Liban (le Hezbollah) et d'alliés au sein même du peuple avec qui il est censé négocier (le Hamas et le Djihad islamique), se demandent avec angoisse si, entre la faiblesse des modérés et la folie meurtrière des islamistes, il reste des Palestiniens avec qui il est possible et vaut la peine de négocier. Nous en sommes toujours là.
Si vous ne trouvez pas tout à fait convaincante cette version de l'histoire du Proche-Orient contemporain, en voici une autre, point pour point.
Les sionistes ne débarquaient pas dans un désert. Non seulement le pays était occupé, mais la décomposition de l'Empire ottoman posait au Proche-Orient aussi, quoique avec retard, la question des nationalités. Si Moses Hess, considéré comme un précurseur du sionisme politique, intitule son ouvrage de 1862 Rome et Jérusalem. La dernière question nationale, c'est parce que, en bon Européen qu'il est, il n'imagine pas qu'il puisse y avoir de nation véritable en dehors de l'Europe. Il en est de même de la déclaration Balfour, qui est tout de même un étrange document : une puissance étrangère à la région, qui n'y exerce aucune responsabilité, promet d'aider à s'y implanter une organisation née sous d'autres cieux qui prétend parler au nom d'un peuple dispersé aux quatre coins du globe. Bien sûr, ce peuple a été avili, persécuté, massacré enfin. Mais on voit mal pourquoi les Arabes de Palestine, qui après tout n'ont rien à voir avec tout cela, devraient payer le prix d'atrocités commises en terre chrétienne. En fait, ces mêmes Européens qui ont soit massacré leurs juifs, soit les ont laissé massacrer, se sont déchargés sur les Arabes de leur mauvaise conscience.
Fruit de la culpabilité de l'Occident, Israël apparaît ainsi comme sa dernière entreprise coloniale. Dans ces conditions, il est trop facile d'accuser les Arabes de n'avoir pas su se résigner aux compromis nécessaires, là même où les sionistes semblaient si bien s'y résoudre : pour ceux-ci, chaque "compromis" était une victoire ; pour ceux-là, qui voyaient mal pourquoi il leur fallait partager avec des intrus leur bien ancestral, chaque concession s'apparentait à une défaite. Ainsi, ce qu'on peut leur reprocher légitimement est non d'avoir résisté à l'implantation sioniste, c'est de n'avoir pas su se donner les moyens de l'empêcher. Divisés, prétendant parler au nom de l'Umma arabe mais agissant en fait au bénéfice exclusif d'intérêts nationaux et ne se souciant des Palestiniens que dans la mesure où ils leur servaient d'idéologie unitaire et d'alibi à leurs faillites, les Arabes ne pouvaient que perdre. Les Palestiniens ont payé l'addition. La guerre de juin 1967 a été la défaite de trop.
A quelque chose malheur est bon : les Palestiniens ont gagné leur autonomie et décidé de mener leur lutte comme ils l'entendaient et le pouvaient. Terrorisme, dites-vous ? Lutte de libération plutôt, avec les armes dont on dispose. C'est que le peuple de trop sur terre, ce ne sont plus les juifs, mais les Palestiniens. Les mots de Leo Pinsker, le premier grand théoricien du sionisme, à propos des juifs, "nation fantôme", c'est aux Palestiniens qu'ils s'appliquent désormais. Car ce que le médecin d'Odessa demandait voici plus de cent ans pour les juifs, les Palestiniens ne l'ont pas encore : "Une terre à eux, un grand bout de sol dont ils auraient la propriété et dont nul étranger ne pourrait les chasser." En effet, ils ont eu beau reconnaître le fait national israélien, amender leur Charte, renoncer à leur aspiration à recouvrer leur patrie, ils n'ont toujours pas leur "bout de terre". Que leur reste-t-il pour bâtir leur "foyer national" ? La Cisjordanie, que les Israéliens appellent la Judée-Samarie, et la bande de Gaza, soit 22 % de la Palestine historique. Eh bien, qu'on leur donne ces 22 %. Que n'a-t-on dit de la générosité de Barak à Camp David. On oublie que c'est au cours de son mandat que le nombre de colons dans les territoires a pratiquement doublé ; si l'on continue dans cette veine, bientôt il n'y aura pas de territoire pour y implanter un Etat palestinien "viable", comme on dit. Il faut se mettre dans la peau du villageois terrorisé par les colons, coupé par ce que les Israéliens nomment par euphémisme la "clôture de sécurité" de son lopin de terre et qui contemple tous les jours faire tache d'huile les colonies qui l'enserrent. Faut-il chercher ailleurs les raisons de la montée en force du Hamas ? Bref, un peuple occupé et spolié de sa terre cherche à secouer l'occupation et à recouvrer ne serait-ce qu'une portion de cette terre. Nous en sommes toujours là.
Qu'y a-t-il de commun entre ces deux versions furieusement divergentes de la même histoire ?
D'abord, leur esprit : elles présentent la complainte des deux adversaires sans haine ni fanatisme, en refusant aussi bien le recours à l'intervention divine que la diabolisation de l'autre. Ensuite, et surtout, leur vérité, ou du moins leur moitié de vérité. Quiconque a eu l'occasion d'écouter les partisans de l'un et l'autre camp le sait bien : dans le meilleur des cas, c'est-à-dire entre thuriféraires de bonne compagnie, c'est à un dialogue de sourds de ce type qu'il assiste. Dans le pire...
En relisant la masse de textes que Jean Daniel a consacrés pendant un bon demi-siècle au couple maudit du Proche-Orient, j'ai été frappé par cette évidence : toute sa vie, cet homme a essayé, avec une passion lucide à nulle autre pareille, de coller ensemble ces deux moitiés de vérité. Comme dans le mythe platonicien du Banquet, il a tenté, encore et toujours, de refaire l'impossible unité des deux tronçons mutilés d'un récit qui ne se comprend que dans sa totalité.
(...) On ne saisit pleinement la continuité d'une pensée et la cohérence d'une attitude qu'en lisant ces chroniques de cette manière, l'une après l'autre, dans l'épaisseur de ce demi-siècle de sang, de larmes et d'espoirs engloutis. Remarquable continuité, formidable cohérence. En fait, Jean Daniel n'a jamais varié sur l'essentiel, car il n'a jamais choisi entre les camps en présence, ni n'a jamais été tenté de tenir la balance égale entre eux. Les coeurs petits ne sauraient contenir que la souffrance des uns à l'exclusion de celle des autres ; les coeurs secs confondent impartialité et froideur. Lui a été jusqu'au bout pour les uns et pour les autres, en essayant de comprendre de l'intérieur les ressorts politiques et psychologiques qui les animent. C'est cela, l'objectivité, la vraie : celle qui procède de l'empathie. C'est une excellente position pour prendre des coups de tous côtés ; mais aussi pour laisser une griffe sur le visage d'une époque bavarde jusqu'à la nausée, pétrie de haines recuites que masque mal l'étalage des bons sentiments. (...)
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.