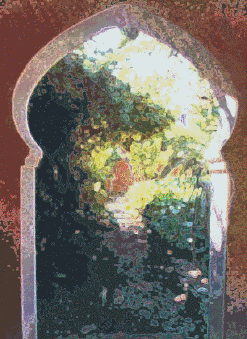|
|
Accueil des forums
>
ADRA - COMMENTAIRES
>
Discussion
Albert Memmi - 1
Envoyé par lapid
|
Albert Memmi - 1 17 septembre 2007, 07:48 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
Albert Memmi par Afifa Marzouki
Texte extrait du site suivant :
Source : [www.limag.refer.org]
Albert Memmi
Né à Tunis le 15 décembre 1920 dans le quartier juif, "la hara", Albert Memmi fréquente le lycée français de Tunis où il est élève de Jean Amrouche et étudie la philosophie à l'université d'Alger. En 1943, il connaît les camps de travail forcé en Tunisie. Il prépare l'agrégation de philosophie en Sorbonne et se marie à une Française. De retour à Tunis, il anime un laboratoire de psycho-sociologie, enseigne la philosophie et dirige la page littéraire de L'Action (hebdomadaire tunisien). Après l'indépendance de la Tunisie, il se fixe à Paris (Septembre 1956) où il est professeur de psychiatrie sociale à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, attaché de recherches au C.N.R.S, membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer et où il dirige chez Maspéro le collection "Domaine maghrébin". En 1973, il adopte la nationalité française. Il est titulaire du prix de Carthage (Tunis,1953), du prix Fénéon (Paris, 1954) et du prix Simba (Rome).
Notices sur les oeuvres
La Statue de Sel, 1953
Ce roman, préfacé par Camus, est considéré comme un classique de la littérature maghrébine. Son écriture, sobre, limpide, est démonstrative et presque didactique. Ses thèmes sont l'interrogation sur l'identité et les rapports du moi avec sa communauté et les autres groupes qui cohabitent à Tunis avant et pendant la seconde guerre mondiale. Sa structure est celle du roman autobiographique : le héros, Alexandre Mordekhaï Benillouche, Juif tunisois pauvre, découvre tour à tour l'école, la sexualité, la peur, la solidarité. Apparenté à un roman à thèse, ce livre s'ouvre sur l'impasse Tarfoune, la hara, le quartier juif et finit par l'exil volontaire et presque fortuit. Entre les deux, le héros n'arrive à s'ancrer ni dans sa famille et sa communauté, trop dévalorisées par référence au fascinant rationalisme occidental appris à l'école française, ni dans ce rationalisme même, mis à rude épreuve par les intérêts sordides et les compromissions historiques de l'Occident qui n'est idéal que dans les livres, ni enfin à la jeune nation en devenir qu'est cette Tunisie dont il se sent l'enfant et à laquelle il sait intuitivement qu'il ne pourra pas s'intégrer.
Agar, 1955
Agar est le nom de l'épouse étrangère d'Abraham, celle qu'il prit, désespérant d'avoir une progéniture issue de sa cousine et première épouse Sarah. Agar, c'est Marie, jeune étudiante alsacienne qui a épousé en France le narrateur du roman, médecin juif tunisien qui, rentrant au pays pour s'y installer, la ramène avec lui, partagé entre l' espoir et la crainte. Le roman raconte la dégradation constante des rapports de ces deux êtres, confrontés quotidiennement à ce qui les sépare et que la vie parisienne occultait. Peu à peu la gêne se transmue en haine et en mépris et l'amour qui survit par bribes ne fait qu'accentuer le déchirement. Agar est donc le roman d'un échec et cet échec, au delà de celui du couple, dit celui du dialogue problématique entre l'Orient et l'Occident. Telle est du moins l'impression que laisse la lecture du livre, en dépit des déclarations de l'auteur pour qui Agar définit les obstacles externes et internes qui se dressent devant la communication entre individus et entre peuples, c'est-à-dire les conditions d'un dialogue qui réussirait.
Le Scorpion, 1969
Marcel, ophtalmologue, tente d'ordonner les papiers abandonnés par son frère écrivain, Emile, dans un tiroir. Au désordre des documents correspond celui des multiples récits, leur indétermination, leurs hésitations entre plusieurs espaces fictionnels,désordre qui brouille la narration et fait éclater les formes. Ce roman de l'arbitraire, de la multiplicité des possibles et des versions, évolue dans les reprises, les imbrications, la circularité de la structure thématique. Cette "confession imaginaire" est un "puzzle" (Scorpion, p. 18), "un espace ludique de sémiotisations multiples [1]. Marcel juxtapose les récits prétendument trouvés et les siens propres, les commentaires qu'il ajoute de son propre chef, "problématisant ainsi une stratégie narrative dans laquelle les limites du texte, de l'intertexte, et du métatexte sont complètement brouillées" (pp. 91 - 92).
Pour distinguer les textes d'Emile, ceux du narrateur et les citations ou poèmes, l'auteur a recours à des caractères typographiques différents. Le titre, allégorique, renvoie aux récits du même nom qui ouvrent et ferment le roman. Ces récits représentent les trois versions d'une même histoire, toutes aussi vraisemblables les unes que les autres. "C'est puéril, cette manière de donner au moindre fait un écho, un retentissement, moins clair que le fait lui-même [...] mais c'est peut-être cela la lit-té-ra-tu-re ?" (Le Scorpion, p. 13.) Tour à tour, nous voyons le scorpion se suicider, se tuer malencontreusement et feindre de mourir. "Le dernier texte corrige le premier : non, le scorpion ne meurt pas ; sa mort est une comédie, on le réserve pour d'autres exhibitions: là encore, la littérature dénonce son ambiguïté", écrit J. Arnaud [2] qui présente ce roman comme le roman de l'exclusion où celui qui se sent traqué, comme le scorpion, finit par "agir contre lui -même" selon l'expression du Portrait d'un Juif (p.198).
Le Désert, 1977
Ce roman raconte l'histoire d'un prince, Jubaïr Ouali El-Mammi qui va à la recherche et à la reconquête de son royaume perdu, usurpé par les siens, et qui rencontre, au cours de ses multiples pérégrinations à travers l'Afrique du Nord, obstacles et malheurs. Au bout de son errance, le prince ne reconquiert que "le Royaume du Dedans". C'est ainsi que le roman se rattache par le récit à celui qui le précède, il en constitue un fragment, une continuation, un approfondissement. Par son itinéraire, son héros rappelle à s'y méprendre le grand philosophe et savant tunisien du 14è siècle, Ibn Khaldoun.
De ce roman d'apprentissage émane un appel à l'ouverture et à la reconnaissance mutuelle, une leçon de relativité et de sagesse devant la vie et la mort. Il reste cependant dans ses profondeurs, l'expression amère d'une certaine solitude et "une réclamation véhémente de reconnaissance" [3] On lit dans les premières pages du livre : "Ainsi j'avais tout à Tunis, l'amitié, le loisir et la sécurité : pourtant, je n'y étais pas heureux. J'étais à l' âge on l'on veut donner toute sa mesure, que l'on croit grande(...) Or ; pendant des semaines, on ne faisait même pas appel à moi. Etait-ce pour cette inaction que je m'étais tant préparé au désert?." (p. 31) et le roman s'achève sur la phrase. "Notre héros a fini par tout obtenir parce qu'il ne réclamait plus rien" (p. 243).
Mais "(...) le seul triomphe définitif [étant] celui de la mort" (p. 240), un dernier voeu accapare l'âme du narrateur, voeu dont il se demande s'il est signe de maturité ou nouvelle ombre, rêve chimérique et trompeur : "Dernière sagesse ou suprème illusion, je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans ma terre natale." (p. 225).
Le Pharaon, 1989.
Armand Gozlan, dit le pharaon, autre avatar d'Alexandre Benillouche (qu'on retrouve d'ailleurs malicieusement évoqué comme "le seul écrivain convenable du pays "(p. 57) vit à Tunis les années agitées qui précèdent l'indépendance du pays. Outre la passion ravageuse qu'il éprouve pour Carlotta, une de ses étudiantes, passion qui met en péril son équilibre, sa stabilité et son couple, cet archéologue, par le biais du journalisme, se fait chroniqueur de ces années de violence et de négociations, ce qui donne au livre l'allure d'un roman historique où surgissent des personnages célèbres, sous leur vrai nom (Habib Bourguiba, Pierre Mendès-France, Louis Perillier) ou sous des noms d'emprunt (Bouzid est sans doute Béchir Ben Yahmed, Seukkar est le peintre Hatem El Mekki).
Peut-être l'objectif essentiel de ce livre est-il de justifier le départ en France. Les dernières pages présentent en effet, à peine transposée, l'existence parisienne d'Albert Memmi, évoquant les bouffées de nostalgie qui l'y saisissent au souvenir du pays. L'écriture claire, maîtrisée, retrouve, après les recherches du Scorpion et du Désert, le classicisme de La Statue de Sel et d'Agar.
Le Mirliton du Ciel, 1990
Ce premier recueil de poésie, recueil de la maturité, est une oeuvre lyrique de réconciliation avec la terre natale. Elle frémit de sa sensualité, odeurs, saveurs, moiteurs, et se fait l'écho de sa chaleur familiale et de sa langoureuse vitalité. Avec Le Mirliton du ciel, l'oeuvre ne dit plus le drame et l'exil mais la fête et les retrouvailles. La poésie est chant de joie, hymne nostalgique où le français et l'arabe font bon ménage et ne constituent plus cet "infâme mélange" qu'Alexandre Benillouche dans La Statue de Sel, avouait honnir. Les vers, à de rares exceptions près, comme le dernier poème, qui est en prose et qui est un bel hommage à la Tunisie, sont syllabés mais non rimés, ce qui confère à ces textes une allure mi-prosaïque mi-poétique qui est celle des textes des sages ou, en moins solennel et plus souriant, celle des Ecritures.
A Suivre
Texte extrait du site suivant :
Source : [www.limag.refer.org]
Albert Memmi
Né à Tunis le 15 décembre 1920 dans le quartier juif, "la hara", Albert Memmi fréquente le lycée français de Tunis où il est élève de Jean Amrouche et étudie la philosophie à l'université d'Alger. En 1943, il connaît les camps de travail forcé en Tunisie. Il prépare l'agrégation de philosophie en Sorbonne et se marie à une Française. De retour à Tunis, il anime un laboratoire de psycho-sociologie, enseigne la philosophie et dirige la page littéraire de L'Action (hebdomadaire tunisien). Après l'indépendance de la Tunisie, il se fixe à Paris (Septembre 1956) où il est professeur de psychiatrie sociale à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, attaché de recherches au C.N.R.S, membre de l'Académie des Sciences d'Outre-mer et où il dirige chez Maspéro le collection "Domaine maghrébin". En 1973, il adopte la nationalité française. Il est titulaire du prix de Carthage (Tunis,1953), du prix Fénéon (Paris, 1954) et du prix Simba (Rome).
Notices sur les oeuvres
La Statue de Sel, 1953
Ce roman, préfacé par Camus, est considéré comme un classique de la littérature maghrébine. Son écriture, sobre, limpide, est démonstrative et presque didactique. Ses thèmes sont l'interrogation sur l'identité et les rapports du moi avec sa communauté et les autres groupes qui cohabitent à Tunis avant et pendant la seconde guerre mondiale. Sa structure est celle du roman autobiographique : le héros, Alexandre Mordekhaï Benillouche, Juif tunisois pauvre, découvre tour à tour l'école, la sexualité, la peur, la solidarité. Apparenté à un roman à thèse, ce livre s'ouvre sur l'impasse Tarfoune, la hara, le quartier juif et finit par l'exil volontaire et presque fortuit. Entre les deux, le héros n'arrive à s'ancrer ni dans sa famille et sa communauté, trop dévalorisées par référence au fascinant rationalisme occidental appris à l'école française, ni dans ce rationalisme même, mis à rude épreuve par les intérêts sordides et les compromissions historiques de l'Occident qui n'est idéal que dans les livres, ni enfin à la jeune nation en devenir qu'est cette Tunisie dont il se sent l'enfant et à laquelle il sait intuitivement qu'il ne pourra pas s'intégrer.
Agar, 1955
Agar est le nom de l'épouse étrangère d'Abraham, celle qu'il prit, désespérant d'avoir une progéniture issue de sa cousine et première épouse Sarah. Agar, c'est Marie, jeune étudiante alsacienne qui a épousé en France le narrateur du roman, médecin juif tunisien qui, rentrant au pays pour s'y installer, la ramène avec lui, partagé entre l' espoir et la crainte. Le roman raconte la dégradation constante des rapports de ces deux êtres, confrontés quotidiennement à ce qui les sépare et que la vie parisienne occultait. Peu à peu la gêne se transmue en haine et en mépris et l'amour qui survit par bribes ne fait qu'accentuer le déchirement. Agar est donc le roman d'un échec et cet échec, au delà de celui du couple, dit celui du dialogue problématique entre l'Orient et l'Occident. Telle est du moins l'impression que laisse la lecture du livre, en dépit des déclarations de l'auteur pour qui Agar définit les obstacles externes et internes qui se dressent devant la communication entre individus et entre peuples, c'est-à-dire les conditions d'un dialogue qui réussirait.
Le Scorpion, 1969
Marcel, ophtalmologue, tente d'ordonner les papiers abandonnés par son frère écrivain, Emile, dans un tiroir. Au désordre des documents correspond celui des multiples récits, leur indétermination, leurs hésitations entre plusieurs espaces fictionnels,désordre qui brouille la narration et fait éclater les formes. Ce roman de l'arbitraire, de la multiplicité des possibles et des versions, évolue dans les reprises, les imbrications, la circularité de la structure thématique. Cette "confession imaginaire" est un "puzzle" (Scorpion, p. 18), "un espace ludique de sémiotisations multiples [1]. Marcel juxtapose les récits prétendument trouvés et les siens propres, les commentaires qu'il ajoute de son propre chef, "problématisant ainsi une stratégie narrative dans laquelle les limites du texte, de l'intertexte, et du métatexte sont complètement brouillées" (pp. 91 - 92).
Pour distinguer les textes d'Emile, ceux du narrateur et les citations ou poèmes, l'auteur a recours à des caractères typographiques différents. Le titre, allégorique, renvoie aux récits du même nom qui ouvrent et ferment le roman. Ces récits représentent les trois versions d'une même histoire, toutes aussi vraisemblables les unes que les autres. "C'est puéril, cette manière de donner au moindre fait un écho, un retentissement, moins clair que le fait lui-même [...] mais c'est peut-être cela la lit-té-ra-tu-re ?" (Le Scorpion, p. 13.) Tour à tour, nous voyons le scorpion se suicider, se tuer malencontreusement et feindre de mourir. "Le dernier texte corrige le premier : non, le scorpion ne meurt pas ; sa mort est une comédie, on le réserve pour d'autres exhibitions: là encore, la littérature dénonce son ambiguïté", écrit J. Arnaud [2] qui présente ce roman comme le roman de l'exclusion où celui qui se sent traqué, comme le scorpion, finit par "agir contre lui -même" selon l'expression du Portrait d'un Juif (p.198).
Le Désert, 1977
Ce roman raconte l'histoire d'un prince, Jubaïr Ouali El-Mammi qui va à la recherche et à la reconquête de son royaume perdu, usurpé par les siens, et qui rencontre, au cours de ses multiples pérégrinations à travers l'Afrique du Nord, obstacles et malheurs. Au bout de son errance, le prince ne reconquiert que "le Royaume du Dedans". C'est ainsi que le roman se rattache par le récit à celui qui le précède, il en constitue un fragment, une continuation, un approfondissement. Par son itinéraire, son héros rappelle à s'y méprendre le grand philosophe et savant tunisien du 14è siècle, Ibn Khaldoun.
De ce roman d'apprentissage émane un appel à l'ouverture et à la reconnaissance mutuelle, une leçon de relativité et de sagesse devant la vie et la mort. Il reste cependant dans ses profondeurs, l'expression amère d'une certaine solitude et "une réclamation véhémente de reconnaissance" [3] On lit dans les premières pages du livre : "Ainsi j'avais tout à Tunis, l'amitié, le loisir et la sécurité : pourtant, je n'y étais pas heureux. J'étais à l' âge on l'on veut donner toute sa mesure, que l'on croit grande(...) Or ; pendant des semaines, on ne faisait même pas appel à moi. Etait-ce pour cette inaction que je m'étais tant préparé au désert?." (p. 31) et le roman s'achève sur la phrase. "Notre héros a fini par tout obtenir parce qu'il ne réclamait plus rien" (p. 243).
Mais "(...) le seul triomphe définitif [étant] celui de la mort" (p. 240), un dernier voeu accapare l'âme du narrateur, voeu dont il se demande s'il est signe de maturité ou nouvelle ombre, rêve chimérique et trompeur : "Dernière sagesse ou suprème illusion, je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans ma terre natale." (p. 225).
Le Pharaon, 1989.
Armand Gozlan, dit le pharaon, autre avatar d'Alexandre Benillouche (qu'on retrouve d'ailleurs malicieusement évoqué comme "le seul écrivain convenable du pays "(p. 57) vit à Tunis les années agitées qui précèdent l'indépendance du pays. Outre la passion ravageuse qu'il éprouve pour Carlotta, une de ses étudiantes, passion qui met en péril son équilibre, sa stabilité et son couple, cet archéologue, par le biais du journalisme, se fait chroniqueur de ces années de violence et de négociations, ce qui donne au livre l'allure d'un roman historique où surgissent des personnages célèbres, sous leur vrai nom (Habib Bourguiba, Pierre Mendès-France, Louis Perillier) ou sous des noms d'emprunt (Bouzid est sans doute Béchir Ben Yahmed, Seukkar est le peintre Hatem El Mekki).
Peut-être l'objectif essentiel de ce livre est-il de justifier le départ en France. Les dernières pages présentent en effet, à peine transposée, l'existence parisienne d'Albert Memmi, évoquant les bouffées de nostalgie qui l'y saisissent au souvenir du pays. L'écriture claire, maîtrisée, retrouve, après les recherches du Scorpion et du Désert, le classicisme de La Statue de Sel et d'Agar.
Le Mirliton du Ciel, 1990
Ce premier recueil de poésie, recueil de la maturité, est une oeuvre lyrique de réconciliation avec la terre natale. Elle frémit de sa sensualité, odeurs, saveurs, moiteurs, et se fait l'écho de sa chaleur familiale et de sa langoureuse vitalité. Avec Le Mirliton du ciel, l'oeuvre ne dit plus le drame et l'exil mais la fête et les retrouvailles. La poésie est chant de joie, hymne nostalgique où le français et l'arabe font bon ménage et ne constituent plus cet "infâme mélange" qu'Alexandre Benillouche dans La Statue de Sel, avouait honnir. Les vers, à de rares exceptions près, comme le dernier poème, qui est en prose et qui est un bel hommage à la Tunisie, sont syllabés mais non rimés, ce qui confère à ces textes une allure mi-prosaïque mi-poétique qui est celle des textes des sages ou, en moins solennel et plus souriant, celle des Ecritures.
A Suivre
|
Albert Memmi - 2 17 septembre 2007, 07:56 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
L'oeuvre littéraire d'Albert Memmi : constantes et évolution
De l'écriture comme mise en ordre
Certains romans de Memmi, comme Le Scorpion ou Le Désert, frappent par leur aspect mêlé, hybride, en perpétuelle mue, leur mosaïque interne qui fait qu'à l'intérieur d'un même texte et d'une même page les genres varient et se fondent, les styles fusionnent et la plume se diversifie au gré des situations et des messages. L'écrivain, faisant à la fois oeuvre de narrateur et de poète, voire d'essayiste et de philosophe, semble, comme l'un de ses héros, avoir caressé le projet d'une "écriture colorée" [4] qui permettrait de classer les textes et de les distinguer, une écriture où chaque teinte correspondrait à un type de discours, où le bariolage des mots et des paragraphes correspondrait aux ondulations de la vision, aux va-et-vient du coeur et de l'esprit, aux fluctuations des récits et des commentaires. Tout se passe comme si ce vague projet de colorer les mots procédait de la volonté de mettre de l'ordre dans le"fouillis" [5] de l'oeuvre, de telle sorte que le lecteur puisse mieux se repérer dans cet ondoiement du texte dont l'artiste poète et l'analyste-essayiste se disputent sans cesse la paternité.
Les romans de Memmi, par leur perpétuel effort d'inventaire et par leur construction syncopée et labyrinthique qui fait alterner sans transition le fait vrai ou historique et le commentaire ou la rêverie, semblent s'organiser autour d'un ensemble de "fiches" que l'écrivain tente de dépoussiérer et de disposer dans l'ordre qu'il a choisi. Aussi l'oeuvre d'Albert Memmi présente-t-elle souvent l'acte d'écrire comme une opération de nettoyage et de clarification de tout ce qui, dans la conscience et la mémoire, demeure brouillé et trouble. Dans La Terre intérieure, l'auteur, évoquant le caractère autobiographique d'Agar, parle du "désordre qui était en [lui]". (p. 148) et, partout dans son oeuvre, se manifeste avec urgence le désir d'une vision claire.
Marcel, dans Le Scorpion, s'interroge à propos de l'écrivain Emile: "Pourquoi ne pas supposer qu'il a gagné un autre pays où, allégé de nos problèmes, il met de l'ordre lentement dans les siens?" (p. 255). C'est en fait par le moyen privilégié de l'oeuvre, de l'écriture, que Memmi tente de mettre en ordre ses idées, ses sentiments, ses sensations, qu'il essaye de "se décrasser l'âme" (p. 255).C'est ce qui justifie, d'une oeuvre à l'autre, les reprises de thèmes, de questions et même de phrases, parfois textuellement, le retour de certains personnages, de certaines scènes, l'annonce, dans certains textes, de développements ultérieurs, l'auto-citation ou le commentaire décalé [6].
L'introspection, entre cécité et lucidité
C'est ainsi que le pacte de l'écrit apparaît d'abord comme un pacte autobiographique où le texte est un miroir qui tantôt nous renvoie le passé vrai, dans sa nudité objective, tantôt nous reflète les contradictions internes de celui qui se scrute de l'intérieur et dissèque l'événement, en proie à la nostalgie ou soumis à la sentence de la raison. Cette problématique du miroir impliquant d'abord le regard, le désir de voir, se manifeste dans l'oeuvre memmienne sous la forme de l'obsession des yeux, de la vue. Dans ses romans, en effet, il est souvent question de maladies des yeux et d'ophtalmologie. C'est, par exemple, parce que son père est atteint de glaucome que Marcel, dans Le Scorpion, choisit de se spécialiser en ophtalmologie (p. 162). Outre le réalisme du détail dans un contexte géographique de chaleur, de lumière et de vent où l'intégrité des yeux était d'autant plus menacée que les remèdes étaient rares (cf. Le Scorpion, p. 63) et outre la référence autobiographique à la myopie de l'auteur, on peut noter dans l'oeuvre un intérêt très vif accordé à la faculté de voir, de bien voir, c'est-à-dire de comprendre. Si la peur de la cécité physique n'est pas négligeable, l'angoisse de la cécité spirituelle est fondamentale dans l'oeuvre de celui dont chaque écrit signe une nouvelle tentative, un nouvel essai de bien voir : "Toute son oeuvre était un effort désespéré pour mieux voir : il s'y abîma les yeux." (Le Scorpion, p. 246). A force de fixer son objectif en effet, il arrive que la vue se brouille et d'interrogations en interrogations, de remise en cause en remise en cause, perde son essence même, la faculté de voir. Mais, comme chez les devins de l'antiquité, cette perte est compensée par une acuité supérieure de l'esprit. L'oncle Makhlouf, dans Le Scorpion, vit dans l'obscurité d'une pièce où il tisse ses fils de soie, il ne voit presque rien mais il perçoit l'essentiel, enfermé dans son "royaume du Dedans". Sa cécité est une condition nécessaire à ses méditations. Son regard est intérieur, sa myopie, écrit J. Arnaud, est une "métaphore de la sagesse".
Belalouna, le navigateur des Chroniques du Royaume du Dedans, est aussi aveugle mais il a perdu la vue à la suite d'un effort pour voir clair. Il s'est brûlé les yeux en fixant du regard les falaises de sel (L'Oeil rouge). Cela nous ramène quelques années en arrière, à la Statue de Sel : "Je meurs pour m'être retourné sur moi-même. Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître. Comme la femme de Loth, que Dieu changea en statue de sel, puis-je encore vivre au delà de mon regard?" (p. 368) Bien voir, dans l'oeuvre de Memmi, c'est en fait "avoir la conscience la plus aiguë de soi-même (...)" (Le Scorpion p. 215) : le regard est essentiellement un regard introspectif, intérieur.
Crise d'identité et auto-justification
Rejoignant les autres romans maghrébins dans ce sens là, l'oeuvre autobiographique de Memmi est essentiellement celle de la crise identitaire. L'"étranger" à l'univers (Le Scorpion, p.43), l'homme hybride sans cesse "arraché à [lui-] même" (Agar, p. 22) de La Statue de Sel au Pharaon, "n'a pas résolu ce problème fondamental : comment être d'un peuple et de tous?" (Le Pharaon, p. 372) et s' interroge en permanence : qui suis-je?. A cette grande question, les réponses sont parcellaires, fragmentées comme l'oeuvre et son auteur qui confie à l'entreprise romanesque la tâche de "recoller [ses] morceaux" (Le Scorpion, p. 207), de s'adonner à une "constante réadaptation de soi" (La Statue de Sel, p. 44). Ce souci de se connaître qui caractérise les écrits de "ceux qui vivent dans l'éparpillement, le doute et la détresse historique" (Le Scorpion, p. 150) ne se dissocie pas de la peur de l'incompréhension des autres. Le désir de bien voir draine dans son sillage la crainte d'être mal vu et par conséquent le souci du rétablissement d'une certaine équité. Ecrire prend alors la douloureuse allure d'une volonté de ne pas déchoir à ses propres yeux et aux yeux des autres et de dissiper l'incompréhension et le malentendu, ce lourd malentendu qui pèse entre celui qui a choisi le départ et ses compagnons de route restés au pays natal. "On finit par le laisser partir, à regret, et soupçonné par tout le monde.
- C'est tout à fait ça ; c'est exactement cela qui m'arrive". (Le Scorpion, p. 250). Voir et revoir les choses procède de cette entreprise, consciente ou inconsciente, chez l'auteur, de dissiper les soupçons, d'expliquer directement ou indirectement, avec ou sans artifices poétiques, avec ou sans "jeu", le refus de "la vieille accusation de traîtrise" (Le Désert, p. 236) et de l'identification de son départ à la fugue du "voleur" (Le Scorpion, p. 250): "Ah si j'avais du talent, le seul livre que j'aurais écrit avec joie, je l'aurais intitulé "personne n'est coupable"(Le Scorpion, p. 240). Peu importe qui parle ici ou là, le caractère récurrent de certaines interrogations est lourd de sens et symptomatique d'une inquiétude, réelle, enfouie, qui fait surface au hasard des personnages et des scènes et qui est souvent confirmée par les écrits théoriques [7].
"Alors quoi? Trop chaud au soleil, vite froid à l'ombre. Et si malgré tout, je m'étais trompé, si j'avais eu tort de partir? Si l'oncle avait raison? Allons, arrêtons-là cette "balance"(Le Scorpion, p.266). Cette "balance", cette "danse", "un pas en avant / deux pas en arrière" (Le Mirliton, p. 47),entre l'attachement sentimental à la spiritualité de la tribu et la fascination qu'exerce un universalisme rationaliste, rigoureux mais, somme toute, cassant et froid, cette oscillation entre l'Orient et l'Occident si dominante dans La Statue de Sel et qui réapparaît encore dans Le Pharaon, c'est ce qui fonde toute l'oeuvre de Memmi et lui confère ce sens de l'exigence toujours renouvelé et toujours plus lucide, plus perspicace, plus juste.
Une oeuvre maghrébine
Dans cette oeuvre qui oscille entre deux pôles et où l'écrivain-narrateur se conduit en parfait "équilibriste" (Agar, p. 127), il est à remarquer cependant que, souvent, la balance penche d'un côté plutôt que de l'autre, conférant aux textes leur cachet local, maghrébin, oriental. Dans cette oeuvre pour l'essentiel écrite en France, on constate que l'action se passe toujours au pays natal ou dans un pays qui lui ressemble, que la majorité des personnages sont juifs et arabes et apparaissent dans leur propre univers, avec leurs noms si poétiques et si vrais : Maïssa, Katoussa, Manana, Faloussa, Ghozala etc... et leurs spécificités. La langue française même, dans laquelle s'exprime l'oeuvre, est largement agrémentée d'arabismes, de ce dialecte tunisois et sa variante juive qui, de La Statue de Sel au Mirliton du Ciel confèrent à l'écriture tout son piment et toute sa poésie. Vivant, écrivant et publiant à Paris, l'auteur semble toujours diriger ses yeux vers la terre natale, son Orient, de même que les Musulmans du monde entier dirigent leurs prières vers la Mecque. Sorti de" l'impasse", l'écrivain n'a fait qu'y revenir sans cesse par l'écriture, à défaut d'y revenir physiquement. De La Statue de Sel au Mirliton du Ciel, la même phrase se répète et se charge de résorber les contradictions, de rétablir les liens et les ponts coupés: "Mes matins d'espoir doivent embaumer le café maure". (La Statue de Sel,p. 18)."Mes matins d'espoir embaument le café maure "(Le Mirliton, p. 13). Même quand les oeuvres sont de fiction, leur cadre temporel n'est jamais le présent mais un passé proche ou lointain et leur cadre spatial n'est jamais Paris ou les grandes cités urbaines d'Occident. "Les pieds ici, les yeux ailleurs", Memmi a choisi de situer tous ses romans dans son Orient de chaleur et de lumière, un Orient qu'il a quitté mais dont il ne peut se départir : toute son oeuvre en dit les drames et les espoirs.
Le temps retrouvé
Si les romans de Memmi sont en effet autobiographiques, c'est que l'auteur s'y est fixé pour tâche obsédante d'écrire le passé, de revenir sur les traces comme dans Le Désert ou Le Pharaon. Si dans ce roman, Gozlan caresse l'idée d'écrire la biographie du chef (p. 336), de Bourguiba, c'est aussi du parcours du Pharaon qu'il pourrait s'agir, de son propre parcours. Dans Le Désert aussi, l'écriture se confond avec la "reconquête du royaume", le retour sur soi : "Ai-je tenté sérieusement de reprendre le royaume de mon père ? N'ai-je pas agi, plutôt, comme si le seul royaume à conquérir était celui de soi-même?" ( Le Désert, p. 235).
Si l'image de la cave est une image-clef dans l'oeuvre de Memmi [8], c'est qu'elle évoque le lieu retranché où on stocke et laisse mûrir et se décanter les choses, le passé où on les abandonne aussi, pour mieux les retrouver au hasard des rencontres. Rappelant que pour Mircea Eliade, "les caves sont le symbole mystique du retour à la terre-mère", Robert Elbaz souligne que, chez Memmi, "l'histoire de la cave devient la sienne propre, puis-celle de la tribu, et enfin, l'histoire de l'humanité" car, continue t-il, "retracer son passé, c'est vouloir définir les origines de la civilisation. La descente en soi est la descente vers le modèle originel" [9] Image de l'ombre, du cocon matriciel et de l'ensourcement, la cave est un lieu de coïncidence émue avec les objets d'autrefois, sur lesquels on jette un regard neuf et qui nous ouvrent les portes du passé. L'importance que l'écrivain accorde à l'image de la cave est celle-là même qu'il accorde à son passé qu'il se plaît à convoquer et à l'impasse Tarfoune par exemple, qui traverse l'oeuvre et qui constitue le double et la continuité de cette image de l'intériorité, du retranchement et de l'intimité. Partir, voyager, s'exiler, s'absenter sont autant de figures d'une même réalité, d'une même obsession. Les voyages entrepris, rêvés, réalisés ou pas mais en tout cas jamais décrits( qu'il s'agisse de celui de Benillouche, de celui de Marcel ou de celui d'Emile) renvoient à la même angoisse, à l'angoisse du même départ, le départ réel du pays d'origine vers un ailleurs et de nouveau de cet ailleurs vers le pays quitté, vers le passé. Deux voyages se superposent donc, l'un, concret renvoie au départ réel vers la France et l'autre, onirique, sentimental, sensuel et intériorisé, est celui du retour auquel on aspire. Ce voyage-là est celui que la littérature permet et il est le seul qu'elle décrit et qui la constitue, celui qui fait d'elle "le livre nécessaire" dont rêve Emile dans Le Scorpion (p. 237).
Le voyage, même s'il est souvent question des voyages au pluriel dans l'oeuvre de Memmi ("Peut-être a-t-il simplement entrepris un de ces longs voyages dont il est coutumier... "Le Scorpion, p. 255) prend l'allure d'une figure circulaire, d'un aller-retour où l'aller se confond toujours avec le retour, où le retour dispute à l'aller son existence même, sa réalité. Ce départ qui permet toujours paradoxalement de se munir de sa "petite patrie portative" (Le Scorpion, p. 254) n'en est pas un en fait, c'est un simulacre, un leurre, un subterfuge car le voyageur n'y fait que "tourner autour du pot" (Ibid, p. 238).
En outre, vivre en France pourrait être le meilleur moyen de garder intacte l'image du passé lointain, du pays de l'enfance. La nostalgie opérant, c'est loin de la terre natale qu'on apprécie le mieux son image. C'est en vivant dans le tourbillon de l'Occident qu'on apprend le mieux à prendre ses distances à son égard pour se réfugier dans le paradis de l'enfance. Paradoxalement, c'est à l'étranger qu'on peut vivre le plus intensément son pays d'origine, parce qu'on en préserve sans la mettre tous les jours à l'épreuve, une image inaltérée, intacte.
De l'écriture comme mise en ordre
Certains romans de Memmi, comme Le Scorpion ou Le Désert, frappent par leur aspect mêlé, hybride, en perpétuelle mue, leur mosaïque interne qui fait qu'à l'intérieur d'un même texte et d'une même page les genres varient et se fondent, les styles fusionnent et la plume se diversifie au gré des situations et des messages. L'écrivain, faisant à la fois oeuvre de narrateur et de poète, voire d'essayiste et de philosophe, semble, comme l'un de ses héros, avoir caressé le projet d'une "écriture colorée" [4] qui permettrait de classer les textes et de les distinguer, une écriture où chaque teinte correspondrait à un type de discours, où le bariolage des mots et des paragraphes correspondrait aux ondulations de la vision, aux va-et-vient du coeur et de l'esprit, aux fluctuations des récits et des commentaires. Tout se passe comme si ce vague projet de colorer les mots procédait de la volonté de mettre de l'ordre dans le"fouillis" [5] de l'oeuvre, de telle sorte que le lecteur puisse mieux se repérer dans cet ondoiement du texte dont l'artiste poète et l'analyste-essayiste se disputent sans cesse la paternité.
Les romans de Memmi, par leur perpétuel effort d'inventaire et par leur construction syncopée et labyrinthique qui fait alterner sans transition le fait vrai ou historique et le commentaire ou la rêverie, semblent s'organiser autour d'un ensemble de "fiches" que l'écrivain tente de dépoussiérer et de disposer dans l'ordre qu'il a choisi. Aussi l'oeuvre d'Albert Memmi présente-t-elle souvent l'acte d'écrire comme une opération de nettoyage et de clarification de tout ce qui, dans la conscience et la mémoire, demeure brouillé et trouble. Dans La Terre intérieure, l'auteur, évoquant le caractère autobiographique d'Agar, parle du "désordre qui était en [lui]". (p. 148) et, partout dans son oeuvre, se manifeste avec urgence le désir d'une vision claire.
Marcel, dans Le Scorpion, s'interroge à propos de l'écrivain Emile: "Pourquoi ne pas supposer qu'il a gagné un autre pays où, allégé de nos problèmes, il met de l'ordre lentement dans les siens?" (p. 255). C'est en fait par le moyen privilégié de l'oeuvre, de l'écriture, que Memmi tente de mettre en ordre ses idées, ses sentiments, ses sensations, qu'il essaye de "se décrasser l'âme" (p. 255).C'est ce qui justifie, d'une oeuvre à l'autre, les reprises de thèmes, de questions et même de phrases, parfois textuellement, le retour de certains personnages, de certaines scènes, l'annonce, dans certains textes, de développements ultérieurs, l'auto-citation ou le commentaire décalé [6].
L'introspection, entre cécité et lucidité
C'est ainsi que le pacte de l'écrit apparaît d'abord comme un pacte autobiographique où le texte est un miroir qui tantôt nous renvoie le passé vrai, dans sa nudité objective, tantôt nous reflète les contradictions internes de celui qui se scrute de l'intérieur et dissèque l'événement, en proie à la nostalgie ou soumis à la sentence de la raison. Cette problématique du miroir impliquant d'abord le regard, le désir de voir, se manifeste dans l'oeuvre memmienne sous la forme de l'obsession des yeux, de la vue. Dans ses romans, en effet, il est souvent question de maladies des yeux et d'ophtalmologie. C'est, par exemple, parce que son père est atteint de glaucome que Marcel, dans Le Scorpion, choisit de se spécialiser en ophtalmologie (p. 162). Outre le réalisme du détail dans un contexte géographique de chaleur, de lumière et de vent où l'intégrité des yeux était d'autant plus menacée que les remèdes étaient rares (cf. Le Scorpion, p. 63) et outre la référence autobiographique à la myopie de l'auteur, on peut noter dans l'oeuvre un intérêt très vif accordé à la faculté de voir, de bien voir, c'est-à-dire de comprendre. Si la peur de la cécité physique n'est pas négligeable, l'angoisse de la cécité spirituelle est fondamentale dans l'oeuvre de celui dont chaque écrit signe une nouvelle tentative, un nouvel essai de bien voir : "Toute son oeuvre était un effort désespéré pour mieux voir : il s'y abîma les yeux." (Le Scorpion, p. 246). A force de fixer son objectif en effet, il arrive que la vue se brouille et d'interrogations en interrogations, de remise en cause en remise en cause, perde son essence même, la faculté de voir. Mais, comme chez les devins de l'antiquité, cette perte est compensée par une acuité supérieure de l'esprit. L'oncle Makhlouf, dans Le Scorpion, vit dans l'obscurité d'une pièce où il tisse ses fils de soie, il ne voit presque rien mais il perçoit l'essentiel, enfermé dans son "royaume du Dedans". Sa cécité est une condition nécessaire à ses méditations. Son regard est intérieur, sa myopie, écrit J. Arnaud, est une "métaphore de la sagesse".
Belalouna, le navigateur des Chroniques du Royaume du Dedans, est aussi aveugle mais il a perdu la vue à la suite d'un effort pour voir clair. Il s'est brûlé les yeux en fixant du regard les falaises de sel (L'Oeil rouge). Cela nous ramène quelques années en arrière, à la Statue de Sel : "Je meurs pour m'être retourné sur moi-même. Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître. Comme la femme de Loth, que Dieu changea en statue de sel, puis-je encore vivre au delà de mon regard?" (p. 368) Bien voir, dans l'oeuvre de Memmi, c'est en fait "avoir la conscience la plus aiguë de soi-même (...)" (Le Scorpion p. 215) : le regard est essentiellement un regard introspectif, intérieur.
Crise d'identité et auto-justification
Rejoignant les autres romans maghrébins dans ce sens là, l'oeuvre autobiographique de Memmi est essentiellement celle de la crise identitaire. L'"étranger" à l'univers (Le Scorpion, p.43), l'homme hybride sans cesse "arraché à [lui-] même" (Agar, p. 22) de La Statue de Sel au Pharaon, "n'a pas résolu ce problème fondamental : comment être d'un peuple et de tous?" (Le Pharaon, p. 372) et s' interroge en permanence : qui suis-je?. A cette grande question, les réponses sont parcellaires, fragmentées comme l'oeuvre et son auteur qui confie à l'entreprise romanesque la tâche de "recoller [ses] morceaux" (Le Scorpion, p. 207), de s'adonner à une "constante réadaptation de soi" (La Statue de Sel, p. 44). Ce souci de se connaître qui caractérise les écrits de "ceux qui vivent dans l'éparpillement, le doute et la détresse historique" (Le Scorpion, p. 150) ne se dissocie pas de la peur de l'incompréhension des autres. Le désir de bien voir draine dans son sillage la crainte d'être mal vu et par conséquent le souci du rétablissement d'une certaine équité. Ecrire prend alors la douloureuse allure d'une volonté de ne pas déchoir à ses propres yeux et aux yeux des autres et de dissiper l'incompréhension et le malentendu, ce lourd malentendu qui pèse entre celui qui a choisi le départ et ses compagnons de route restés au pays natal. "On finit par le laisser partir, à regret, et soupçonné par tout le monde.
- C'est tout à fait ça ; c'est exactement cela qui m'arrive". (Le Scorpion, p. 250). Voir et revoir les choses procède de cette entreprise, consciente ou inconsciente, chez l'auteur, de dissiper les soupçons, d'expliquer directement ou indirectement, avec ou sans artifices poétiques, avec ou sans "jeu", le refus de "la vieille accusation de traîtrise" (Le Désert, p. 236) et de l'identification de son départ à la fugue du "voleur" (Le Scorpion, p. 250): "Ah si j'avais du talent, le seul livre que j'aurais écrit avec joie, je l'aurais intitulé "personne n'est coupable"(Le Scorpion, p. 240). Peu importe qui parle ici ou là, le caractère récurrent de certaines interrogations est lourd de sens et symptomatique d'une inquiétude, réelle, enfouie, qui fait surface au hasard des personnages et des scènes et qui est souvent confirmée par les écrits théoriques [7].
"Alors quoi? Trop chaud au soleil, vite froid à l'ombre. Et si malgré tout, je m'étais trompé, si j'avais eu tort de partir? Si l'oncle avait raison? Allons, arrêtons-là cette "balance"(Le Scorpion, p.266). Cette "balance", cette "danse", "un pas en avant / deux pas en arrière" (Le Mirliton, p. 47),entre l'attachement sentimental à la spiritualité de la tribu et la fascination qu'exerce un universalisme rationaliste, rigoureux mais, somme toute, cassant et froid, cette oscillation entre l'Orient et l'Occident si dominante dans La Statue de Sel et qui réapparaît encore dans Le Pharaon, c'est ce qui fonde toute l'oeuvre de Memmi et lui confère ce sens de l'exigence toujours renouvelé et toujours plus lucide, plus perspicace, plus juste.
Une oeuvre maghrébine
Dans cette oeuvre qui oscille entre deux pôles et où l'écrivain-narrateur se conduit en parfait "équilibriste" (Agar, p. 127), il est à remarquer cependant que, souvent, la balance penche d'un côté plutôt que de l'autre, conférant aux textes leur cachet local, maghrébin, oriental. Dans cette oeuvre pour l'essentiel écrite en France, on constate que l'action se passe toujours au pays natal ou dans un pays qui lui ressemble, que la majorité des personnages sont juifs et arabes et apparaissent dans leur propre univers, avec leurs noms si poétiques et si vrais : Maïssa, Katoussa, Manana, Faloussa, Ghozala etc... et leurs spécificités. La langue française même, dans laquelle s'exprime l'oeuvre, est largement agrémentée d'arabismes, de ce dialecte tunisois et sa variante juive qui, de La Statue de Sel au Mirliton du Ciel confèrent à l'écriture tout son piment et toute sa poésie. Vivant, écrivant et publiant à Paris, l'auteur semble toujours diriger ses yeux vers la terre natale, son Orient, de même que les Musulmans du monde entier dirigent leurs prières vers la Mecque. Sorti de" l'impasse", l'écrivain n'a fait qu'y revenir sans cesse par l'écriture, à défaut d'y revenir physiquement. De La Statue de Sel au Mirliton du Ciel, la même phrase se répète et se charge de résorber les contradictions, de rétablir les liens et les ponts coupés: "Mes matins d'espoir doivent embaumer le café maure". (La Statue de Sel,p. 18)."Mes matins d'espoir embaument le café maure "(Le Mirliton, p. 13). Même quand les oeuvres sont de fiction, leur cadre temporel n'est jamais le présent mais un passé proche ou lointain et leur cadre spatial n'est jamais Paris ou les grandes cités urbaines d'Occident. "Les pieds ici, les yeux ailleurs", Memmi a choisi de situer tous ses romans dans son Orient de chaleur et de lumière, un Orient qu'il a quitté mais dont il ne peut se départir : toute son oeuvre en dit les drames et les espoirs.
Le temps retrouvé
Si les romans de Memmi sont en effet autobiographiques, c'est que l'auteur s'y est fixé pour tâche obsédante d'écrire le passé, de revenir sur les traces comme dans Le Désert ou Le Pharaon. Si dans ce roman, Gozlan caresse l'idée d'écrire la biographie du chef (p. 336), de Bourguiba, c'est aussi du parcours du Pharaon qu'il pourrait s'agir, de son propre parcours. Dans Le Désert aussi, l'écriture se confond avec la "reconquête du royaume", le retour sur soi : "Ai-je tenté sérieusement de reprendre le royaume de mon père ? N'ai-je pas agi, plutôt, comme si le seul royaume à conquérir était celui de soi-même?" ( Le Désert, p. 235).
Si l'image de la cave est une image-clef dans l'oeuvre de Memmi [8], c'est qu'elle évoque le lieu retranché où on stocke et laisse mûrir et se décanter les choses, le passé où on les abandonne aussi, pour mieux les retrouver au hasard des rencontres. Rappelant que pour Mircea Eliade, "les caves sont le symbole mystique du retour à la terre-mère", Robert Elbaz souligne que, chez Memmi, "l'histoire de la cave devient la sienne propre, puis-celle de la tribu, et enfin, l'histoire de l'humanité" car, continue t-il, "retracer son passé, c'est vouloir définir les origines de la civilisation. La descente en soi est la descente vers le modèle originel" [9] Image de l'ombre, du cocon matriciel et de l'ensourcement, la cave est un lieu de coïncidence émue avec les objets d'autrefois, sur lesquels on jette un regard neuf et qui nous ouvrent les portes du passé. L'importance que l'écrivain accorde à l'image de la cave est celle-là même qu'il accorde à son passé qu'il se plaît à convoquer et à l'impasse Tarfoune par exemple, qui traverse l'oeuvre et qui constitue le double et la continuité de cette image de l'intériorité, du retranchement et de l'intimité. Partir, voyager, s'exiler, s'absenter sont autant de figures d'une même réalité, d'une même obsession. Les voyages entrepris, rêvés, réalisés ou pas mais en tout cas jamais décrits( qu'il s'agisse de celui de Benillouche, de celui de Marcel ou de celui d'Emile) renvoient à la même angoisse, à l'angoisse du même départ, le départ réel du pays d'origine vers un ailleurs et de nouveau de cet ailleurs vers le pays quitté, vers le passé. Deux voyages se superposent donc, l'un, concret renvoie au départ réel vers la France et l'autre, onirique, sentimental, sensuel et intériorisé, est celui du retour auquel on aspire. Ce voyage-là est celui que la littérature permet et il est le seul qu'elle décrit et qui la constitue, celui qui fait d'elle "le livre nécessaire" dont rêve Emile dans Le Scorpion (p. 237).
Le voyage, même s'il est souvent question des voyages au pluriel dans l'oeuvre de Memmi ("Peut-être a-t-il simplement entrepris un de ces longs voyages dont il est coutumier... "Le Scorpion, p. 255) prend l'allure d'une figure circulaire, d'un aller-retour où l'aller se confond toujours avec le retour, où le retour dispute à l'aller son existence même, sa réalité. Ce départ qui permet toujours paradoxalement de se munir de sa "petite patrie portative" (Le Scorpion, p. 254) n'en est pas un en fait, c'est un simulacre, un leurre, un subterfuge car le voyageur n'y fait que "tourner autour du pot" (Ibid, p. 238).
En outre, vivre en France pourrait être le meilleur moyen de garder intacte l'image du passé lointain, du pays de l'enfance. La nostalgie opérant, c'est loin de la terre natale qu'on apprécie le mieux son image. C'est en vivant dans le tourbillon de l'Occident qu'on apprend le mieux à prendre ses distances à son égard pour se réfugier dans le paradis de l'enfance. Paradoxalement, c'est à l'étranger qu'on peut vivre le plus intensément son pays d'origine, parce qu'on en préserve sans la mettre tous les jours à l'épreuve, une image inaltérée, intacte.
|
Albert Memmi - 3 17 septembre 2007, 08:16 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
Commentaire et livre unique
Qu'il y ait eu départ ou pas, scission ou pas, le son de cloche est toujours le même, l'oeuvre répercute le même écho, ce même "attachement viscéral" à la patrie d'origine qu'évoque Le Scorpion (p. 95). "Il s'agit en somme d'une longue entreprise, d'un seul livre constitué par un emboîtement de livres l'un dans l'autre. J'aime assez cette façon de mettre une oeuvre dans une autre et une troisième dans une seconde... Ce n'est pas là un artifice, je crois au contraire que c'est l'expression même de la réalité qui va se creusant, se découvrant de plus en plus profonde". (Préface au Portrait d'un juif, p. 21).
Tous les romans memmiens interfèrent, se recoupent ici et là, reconduisent les mêmes personnages, retentissent des mêmes interrogations, des mêmes phrases, ils représentent une oeuvre ouverte,en suspens, toujours à compléter, toujours en quête d'une réponse et d'une autre version, toujours sous-tendue par le doute et le désir de mieux se connaître, de mieux voir en soi : "J'entrevois maintenant seulement que toute mon oeuvre publiée n'est que l'incessant commentaire d'une oeuvre à venir, avec l'espoir insensé que ce commentaire puisse finir par constituer lui-même cette oeuvre". (Le Scorpion, p. 238). L'oeuvre est ainsi définie comme prenant racine dans la redite, elle est tautologique et tout en elle est "développement d'un même texte" (Le Scorpion, p. 127) toujours plus approfondi, corrigé, remanié c'est ainsi que "de commentaire en commentaire" (ibid), l'oeuvre, par sa forme aussi, concrétisera cette tendance à "l'exploration des limites" (ibid, p.236) tant recherchée par A. Memmi.
C'est dans ce sens-là que l'orientalisme de Memmi, sa judéïté, sa tunisianité ne constituent jamais dans son oeuvre le signe d'un parti-pris définitif, la manifestation d'un enfermement limitatif et d'un désir d'exclusion, ils sont aussi l'aboutissement d'une exploration des limites, celles de l'universalisme. C'est en se fondant totalement dans l'universel que l'écrivain redécouvre ses racines et les raffermit. C'est au nom des valeurs universelles qu'il commence par se révolter contre les "obscures croyances" des "continents primitifs "(La Statue de Sel, pp. 180-181), les "manques et [les] retards" (Agar, p. 177), l'irrationnel, et c'est aussi au nom de ces valeurs qu'il aboutit à repenser son passé, qu'il finit par revendiquer sa différence. Ses multiples "voyages", son nomadisme intellectuel sont tissés d'un universalisme têtu qui s'obstine à dire qu'on peut adhérer à l'universel et être profondément ancré dans son propre terroir.
Etre d'un peuple et de tous
Produit d'une triple culture, Memmi est en effet épris d'humanisme et son oeuvre, à travers ses divers personnages, ne cesse de rêver à une conciliation possible entre l'ancrage culturel et les préoccupations et valeurs universelles. La dédicace du Mirliton du Ciel, "A Jean Amrouche qui m'a fait découvrir El Ghazali, Rimbaud, Milosz et Saâdi" (p.7) constitue en ce sens la parfaite illustration de ce voeu. Memmi revendique l'hybridité intellectuelle, cette richesse qui le fait fondre dans l'universel. Le narrateur d'Agar professe une identité qui fait fi de toutes les limites ethniques au profit d'une éthique du métissage selon laquelle le meilleur de l'être composite qu'il est est "le plus libre, le plus universel" (p. 169). Ce n'est pas par hasard que l'on retrouve à travers l'oeuvre de Memmi ce rêve d'écrire une "Bible des temps modernes" (Le Pharaon, p.14), une "Bible nouvelle" (ibid, p. 372), un livre dont la seule sacralité serait le mérite de réunir pieusement les sagesses appartenant aux divers peuples, de présenter en un ouvrage unique "le quintessence" de l'esprit humain à travers les siècles.
La laïcité, par exemple, une des idées- forces de l'oeuvre de Memmi, n'est-elle pas d'ailleurs un pendant de l'universalité, une de ses voies royales? Le refus d'une des plus illusoires des spécificités, la spécificité religieuse, s'inscrit dans le cadre de cet humanisme universel: "Nous séparerons le religieux et le laïque, nous démasquerons cette confusion, nous imposerons..." (Agar, p. 160). C'est par le refus du poids de la religion, de ses avancées insidieuses et rampantes, ses glissements et les égarements qu'elle ne peut manquer de susciter que s'explique peut-être aussi son départ en France. La France qui avait cet attrait du pays laïc, "de liberté et de démocratie, dont parlent avec emphase les manuels scolaires de la troisième république" (Le Pharaon, p. 374), devait normalement garantir la liberté du verbe et de la différence.
C'est dans son douloureux effort d'universalisme, de connaissance du monde et des horizons autres, que l'écrivain voit le mieux l'impossibilité de rompre les amarres avec son passé, de rester indifférent à ses attaches. Se heurtant aux limites de l'humanisme universaliste, il découvre l'impossibilité de la neutralité et, curieusement, l'expérience de l'ouverture totale le ramène droit à ses origines : dans la tradition familiale et dans le terroir de ses racines, il retrouve une sorte de sécurité, une sagesse pas aussi rétrograde qu'il l'avait pensé auparavent :"Gardant les yeux fixés sur l'horizon des autres, il avait vécu en absent chez lui, et s'était ainsi ignoré lui-même. Fallait-il qu'il eût atteint son âge pour se décider enfin à se demander qui il était, qui étaient les siens et quelle était sa place parmi eux" (Le Pharaon, p. 17). Vingt ans auparavant, c'est autre chose qu'on lisait dans Le Scorpion où il s'agissait d'"(...) avoir la conscience la plus aigüe de soi-même et de sa place dans le monde." (p. 215). En deux décades d'exil, l'inquiétude sur la place de l'individu dans l'ordre de l'universel se transmue en inquiétude sur ses rapports à ses racines. Tout se passe comme si plus on se fondait dans l'universel, plus on s'attachait à son "royaume du dedans". Dans Le Scorpion déjà, le rôle central joué dans le récit par l'oncle Makhlouf n'était pas sans rapport avec l'obsession du rapport à la culture d'origine et aux siens : il est le doyen, le sage qui incarne la perspicacité et l'équilibre par son enracinement dans sa propre culture et sa judéïté. Dans Le Désert et à travers le prince El Mammi à la recherche de son royaume perdu, Memmi affirme, selon l'expression de J. Arnaud, son " arabo-berbérité" et son attachement à l'image d'un autre prince, prince de la culture arabe et qui est le philosophe, sociologue et savant tunisien le plus universellement reconnu : Ibn Khaldoun. Même dans La Statue de Sel, roman des grandes révoltes et des grandes exigences de rationalité et d'universalité, les penchants profonds et les nostalgies des fins de parcours se dessinent et s'annoncent clairement : "Ai-je vraiment échappé, arriverai-je jamais à échapper à ces tumultes, à ces rythmes qui vivent au fond de moi, qui maîtrisent aussitôt la cadence de mon sang? Après quinze ans de culture occidentale, dix ans de refus conscient de l'Afrique, peut-être faut-il que j'accepte cette évidence : ces vieilles mesures monocordes me bouleversent davantage que les grandes musiques de l'Europe" (p. 184).
La mort, "dernière sagesse ou suprême illusion"
L'oeuvre, miroir de l'individu, de ses hésitations, de ses nostalgies et de ses fantasmes, est traversée par l'idée et l'image de la mort de bout en bout. Incarnant le caractère fatal qui est au coeur de toute entreprise humaine, celle-ci ne semble pas intéresser Memmi en tant que négation de l'être mais en tant que concrétisation de l'aboutissement des choses et moment suprême d'un parcours. Dans le récit autobiographique, la mort apparaît comme le point extrême d'une ascension avant la chute ; si elle fascine, c'est parce qu'elle correspond à l' "exploration des limites", puisqu'elle est l'ultime étape de tout itinéraire. Dans La Statue de Sel déjà, la mort est une ascèse, la pétrification dans un moment de connaissance suprême. Elle préside à l'oeuvre, l'introduit, la coiffe comme un signe distinctif. Le désert de Memmi n'est autre que cette image paradoxale de la coexistence de la capitulation et de l'espoir, de l'exil et de l'acomplissement,de la mort et de la vie que l'incarnation de leur télescopage, de leur interférence, car dans ses stériles étendues, son retranchement silencieux, il incarne l'ardeur souterraine, le bouillonnement caché de la vie, la libération des êtres. Dans les textes de Memmi, "la mort est toujours là" (Le Désert, p. 224), elle arrache sa place, s'impose dans le récit et les images. Elle est ce pôle vers lequel le narrateur glisse fatalement : "Voilà que je parle de la mort et je vois bien quelle place je lui aurai faite dans ce récit". (Le Désert, p. 224).
"La mort est dans l'homme comme le ver dans le fruit", nous enseigne Le Scorpion (p. 213), ce roman où le lecteur se voit cerné par les différents récits de la mort, feinte ou avérée, d'un scorpion en proie aux flammes. Le Désert met l'accent sur cette spirale des grandeurs et déclins des nations mémorables, sur cette fatalité de la mort qui frappe au coeur même du vertige de la vie : "Les peuples croient voler de triomphe en triomphe, alors qu'il vont d'étape en étape jusqu'au néant. Et c'est au moment où ils atteignent le sommet de la gloire qu'ils commencent leur descente au tombeau. De sorte que, comme au spectacle, on peut toujours se demander à qui le tour maintenant de croire triompher ? à qui le tour de commencer à mourir? car le seul triomphe définitif est celui de la mort"(p. 188).
Mort et vie se confondent et forment une seule et unique obsession. La mort, moment de contraction unique de l'absolu, fait cesser brutalement la vie et dénonce ce qu'elle a de relatif et d'inaccompli. Embrasement de l'être, figement suprême, la seule perfection possible serait-elle inhérente au non-être? "L'homme parfait est comme mort", nous apprend Le Scorpion (p. 68). Le personnage même du pharaon dans sa glorieuse grandeur est celui qui n'est plus parmi les hommes sans cesser de se manifester par le monument qu'il a élevé, c'est la mort et l'absence confrontées à la force titanesque de l'homme, c 'est l'absent toujours présent, qui continue à faire partie d'un monde qu'il a déjà quitté. Une des figures de l'obsession du retour, le pharaon est l'image de la momie et du mort-vivant, mais aussi celle du passé lointain qui vient s'incarner dans la sagesse des vieillards à qui la vie et l'approche de la mort ont révélé bien des vérités : entre autres que l'apprentissage de la vie est aussi un apprentissage de la mort, une manière de la préparer, de l'attendre et,qui sait ?, de la dépasser, de la vaincre. Le narrateur du Désert ne s'interroge t-il pas, perplexe. "O Younous, (...) m'as-tu appris à vivre ou m'as-tu préparé à mourir? Est-ce là ton secret?" (p. 225). Se préparer à mourir, n'est-ce pas prendre aussi de plus en plus conscience de la relativité des choses, de leur vanité même. N'est-ce pas de cette "sagesse" de fin de parcours que relève cette modération tant remarquée dans l'oeuvre tardive de Memmi?
De La Statue de Sel au Pharaon, on observe nettement que Memmi passe du cri au chuchotement, de l'impétuosité volcanique à la sagesse tranquille, de l'ironie mordante à l'humour tendre, de la révolte au lyrisme, à la rêverie douce. De même, dans les derniers romans, la colère s'estompe et la révolte s'atténue, le style se dépouille, devient plus sobre, moins tranchant. L'expression y devient plus allusive, plus condensée car plus allégorique et plus distanciée, plus fantaisiste et moins aigre en même temps. Avec la maturité et l'approche de la vieillesse, l'écrivain mesure les excès et les injustices de certaines révoltes et le caractère pernicieux de bien des enthousiasmes. De la griserie aux désenchantements, la voie est désormais libre pour les sages concessions et les généreuses lucidités : le petit Marcel cède la place à l'oncle Makhlouf, l'impétueux Mordekhaï à l'imperturbable - et pourtant perturbé-Pharaon.*
Pointe extrême de la vie et moment d'illumination finale et de vision suprême, désir endémique de retour au bercail ("(...) je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans ma terre natale"( Le Désert, p. 225)), la mort est aussi la figure circulaire du réensourcement après la dispersion, la boucle qui permet de rejoindre les racines, de revenir au point de départ, figure où coïncident l'aspiration à la paix finale et le renouement avec le sol natal. Ce renouement est nettement visible dans Le Mirliton du Ciel où Memmi fait la part belle aux "vérités du coeur", dépassant le cartésianisme cassant de La Statue de Sel au profit d'un lyrisme nostalgique, ondulant et conciliateur. Ainsi, le romancier à thèse, l'essayiste limpide et scrutateur, le polémiste sans haine et sans faiblesse, retrouve en même temps que la bienveillance et le repos, la beauté et la poésie.
"Essai de maîtrise du monde jamais achevé" (La Statue de Sel, p. 234), la littérature apparaît chez Memmi comme une entreprise urgente d'interrogation, de mise en ordre, de clarification, de prise de position, de justification, comme une solution aux problèmes existentiels : solitude, échec des solidarités, exil. "Pour m'alléger du poids du monde, nous dit le narrateur de La Statue de Sel, je le mis sur le papier" (p. 123). C'est aussi, à plusieurs reprises, la leçon du Scorpion qui proclame que, pour "un homme acculé au mur (...) les mots constituent la seule défense" (p. 66), "un pis-aller"(p.248) nécessaire.L'écrivain tente en quelque sorte "une intégration par l'imaginaire" (p.266), une restitution par l'écriture de ce qui lui échappe: "Qu'ai-je fait jusqu'ici ! Ai-je même vécu? Par quelle aberration en suis-je arrivé, comme les pharaons, à considérer ma vie réelle comme un matériau négligeable pour l'élaboration d'une illusion d'éternité? Pour quelques feuillets que l'on trouverait après ma mort !" (Le Pharaon, p. 149). "Au-delà des démolitions" pour reprendre l'expression de La libération du Juif, il espère continuer le récit et élaborer un édifice, une pyramide de mots. A défaut d'être le roi de l'histoire, il se voit confier la tâche d'être "l'historiographe" du roi (Le Désert, p. 242 ; Le Pharaon p. 336). Pour compenser la perte d'un "royaume", il en bâtit un avec les mots et les rêves.
L'oeuvre, chez Memmi, serait-elle, comme dans Le Scorpion, "une entreprise de santé" (p. 55; p. 164) ou, comme dans La Statue de Sel, une façon de "se débarrasse[r] de sa bouillie de chat, [de] vomi[r] ce qu'[il] ne peu[t] digérer par l'oubli" (p. 120) ou encore une simple tricherie, un "tour de passe-passe"(Le Scorpion, p. 13) comme un autre? Dans le même roman qui est sans doute l'oeuvre où il a le mieux réfléchi sur son art, il s'interroge : "Si un écrivain essayait de dire tout, dans un seul livre, ce livre serait-il celui de sa guérison, de sa réconciliation avec lui-même et les autres, avec la vie, ou cet effort lui sera- t-il funeste? Insupportable aux autres et à lui-même?" (p. 65). La réponse, Memmi ne semble pas la connaître avec certitude. D'une lucidité extrême, cet écrivain ne se donne jamais de réponse définitive et sécurisante, il se meut dans le doute et l'interrogation sur la réalité ou le caractère illusoire de tout ce qu'il perçoit ou croit comprendre.
Son oeuvre, de bout en bout, appelle à ce qu'on ne l'enferme ni ne s'enferme dans le parti-pris, nous met en garde contre l'injustice que contient tout jugement idéologique de circonstance. Il est temps donc que l'écran des vieilles rancoeurs et des accusations mutuelles s'écroule pour permettre une lecture plus sereine et plus libérée de l'oeuvre, une lecture où rien d'autre ne s'interposerait entre elle et son lecteur que la sympathie et la complicité retrouvée.
Afifa MARZOUKI
(Extrait de « La littérature maghrébine de langue française », Ouvrage collectif, sous la direction de Charles BONN, Naget KHADDA & Abdallah MDARHRI-ALAOUI, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996).
References :
[1] Elbaz Robert : "Stratégies narratrices dans le roman maghrébin", Présence Francophone, n° 30, 1987, p. 95.
[2] Recherches sur la littérature maghrébine de langue française, Paris, l'Harmattan,1982,p.383.
[3] J .Arnaud. op. cit. p. 387.
[4] Voir en particulier les dernières pages du Scorpion.
[5] Le Scorpion , p. 14.
[6] Cf. Jacqueline Arnaud, Recherches sur la littérature maghrébine, pp. 363 et sq.
[7] Voir par exemple Portrait d'un juif, p. 252: "(...) j'ai aidé mes concitoyens tunisiens comme j'ai pu, à ma manière. Mais jamais - pourquoi ne pas le dire? - je ne me suis senti réellement et complètement adopté par eux : et ne me sentant pas complètement adopté, peut-être ne me suis-je pas conduit tout à fait comme l'un d'eux. "
[8] Voir E. Bénaïm-Ouaknine et R. Elbaz : "Albert Memmi ou le cul-de-sac et l'écriture", Présence francophone, n° 21, pp. 9 -10 et J. Arnaud, op. cit. p. 373
[9] Op. cit. p. 11.
LU SUR ADRA
[www.harissa.com]
[www.harissa.com]
[livres.lexpress.fr]
Qu'il y ait eu départ ou pas, scission ou pas, le son de cloche est toujours le même, l'oeuvre répercute le même écho, ce même "attachement viscéral" à la patrie d'origine qu'évoque Le Scorpion (p. 95). "Il s'agit en somme d'une longue entreprise, d'un seul livre constitué par un emboîtement de livres l'un dans l'autre. J'aime assez cette façon de mettre une oeuvre dans une autre et une troisième dans une seconde... Ce n'est pas là un artifice, je crois au contraire que c'est l'expression même de la réalité qui va se creusant, se découvrant de plus en plus profonde". (Préface au Portrait d'un juif, p. 21).
Tous les romans memmiens interfèrent, se recoupent ici et là, reconduisent les mêmes personnages, retentissent des mêmes interrogations, des mêmes phrases, ils représentent une oeuvre ouverte,en suspens, toujours à compléter, toujours en quête d'une réponse et d'une autre version, toujours sous-tendue par le doute et le désir de mieux se connaître, de mieux voir en soi : "J'entrevois maintenant seulement que toute mon oeuvre publiée n'est que l'incessant commentaire d'une oeuvre à venir, avec l'espoir insensé que ce commentaire puisse finir par constituer lui-même cette oeuvre". (Le Scorpion, p. 238). L'oeuvre est ainsi définie comme prenant racine dans la redite, elle est tautologique et tout en elle est "développement d'un même texte" (Le Scorpion, p. 127) toujours plus approfondi, corrigé, remanié c'est ainsi que "de commentaire en commentaire" (ibid), l'oeuvre, par sa forme aussi, concrétisera cette tendance à "l'exploration des limites" (ibid, p.236) tant recherchée par A. Memmi.
C'est dans ce sens-là que l'orientalisme de Memmi, sa judéïté, sa tunisianité ne constituent jamais dans son oeuvre le signe d'un parti-pris définitif, la manifestation d'un enfermement limitatif et d'un désir d'exclusion, ils sont aussi l'aboutissement d'une exploration des limites, celles de l'universalisme. C'est en se fondant totalement dans l'universel que l'écrivain redécouvre ses racines et les raffermit. C'est au nom des valeurs universelles qu'il commence par se révolter contre les "obscures croyances" des "continents primitifs "(La Statue de Sel, pp. 180-181), les "manques et [les] retards" (Agar, p. 177), l'irrationnel, et c'est aussi au nom de ces valeurs qu'il aboutit à repenser son passé, qu'il finit par revendiquer sa différence. Ses multiples "voyages", son nomadisme intellectuel sont tissés d'un universalisme têtu qui s'obstine à dire qu'on peut adhérer à l'universel et être profondément ancré dans son propre terroir.
Etre d'un peuple et de tous
Produit d'une triple culture, Memmi est en effet épris d'humanisme et son oeuvre, à travers ses divers personnages, ne cesse de rêver à une conciliation possible entre l'ancrage culturel et les préoccupations et valeurs universelles. La dédicace du Mirliton du Ciel, "A Jean Amrouche qui m'a fait découvrir El Ghazali, Rimbaud, Milosz et Saâdi" (p.7) constitue en ce sens la parfaite illustration de ce voeu. Memmi revendique l'hybridité intellectuelle, cette richesse qui le fait fondre dans l'universel. Le narrateur d'Agar professe une identité qui fait fi de toutes les limites ethniques au profit d'une éthique du métissage selon laquelle le meilleur de l'être composite qu'il est est "le plus libre, le plus universel" (p. 169). Ce n'est pas par hasard que l'on retrouve à travers l'oeuvre de Memmi ce rêve d'écrire une "Bible des temps modernes" (Le Pharaon, p.14), une "Bible nouvelle" (ibid, p. 372), un livre dont la seule sacralité serait le mérite de réunir pieusement les sagesses appartenant aux divers peuples, de présenter en un ouvrage unique "le quintessence" de l'esprit humain à travers les siècles.
La laïcité, par exemple, une des idées- forces de l'oeuvre de Memmi, n'est-elle pas d'ailleurs un pendant de l'universalité, une de ses voies royales? Le refus d'une des plus illusoires des spécificités, la spécificité religieuse, s'inscrit dans le cadre de cet humanisme universel: "Nous séparerons le religieux et le laïque, nous démasquerons cette confusion, nous imposerons..." (Agar, p. 160). C'est par le refus du poids de la religion, de ses avancées insidieuses et rampantes, ses glissements et les égarements qu'elle ne peut manquer de susciter que s'explique peut-être aussi son départ en France. La France qui avait cet attrait du pays laïc, "de liberté et de démocratie, dont parlent avec emphase les manuels scolaires de la troisième république" (Le Pharaon, p. 374), devait normalement garantir la liberté du verbe et de la différence.
C'est dans son douloureux effort d'universalisme, de connaissance du monde et des horizons autres, que l'écrivain voit le mieux l'impossibilité de rompre les amarres avec son passé, de rester indifférent à ses attaches. Se heurtant aux limites de l'humanisme universaliste, il découvre l'impossibilité de la neutralité et, curieusement, l'expérience de l'ouverture totale le ramène droit à ses origines : dans la tradition familiale et dans le terroir de ses racines, il retrouve une sorte de sécurité, une sagesse pas aussi rétrograde qu'il l'avait pensé auparavent :"Gardant les yeux fixés sur l'horizon des autres, il avait vécu en absent chez lui, et s'était ainsi ignoré lui-même. Fallait-il qu'il eût atteint son âge pour se décider enfin à se demander qui il était, qui étaient les siens et quelle était sa place parmi eux" (Le Pharaon, p. 17). Vingt ans auparavant, c'est autre chose qu'on lisait dans Le Scorpion où il s'agissait d'"(...) avoir la conscience la plus aigüe de soi-même et de sa place dans le monde." (p. 215). En deux décades d'exil, l'inquiétude sur la place de l'individu dans l'ordre de l'universel se transmue en inquiétude sur ses rapports à ses racines. Tout se passe comme si plus on se fondait dans l'universel, plus on s'attachait à son "royaume du dedans". Dans Le Scorpion déjà, le rôle central joué dans le récit par l'oncle Makhlouf n'était pas sans rapport avec l'obsession du rapport à la culture d'origine et aux siens : il est le doyen, le sage qui incarne la perspicacité et l'équilibre par son enracinement dans sa propre culture et sa judéïté. Dans Le Désert et à travers le prince El Mammi à la recherche de son royaume perdu, Memmi affirme, selon l'expression de J. Arnaud, son " arabo-berbérité" et son attachement à l'image d'un autre prince, prince de la culture arabe et qui est le philosophe, sociologue et savant tunisien le plus universellement reconnu : Ibn Khaldoun. Même dans La Statue de Sel, roman des grandes révoltes et des grandes exigences de rationalité et d'universalité, les penchants profonds et les nostalgies des fins de parcours se dessinent et s'annoncent clairement : "Ai-je vraiment échappé, arriverai-je jamais à échapper à ces tumultes, à ces rythmes qui vivent au fond de moi, qui maîtrisent aussitôt la cadence de mon sang? Après quinze ans de culture occidentale, dix ans de refus conscient de l'Afrique, peut-être faut-il que j'accepte cette évidence : ces vieilles mesures monocordes me bouleversent davantage que les grandes musiques de l'Europe" (p. 184).
La mort, "dernière sagesse ou suprême illusion"
L'oeuvre, miroir de l'individu, de ses hésitations, de ses nostalgies et de ses fantasmes, est traversée par l'idée et l'image de la mort de bout en bout. Incarnant le caractère fatal qui est au coeur de toute entreprise humaine, celle-ci ne semble pas intéresser Memmi en tant que négation de l'être mais en tant que concrétisation de l'aboutissement des choses et moment suprême d'un parcours. Dans le récit autobiographique, la mort apparaît comme le point extrême d'une ascension avant la chute ; si elle fascine, c'est parce qu'elle correspond à l' "exploration des limites", puisqu'elle est l'ultime étape de tout itinéraire. Dans La Statue de Sel déjà, la mort est une ascèse, la pétrification dans un moment de connaissance suprême. Elle préside à l'oeuvre, l'introduit, la coiffe comme un signe distinctif. Le désert de Memmi n'est autre que cette image paradoxale de la coexistence de la capitulation et de l'espoir, de l'exil et de l'acomplissement,de la mort et de la vie que l'incarnation de leur télescopage, de leur interférence, car dans ses stériles étendues, son retranchement silencieux, il incarne l'ardeur souterraine, le bouillonnement caché de la vie, la libération des êtres. Dans les textes de Memmi, "la mort est toujours là" (Le Désert, p. 224), elle arrache sa place, s'impose dans le récit et les images. Elle est ce pôle vers lequel le narrateur glisse fatalement : "Voilà que je parle de la mort et je vois bien quelle place je lui aurai faite dans ce récit". (Le Désert, p. 224).
"La mort est dans l'homme comme le ver dans le fruit", nous enseigne Le Scorpion (p. 213), ce roman où le lecteur se voit cerné par les différents récits de la mort, feinte ou avérée, d'un scorpion en proie aux flammes. Le Désert met l'accent sur cette spirale des grandeurs et déclins des nations mémorables, sur cette fatalité de la mort qui frappe au coeur même du vertige de la vie : "Les peuples croient voler de triomphe en triomphe, alors qu'il vont d'étape en étape jusqu'au néant. Et c'est au moment où ils atteignent le sommet de la gloire qu'ils commencent leur descente au tombeau. De sorte que, comme au spectacle, on peut toujours se demander à qui le tour maintenant de croire triompher ? à qui le tour de commencer à mourir? car le seul triomphe définitif est celui de la mort"(p. 188).
Mort et vie se confondent et forment une seule et unique obsession. La mort, moment de contraction unique de l'absolu, fait cesser brutalement la vie et dénonce ce qu'elle a de relatif et d'inaccompli. Embrasement de l'être, figement suprême, la seule perfection possible serait-elle inhérente au non-être? "L'homme parfait est comme mort", nous apprend Le Scorpion (p. 68). Le personnage même du pharaon dans sa glorieuse grandeur est celui qui n'est plus parmi les hommes sans cesser de se manifester par le monument qu'il a élevé, c'est la mort et l'absence confrontées à la force titanesque de l'homme, c 'est l'absent toujours présent, qui continue à faire partie d'un monde qu'il a déjà quitté. Une des figures de l'obsession du retour, le pharaon est l'image de la momie et du mort-vivant, mais aussi celle du passé lointain qui vient s'incarner dans la sagesse des vieillards à qui la vie et l'approche de la mort ont révélé bien des vérités : entre autres que l'apprentissage de la vie est aussi un apprentissage de la mort, une manière de la préparer, de l'attendre et,qui sait ?, de la dépasser, de la vaincre. Le narrateur du Désert ne s'interroge t-il pas, perplexe. "O Younous, (...) m'as-tu appris à vivre ou m'as-tu préparé à mourir? Est-ce là ton secret?" (p. 225). Se préparer à mourir, n'est-ce pas prendre aussi de plus en plus conscience de la relativité des choses, de leur vanité même. N'est-ce pas de cette "sagesse" de fin de parcours que relève cette modération tant remarquée dans l'oeuvre tardive de Memmi?
De La Statue de Sel au Pharaon, on observe nettement que Memmi passe du cri au chuchotement, de l'impétuosité volcanique à la sagesse tranquille, de l'ironie mordante à l'humour tendre, de la révolte au lyrisme, à la rêverie douce. De même, dans les derniers romans, la colère s'estompe et la révolte s'atténue, le style se dépouille, devient plus sobre, moins tranchant. L'expression y devient plus allusive, plus condensée car plus allégorique et plus distanciée, plus fantaisiste et moins aigre en même temps. Avec la maturité et l'approche de la vieillesse, l'écrivain mesure les excès et les injustices de certaines révoltes et le caractère pernicieux de bien des enthousiasmes. De la griserie aux désenchantements, la voie est désormais libre pour les sages concessions et les généreuses lucidités : le petit Marcel cède la place à l'oncle Makhlouf, l'impétueux Mordekhaï à l'imperturbable - et pourtant perturbé-Pharaon.*
Pointe extrême de la vie et moment d'illumination finale et de vision suprême, désir endémique de retour au bercail ("(...) je n'avais plus qu'un seul désir : être enfoui dans ma terre natale"( Le Désert, p. 225)), la mort est aussi la figure circulaire du réensourcement après la dispersion, la boucle qui permet de rejoindre les racines, de revenir au point de départ, figure où coïncident l'aspiration à la paix finale et le renouement avec le sol natal. Ce renouement est nettement visible dans Le Mirliton du Ciel où Memmi fait la part belle aux "vérités du coeur", dépassant le cartésianisme cassant de La Statue de Sel au profit d'un lyrisme nostalgique, ondulant et conciliateur. Ainsi, le romancier à thèse, l'essayiste limpide et scrutateur, le polémiste sans haine et sans faiblesse, retrouve en même temps que la bienveillance et le repos, la beauté et la poésie.
"Essai de maîtrise du monde jamais achevé" (La Statue de Sel, p. 234), la littérature apparaît chez Memmi comme une entreprise urgente d'interrogation, de mise en ordre, de clarification, de prise de position, de justification, comme une solution aux problèmes existentiels : solitude, échec des solidarités, exil. "Pour m'alléger du poids du monde, nous dit le narrateur de La Statue de Sel, je le mis sur le papier" (p. 123). C'est aussi, à plusieurs reprises, la leçon du Scorpion qui proclame que, pour "un homme acculé au mur (...) les mots constituent la seule défense" (p. 66), "un pis-aller"(p.248) nécessaire.L'écrivain tente en quelque sorte "une intégration par l'imaginaire" (p.266), une restitution par l'écriture de ce qui lui échappe: "Qu'ai-je fait jusqu'ici ! Ai-je même vécu? Par quelle aberration en suis-je arrivé, comme les pharaons, à considérer ma vie réelle comme un matériau négligeable pour l'élaboration d'une illusion d'éternité? Pour quelques feuillets que l'on trouverait après ma mort !" (Le Pharaon, p. 149). "Au-delà des démolitions" pour reprendre l'expression de La libération du Juif, il espère continuer le récit et élaborer un édifice, une pyramide de mots. A défaut d'être le roi de l'histoire, il se voit confier la tâche d'être "l'historiographe" du roi (Le Désert, p. 242 ; Le Pharaon p. 336). Pour compenser la perte d'un "royaume", il en bâtit un avec les mots et les rêves.
L'oeuvre, chez Memmi, serait-elle, comme dans Le Scorpion, "une entreprise de santé" (p. 55; p. 164) ou, comme dans La Statue de Sel, une façon de "se débarrasse[r] de sa bouillie de chat, [de] vomi[r] ce qu'[il] ne peu[t] digérer par l'oubli" (p. 120) ou encore une simple tricherie, un "tour de passe-passe"(Le Scorpion, p. 13) comme un autre? Dans le même roman qui est sans doute l'oeuvre où il a le mieux réfléchi sur son art, il s'interroge : "Si un écrivain essayait de dire tout, dans un seul livre, ce livre serait-il celui de sa guérison, de sa réconciliation avec lui-même et les autres, avec la vie, ou cet effort lui sera- t-il funeste? Insupportable aux autres et à lui-même?" (p. 65). La réponse, Memmi ne semble pas la connaître avec certitude. D'une lucidité extrême, cet écrivain ne se donne jamais de réponse définitive et sécurisante, il se meut dans le doute et l'interrogation sur la réalité ou le caractère illusoire de tout ce qu'il perçoit ou croit comprendre.
Son oeuvre, de bout en bout, appelle à ce qu'on ne l'enferme ni ne s'enferme dans le parti-pris, nous met en garde contre l'injustice que contient tout jugement idéologique de circonstance. Il est temps donc que l'écran des vieilles rancoeurs et des accusations mutuelles s'écroule pour permettre une lecture plus sereine et plus libérée de l'oeuvre, une lecture où rien d'autre ne s'interposerait entre elle et son lecteur que la sympathie et la complicité retrouvée.
Afifa MARZOUKI
(Extrait de « La littérature maghrébine de langue française », Ouvrage collectif, sous la direction de Charles BONN, Naget KHADDA & Abdallah MDARHRI-ALAOUI, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996).
References :
[1] Elbaz Robert : "Stratégies narratrices dans le roman maghrébin", Présence Francophone, n° 30, 1987, p. 95.
[2] Recherches sur la littérature maghrébine de langue française, Paris, l'Harmattan,1982,p.383.
[3] J .Arnaud. op. cit. p. 387.
[4] Voir en particulier les dernières pages du Scorpion.
[5] Le Scorpion , p. 14.
[6] Cf. Jacqueline Arnaud, Recherches sur la littérature maghrébine, pp. 363 et sq.
[7] Voir par exemple Portrait d'un juif, p. 252: "(...) j'ai aidé mes concitoyens tunisiens comme j'ai pu, à ma manière. Mais jamais - pourquoi ne pas le dire? - je ne me suis senti réellement et complètement adopté par eux : et ne me sentant pas complètement adopté, peut-être ne me suis-je pas conduit tout à fait comme l'un d'eux. "
[8] Voir E. Bénaïm-Ouaknine et R. Elbaz : "Albert Memmi ou le cul-de-sac et l'écriture", Présence francophone, n° 21, pp. 9 -10 et J. Arnaud, op. cit. p. 373
[9] Op. cit. p. 11.
LU SUR ADRA
[www.harissa.com]
[www.harissa.com]
[livres.lexpress.fr]
|
Albert Memmi - 4 17 septembre 2007, 08:22 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
LU SUR ADRA
Par Meyer le mardi 15 juin 2004 -:
Albert Memmi, marabout sans tribu - Par Catherine Simon - Pour LE MONDE - 15.06.04 -
A 84 ans, l'auteur du "Portrait du colonisé", juif tunisien, revient, près d'un demi-siècle plus tard, avec un "Portrait du décolonisé" et un verdict sévère sur la société arabo-musulmane.
On croirait un cliché de l'époque coloniale. C'en est un : trois femmes, trois sœurs, en costumes de bédouines, prennent la pose. Celle du milieu porte sur ses genoux une gargoulette en terre. La photo a été accrochée dans le cabinet de travail, en face du lit-divan. Elle n'est pas là pour faire joli. "Ma mère est celle du milieu. La plus belle des trois, non ? Elle était enceinte au moment de la photo. Elle a fait treize enfants au total - dont seulement huit ont survécu", commente Albert Memmi. Une photo "pour me rappeler d'où je viens", ajoute ce natif des quartiers pauvres de Tunis, ce juif arabe passionné de Montaigne, fils d'un bourrelier illettré et d'une Berbère analphabète, devenu écrivain célèbre et, ce qui ne gâche rien, objet d'infinies controverses, même à 83 ans.
Dans son "grenier" de la rue Saint-Merri, à Paris, dans le 4e arrondissement, ce refuge sous les combles tout habillé de livres où il reçoit ses visiteurs et travaille chaque jour, il y a d'autres images : un Bouddha aux yeux mi-clos, un cloître, quelques dessins aussi, une pièce de monnaie romaine de la province de Byzacène (l'actuelle région de Sousse, en Tunisie), frappée du nom de Memmi, "famille consulaire". Ici et là, des chapelets pendent du plafond, "non pas pour la prière, mais afin qu'on évite de se cogner aux poutres", précise le locataire de sa voix égale, légèrement métallique.
L'appartement est situé au deuxième étage. L'écrivain et son épouse Germania, dite Germaine, Lorraine et catholique d'origine, agrégée d'allemand et peintre amateur, y ont posé leurs valises à la fin des années 1950. Ils n'en ont jamais déménagé. Dans le couloir d'entrée, le mur est couvert de photos prises lors de cérémonies d'hommage ou de remise de prix. Albert Memmi en a eu beaucoup : son œuvre a été traduite en plus de vingt langues et "environ soixante-dix ouvrages ou thèses" lui ont été consacrés.
Né le 15 décembre 1920, celui qui s'est lui-même baptisé "le nomade immobile" (titre d'un de ses nombreux livres, publié en 2000 aux éditions Arléa) s'est souvent amusé au jeu des origines, qui est, à lui seul, une invite au voyage et à la quête de soi. "Memmi serait un antique patronyme kabyle, qui signifie "le petit homme" ou, autre hypothèse, le vocatif de Memmius, membre de la gens romaine Memmia."
Mais est-ce seulement un jeu ? "Voici un écrivain français de Tunisie qui n'est ni français ni tunisien. C'est à peine s'il est juif puisque, dans un sens, il ne veut pas l'être", avait noté Albert Camus, dans sa préface au premier roman de Memmi, La Statue de sel, paru en 1953 (Corréa) et plusieurs fois réédité (Gallimard). "J'étais une sorte de métis de la colonisation, qui comprenait tout le monde, parce qu'il n'était totalement de personne", confirme Albert Memmi lui-même, quelques années plus tard, dans la présentation de son essai majeur, Le Portrait du colonisé (précédé du Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, éditions Corréa, 1957, plus tard réédité par Pauvert et Gallimard). Fuyant la tyrannie du groupe - qu'il soit partisan, religieux, national ou ethnique -, fuyant aussi la malédiction d'être pauvre, l'obscurité des dominés, ce réfractaire impénitent n'a pourtant pas rompu avec ses "appartenances multiples", qu'elles soient de naissance ou acquises. Du moins, pas tout à fait. S'il a largué quelque chose, c'est seulement les amarres.
Sa première fugue est celle de la langue. "Je ne pouvais pas m'exprimer profondément et rigoureusement dans la langue de ma mère, qui n'a jamais parlé qu'en patois tunisois", souligne-t-il, évoquant l'arabe dialectal, qui est alors le lot exclusif de la majorité des "indigènes", selon l'expression de l'époque. "La langue française était pour moi la seule issue - je me suis construit à travers elle", ajoute l'ancien élève du lycée Carnot de Tunis, qui fait l'apprentissage du français comme on se jette à l'eau. "Il fallait que je nage. C'était du quitte ou double !", s'exclame-t-il aujourd'hui, presque douloureusement. Le prix à payer pour ce premier arrachement a été lourd - sans doute bien plus qu'il ne l'avoue.
Self-made-man acharné et presque masochiste, cet admirateur de la "belle Université française"- où il finira par se faire intégrer dans les années 1960 - ne supporte pas qu'on la moque. Railler l'Université n'est-ce pas le railler lui, le fils de pauvre, l'immigré méritant ? Les "pseudorévolutionnaires de Mai 68" le mettent en rage. Lui qui a eu "tant de mal à -se- dépêtrer de l'emprise familiale", le voilà contraint de subir le joug de l'utopie, ce "placebo de la pensée". Les manifestations du Quartier latin lui rappellent les monômes, "ces divertissements d'enfants de la bourgeoisie qui rentraient ensuite dîner chez leurs parents". Il n'en démordra pas. De Tunis à Paris, le verdict est le même : "La séparation des classes est aussi profonde que celle des religions, et je n'étais pas des leurs." A ce constat, se mêlent, il l'écrit lui-même, "l'envie amère, l'aigre rancœur et le ressentiment" contre ceux qu'il appelle "les riches"... Vieille histoire ! "A l'image de la ville, le lycée était d'une diversité dépaysante. J'eus des camarades français, tunisiens, italiens, russes, maltais, et juifs aussi, mais d'un milieu si différent du mien qu'ils m'étaient des étrangers", raconte Albert Memmi dans La Statue de sel, récit de sa "jeunesse amère", selon le mot de Sartre, portrait d'une Tunisie cosmopolite aujourd'hui disparue.
"Autofiction avant la lettre", ce coup d'essai fit l'effet, à Tunis, au sein de la communauté juive, d'un "coup de tonnerre", se souvient une ex-Tunisoise, l'universitaire Annie Goldman, amie de l'écrivain. "Les gens étaient à la fois fiers et choqués. C'était la première fois que quelqu'un de Tunis, juif, en plus, était publié à Paris, explique-t-elle. Mais c'était aussi la première fois qu'on décrivait la pauvreté - sans parler de certains personnages du livre, très facilement reconnaissables..."
Quelques décennies plus tard, dans les années 1995, quand ce classique de la littérature maghrébine francophone est mis au programme de l'Institut supérieur des langues de Tunis, "l'immense majorité de mes étudiants ignoraient le nom d'Albert Memmi", rappelle Rabaa Abdelkefi, maître-assistante au département de français de l'Institut. "En lisant La Statue de sel, ils ont découvert qu'il y avait eu un ghetto juif - et même, pour certains, qu'une communauté juive avait existé. Ce qui les a le plus surpris, c'est de réaliser que des juifs tunisiens pouvaient avoir eu l'arabe comme langue maternelle. Et qu'on pouvait être juif et pauvre !", souligne l'universitaire. Il est vrai que les temps ont changé : forte de quelque 150 000 membres en 1945, la communauté juive de Tunisie a décliné jusqu'à ne plus compter aujourd'hui qu'un peu moins de 1 000 personnes. Parmi les étudiants de Rabaa Abdelkefi, "la plupart ont réagi avec sympathie", en découvrant La Statue de sel. Une infime minorité - "deux, je crois, pas plus" sur quelque 400 étudiants - ont refusé d'ouvrir le livre de Memmi, "parce qu'il était juif". Un deuxième récit romancé, Agar (Corréa, 1955, réédité par Gallimard), sur le naufrage d'un couple mixte, fait lui aussi événement. Plusieurs autres romans suivront. "Moi, je commence par le vécu et je théorise ensuite, cela a toujours été ma méthode", explique l'écrivain, qui tient son journal depuis l'âge de 15 ans. Mais, s'ils disent beaucoup de lui, ses livres, heureusement, ne racontent pas tout. A la fin de La Statue de sel, le héros, qui a connu les camps de travail créés en Tunisie pendant la brève occupation nazie, s'embarque à la Libération pour l'Argentine. Dans la réalité, c'est à Alger, où il entame ses études, que le jeune Memmi s'installe en 1944. Un an plus tard, le voilà à Paris, inscrit à la Sorbonne, promis à un avenir d'éminent philosophe. Mais il déchante. "J'arrivais d'une Afrique du Nord en pleine tourmente, j'étais sans le sou, j'avais faim, et je tombe sur quoi ? Le jeu transcendantal chez Kant ! Moi qui avais tout misé sur la philosophie, ça m'a semblé du bavardage."
C'est pourtant au cours de ce premier séjour "désastreux" au pays de Voltaire qu'il rencontre sa future épouse, étudiante comme lui. Elle est aussi blonde qu'il est brun ; elle a les yeux bleus, il les a noirs, mais tous deux sont à la fois épris de savoir et en rupture de ban avec leurs familles. Ils se marient en décembre 1949, avant de prendre le bateau pour Tunis. Un peu comme dans Agar, à l'exception de la fin : alors que le roman s'achève sur une séparation, l'histoire vraie d'Albert et Germaine Memmi est une histoire qui dure - en dépit des "secousses", selon son mot à lui.
L'un et l'autre enseignent à Tunis, où ils restent sept ans. C'est là que naissent leurs deux premiers enfants. Ecrivain "engagé, mais jamais militant", le jeune professeur participe aux débats organisés chaque dimanche, après la projection d'un film, au cinéma Le Paris. C'est à Tunis, aussi, qu'il s'engage dans le lancement de l'hebdomadaire Afrique-Action, ancêtre de Jeune Afrique. En 1956, année de l'indépendance, il quitte cette terre, ce "terreau affectif", qui baigne son œuvre et sa vie. "Mon rôle était fini, le pays allait vers l'indépendance", explique-t-il. "La Tunisie allait devenir une jeune nation et je savais que cette nation serait arabo-musulmane : les minoritaires comme moi n'y auraient pas de place", précise-t-il. Albert Memmi n'a pourtant rien d'un fataliste. Simplement, cet "ultravoltairien", comme il aime à se définir, n'a "jamais confondu le constat et le vœu".
Avec son Portrait du colonisé, publié en pleine guerre d'Algérie, son nom franchit les frontières. Salué par les partisans des indépendances, ce livre est décrié par ceux, alors nombreux, favorables au maintien plus ou moins aménagé de l'ordre colonial. L'ouvrage sera également pris pour cible, quelques années plus tard, par des étudiants maghrébins, nationalistes arabo-musulmans. "Ils refusaient à Memmi, accusé de sionisme, le droit d'être considéré comme un ex-colonisé", rapporte l'universitaire Juliette Bessis, qui enseignait l'histoire à l'université de Vincennes (Paris-VIII) dans les années 1970.
Dans le Portrait du colonisé, comme dans sa suite, le tout nouveau Portrait du décolonisé (Gallimard, 2004), il s'agit, indique l'auteur, d'une "description ordonnée" de son sujet - non d'un pamphlet. Dans le premier portrait, Memmi prévenait : "Pour vivre, le colonisé a besoin de supprimer la colonisation. Mais pour devenir un homme, il doit supprimer le colonisé qu'il est devenu", cet "être d'oppression et de carences". S'il veut parvenir à ce résultat, il faut que le colonisé "se conquière libre vis-à-vis de la religion de son groupe" et qu'il cesse "de n'exister que par elle". De même qu'il doit se rendre libre vis-à-vis de la "nation", de la "tradition" ou de l'"ethnicité". Dans cet essai prémonitoire était dénoncée, déjà, la "fameuse et absurde opposition Orient-Occident", cette "antithèse durcie par le colonisateur", soucieux d'instaurer une "barrière définitive entre lui et le colonisé".
Près d'un demi-siècle plus tard, terrorisme islamique aidant, le bilan est amer. "La révolution n'a pas eu lieu", note-t-il, dénonçant les "fruits rabougris des indépendances", le fléau de la "corruption" et la "démission des élites". Particulièrement visée, la "société arabo-musulmane" est atteinte d'un "grave syndrome dépressif", insiste-t-il, égratignant au passage, de manière étonnamment violente, le nom de Leila Chahid, déléguée générale de la Palestine en France.
Parmi les lettres de réaction qu'Albert Memmi reçoit de ses lecteurs, "une bonne moitié m'approuve et regrette parfois que je n'aille pas plus loin, l'autre moitié m'accuse, comme d'habitude, de tous les maux de la Terre", assure-t-il, la moue philosophe. Accueilli avec chaleur sur les ondes de France-Culture comme sur celles de Beur-FM, pour évoquer Le Portrait du décolonisé, Albert Memmi a, en revanche, été "décommandé" par un animateur de Radio-Libertaire, lui reprochant ses positions "pas nettes" sur le conflit israëlo-palestinien. L'évadé solidaire du ghetto de Tunis n'en a cure.
Son prochain livre, dont la sortie est prévue à l'automne, sera un recueil de nouvelles. Il y parlera des femmes, du plaisir, de l'amour. Rien à voir avec son travail passé ? Tout, peut-être, au contraire... "Celui qui n'a pas fait ses comptes avec la féminité n'a pas fait ses comptes avec la nature, ni avec l'univers", assure le marabout de la rue Saint-Merri.
Pièces jointes:

Par Meyer le mardi 15 juin 2004 -:
Albert Memmi, marabout sans tribu - Par Catherine Simon - Pour LE MONDE - 15.06.04 -
A 84 ans, l'auteur du "Portrait du colonisé", juif tunisien, revient, près d'un demi-siècle plus tard, avec un "Portrait du décolonisé" et un verdict sévère sur la société arabo-musulmane.
On croirait un cliché de l'époque coloniale. C'en est un : trois femmes, trois sœurs, en costumes de bédouines, prennent la pose. Celle du milieu porte sur ses genoux une gargoulette en terre. La photo a été accrochée dans le cabinet de travail, en face du lit-divan. Elle n'est pas là pour faire joli. "Ma mère est celle du milieu. La plus belle des trois, non ? Elle était enceinte au moment de la photo. Elle a fait treize enfants au total - dont seulement huit ont survécu", commente Albert Memmi. Une photo "pour me rappeler d'où je viens", ajoute ce natif des quartiers pauvres de Tunis, ce juif arabe passionné de Montaigne, fils d'un bourrelier illettré et d'une Berbère analphabète, devenu écrivain célèbre et, ce qui ne gâche rien, objet d'infinies controverses, même à 83 ans.
Dans son "grenier" de la rue Saint-Merri, à Paris, dans le 4e arrondissement, ce refuge sous les combles tout habillé de livres où il reçoit ses visiteurs et travaille chaque jour, il y a d'autres images : un Bouddha aux yeux mi-clos, un cloître, quelques dessins aussi, une pièce de monnaie romaine de la province de Byzacène (l'actuelle région de Sousse, en Tunisie), frappée du nom de Memmi, "famille consulaire". Ici et là, des chapelets pendent du plafond, "non pas pour la prière, mais afin qu'on évite de se cogner aux poutres", précise le locataire de sa voix égale, légèrement métallique.
L'appartement est situé au deuxième étage. L'écrivain et son épouse Germania, dite Germaine, Lorraine et catholique d'origine, agrégée d'allemand et peintre amateur, y ont posé leurs valises à la fin des années 1950. Ils n'en ont jamais déménagé. Dans le couloir d'entrée, le mur est couvert de photos prises lors de cérémonies d'hommage ou de remise de prix. Albert Memmi en a eu beaucoup : son œuvre a été traduite en plus de vingt langues et "environ soixante-dix ouvrages ou thèses" lui ont été consacrés.
Né le 15 décembre 1920, celui qui s'est lui-même baptisé "le nomade immobile" (titre d'un de ses nombreux livres, publié en 2000 aux éditions Arléa) s'est souvent amusé au jeu des origines, qui est, à lui seul, une invite au voyage et à la quête de soi. "Memmi serait un antique patronyme kabyle, qui signifie "le petit homme" ou, autre hypothèse, le vocatif de Memmius, membre de la gens romaine Memmia."
Mais est-ce seulement un jeu ? "Voici un écrivain français de Tunisie qui n'est ni français ni tunisien. C'est à peine s'il est juif puisque, dans un sens, il ne veut pas l'être", avait noté Albert Camus, dans sa préface au premier roman de Memmi, La Statue de sel, paru en 1953 (Corréa) et plusieurs fois réédité (Gallimard). "J'étais une sorte de métis de la colonisation, qui comprenait tout le monde, parce qu'il n'était totalement de personne", confirme Albert Memmi lui-même, quelques années plus tard, dans la présentation de son essai majeur, Le Portrait du colonisé (précédé du Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, éditions Corréa, 1957, plus tard réédité par Pauvert et Gallimard). Fuyant la tyrannie du groupe - qu'il soit partisan, religieux, national ou ethnique -, fuyant aussi la malédiction d'être pauvre, l'obscurité des dominés, ce réfractaire impénitent n'a pourtant pas rompu avec ses "appartenances multiples", qu'elles soient de naissance ou acquises. Du moins, pas tout à fait. S'il a largué quelque chose, c'est seulement les amarres.
Sa première fugue est celle de la langue. "Je ne pouvais pas m'exprimer profondément et rigoureusement dans la langue de ma mère, qui n'a jamais parlé qu'en patois tunisois", souligne-t-il, évoquant l'arabe dialectal, qui est alors le lot exclusif de la majorité des "indigènes", selon l'expression de l'époque. "La langue française était pour moi la seule issue - je me suis construit à travers elle", ajoute l'ancien élève du lycée Carnot de Tunis, qui fait l'apprentissage du français comme on se jette à l'eau. "Il fallait que je nage. C'était du quitte ou double !", s'exclame-t-il aujourd'hui, presque douloureusement. Le prix à payer pour ce premier arrachement a été lourd - sans doute bien plus qu'il ne l'avoue.
Self-made-man acharné et presque masochiste, cet admirateur de la "belle Université française"- où il finira par se faire intégrer dans les années 1960 - ne supporte pas qu'on la moque. Railler l'Université n'est-ce pas le railler lui, le fils de pauvre, l'immigré méritant ? Les "pseudorévolutionnaires de Mai 68" le mettent en rage. Lui qui a eu "tant de mal à -se- dépêtrer de l'emprise familiale", le voilà contraint de subir le joug de l'utopie, ce "placebo de la pensée". Les manifestations du Quartier latin lui rappellent les monômes, "ces divertissements d'enfants de la bourgeoisie qui rentraient ensuite dîner chez leurs parents". Il n'en démordra pas. De Tunis à Paris, le verdict est le même : "La séparation des classes est aussi profonde que celle des religions, et je n'étais pas des leurs." A ce constat, se mêlent, il l'écrit lui-même, "l'envie amère, l'aigre rancœur et le ressentiment" contre ceux qu'il appelle "les riches"... Vieille histoire ! "A l'image de la ville, le lycée était d'une diversité dépaysante. J'eus des camarades français, tunisiens, italiens, russes, maltais, et juifs aussi, mais d'un milieu si différent du mien qu'ils m'étaient des étrangers", raconte Albert Memmi dans La Statue de sel, récit de sa "jeunesse amère", selon le mot de Sartre, portrait d'une Tunisie cosmopolite aujourd'hui disparue.
"Autofiction avant la lettre", ce coup d'essai fit l'effet, à Tunis, au sein de la communauté juive, d'un "coup de tonnerre", se souvient une ex-Tunisoise, l'universitaire Annie Goldman, amie de l'écrivain. "Les gens étaient à la fois fiers et choqués. C'était la première fois que quelqu'un de Tunis, juif, en plus, était publié à Paris, explique-t-elle. Mais c'était aussi la première fois qu'on décrivait la pauvreté - sans parler de certains personnages du livre, très facilement reconnaissables..."
Quelques décennies plus tard, dans les années 1995, quand ce classique de la littérature maghrébine francophone est mis au programme de l'Institut supérieur des langues de Tunis, "l'immense majorité de mes étudiants ignoraient le nom d'Albert Memmi", rappelle Rabaa Abdelkefi, maître-assistante au département de français de l'Institut. "En lisant La Statue de sel, ils ont découvert qu'il y avait eu un ghetto juif - et même, pour certains, qu'une communauté juive avait existé. Ce qui les a le plus surpris, c'est de réaliser que des juifs tunisiens pouvaient avoir eu l'arabe comme langue maternelle. Et qu'on pouvait être juif et pauvre !", souligne l'universitaire. Il est vrai que les temps ont changé : forte de quelque 150 000 membres en 1945, la communauté juive de Tunisie a décliné jusqu'à ne plus compter aujourd'hui qu'un peu moins de 1 000 personnes. Parmi les étudiants de Rabaa Abdelkefi, "la plupart ont réagi avec sympathie", en découvrant La Statue de sel. Une infime minorité - "deux, je crois, pas plus" sur quelque 400 étudiants - ont refusé d'ouvrir le livre de Memmi, "parce qu'il était juif". Un deuxième récit romancé, Agar (Corréa, 1955, réédité par Gallimard), sur le naufrage d'un couple mixte, fait lui aussi événement. Plusieurs autres romans suivront. "Moi, je commence par le vécu et je théorise ensuite, cela a toujours été ma méthode", explique l'écrivain, qui tient son journal depuis l'âge de 15 ans. Mais, s'ils disent beaucoup de lui, ses livres, heureusement, ne racontent pas tout. A la fin de La Statue de sel, le héros, qui a connu les camps de travail créés en Tunisie pendant la brève occupation nazie, s'embarque à la Libération pour l'Argentine. Dans la réalité, c'est à Alger, où il entame ses études, que le jeune Memmi s'installe en 1944. Un an plus tard, le voilà à Paris, inscrit à la Sorbonne, promis à un avenir d'éminent philosophe. Mais il déchante. "J'arrivais d'une Afrique du Nord en pleine tourmente, j'étais sans le sou, j'avais faim, et je tombe sur quoi ? Le jeu transcendantal chez Kant ! Moi qui avais tout misé sur la philosophie, ça m'a semblé du bavardage."
C'est pourtant au cours de ce premier séjour "désastreux" au pays de Voltaire qu'il rencontre sa future épouse, étudiante comme lui. Elle est aussi blonde qu'il est brun ; elle a les yeux bleus, il les a noirs, mais tous deux sont à la fois épris de savoir et en rupture de ban avec leurs familles. Ils se marient en décembre 1949, avant de prendre le bateau pour Tunis. Un peu comme dans Agar, à l'exception de la fin : alors que le roman s'achève sur une séparation, l'histoire vraie d'Albert et Germaine Memmi est une histoire qui dure - en dépit des "secousses", selon son mot à lui.
L'un et l'autre enseignent à Tunis, où ils restent sept ans. C'est là que naissent leurs deux premiers enfants. Ecrivain "engagé, mais jamais militant", le jeune professeur participe aux débats organisés chaque dimanche, après la projection d'un film, au cinéma Le Paris. C'est à Tunis, aussi, qu'il s'engage dans le lancement de l'hebdomadaire Afrique-Action, ancêtre de Jeune Afrique. En 1956, année de l'indépendance, il quitte cette terre, ce "terreau affectif", qui baigne son œuvre et sa vie. "Mon rôle était fini, le pays allait vers l'indépendance", explique-t-il. "La Tunisie allait devenir une jeune nation et je savais que cette nation serait arabo-musulmane : les minoritaires comme moi n'y auraient pas de place", précise-t-il. Albert Memmi n'a pourtant rien d'un fataliste. Simplement, cet "ultravoltairien", comme il aime à se définir, n'a "jamais confondu le constat et le vœu".
Avec son Portrait du colonisé, publié en pleine guerre d'Algérie, son nom franchit les frontières. Salué par les partisans des indépendances, ce livre est décrié par ceux, alors nombreux, favorables au maintien plus ou moins aménagé de l'ordre colonial. L'ouvrage sera également pris pour cible, quelques années plus tard, par des étudiants maghrébins, nationalistes arabo-musulmans. "Ils refusaient à Memmi, accusé de sionisme, le droit d'être considéré comme un ex-colonisé", rapporte l'universitaire Juliette Bessis, qui enseignait l'histoire à l'université de Vincennes (Paris-VIII) dans les années 1970.
Dans le Portrait du colonisé, comme dans sa suite, le tout nouveau Portrait du décolonisé (Gallimard, 2004), il s'agit, indique l'auteur, d'une "description ordonnée" de son sujet - non d'un pamphlet. Dans le premier portrait, Memmi prévenait : "Pour vivre, le colonisé a besoin de supprimer la colonisation. Mais pour devenir un homme, il doit supprimer le colonisé qu'il est devenu", cet "être d'oppression et de carences". S'il veut parvenir à ce résultat, il faut que le colonisé "se conquière libre vis-à-vis de la religion de son groupe" et qu'il cesse "de n'exister que par elle". De même qu'il doit se rendre libre vis-à-vis de la "nation", de la "tradition" ou de l'"ethnicité". Dans cet essai prémonitoire était dénoncée, déjà, la "fameuse et absurde opposition Orient-Occident", cette "antithèse durcie par le colonisateur", soucieux d'instaurer une "barrière définitive entre lui et le colonisé".
Près d'un demi-siècle plus tard, terrorisme islamique aidant, le bilan est amer. "La révolution n'a pas eu lieu", note-t-il, dénonçant les "fruits rabougris des indépendances", le fléau de la "corruption" et la "démission des élites". Particulièrement visée, la "société arabo-musulmane" est atteinte d'un "grave syndrome dépressif", insiste-t-il, égratignant au passage, de manière étonnamment violente, le nom de Leila Chahid, déléguée générale de la Palestine en France.
Parmi les lettres de réaction qu'Albert Memmi reçoit de ses lecteurs, "une bonne moitié m'approuve et regrette parfois que je n'aille pas plus loin, l'autre moitié m'accuse, comme d'habitude, de tous les maux de la Terre", assure-t-il, la moue philosophe. Accueilli avec chaleur sur les ondes de France-Culture comme sur celles de Beur-FM, pour évoquer Le Portrait du décolonisé, Albert Memmi a, en revanche, été "décommandé" par un animateur de Radio-Libertaire, lui reprochant ses positions "pas nettes" sur le conflit israëlo-palestinien. L'évadé solidaire du ghetto de Tunis n'en a cure.
Son prochain livre, dont la sortie est prévue à l'automne, sera un recueil de nouvelles. Il y parlera des femmes, du plaisir, de l'amour. Rien à voir avec son travail passé ? Tout, peut-être, au contraire... "Celui qui n'a pas fait ses comptes avec la féminité n'a pas fait ses comptes avec la nature, ni avec l'univers", assure le marabout de la rue Saint-Merri.
Pièces jointes:

|
Re: Albert Memmi - 1 17 septembre 2007, 09:34 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 2 663 |
|
Re: Albert Memmi - Extrait du roman "La Statue de Sel" 18 septembre 2007, 04:48 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
Extrait du roman "La Statue de Sel" d'Albert MEMMI
"Les voisins et les relations se rassemblaient dans la rue, autour du corbillard à l’ombre, et bientôt, il y eut foule. Les fenêtres, fermées pour la sieste, s’ouvraient et se garnissaient de têtes au spectacle. Les gens autour de moi, qui ne me connaissaient pas, bavardaient agréablement. Cette pause dans leurs activités quotidiennes les mettait, malgré eux, d’une bonne humeur discrète.
Le silence se fit lorsque le cercueil, péniblement descendu à travers la cage étroite de l’escalier, apparut enfin, et fut glissé avec un roulement sourd dans le corbillard. Les hommes, nous nous plaçâmes les uns derrière les autres, par ordre d’âge, les plus âgés d’abord. Ainsi, je me trouvai juste à côté de mon cousin et homonyme exact, le fils de l’oncle Gagou. Comme, dans le brouhaha, qui reprit, il pouvait parler à cœur ouvert, mon cousin me fit aussitôt d’aigres reproches. Comment n’étais-je pas venu immédiatement ? La tante veuve, pourtant, avait fait avertir, individuellement et immédiatement, tous les membres de la famille. L’oncle Joseph avait droit à tous les respects. (Je commençais à le savoir.) Le cousin parlait d’une voix légitime et sûre de son droit. Il est vrai aussi que nous avions le même nom ; le même nom et le même prénom. Nous étions deux exemplaires et la copie peut bien gourmander le modèle ou plutôt l’inverse, car je m’écartais des règles bien fondées sur la religion, les coutumes et la tradition. Le vrai Alexandre Benillouche, c’était lui, tout de noir vêtu, pour pleurer avec la famille la mort de son chef.
Le corbillard s’ébranla. Brusquement aux fenêtres retentirent de longs hurlements. Empêchées par la loi d’accompagner le mort au cimetière, les femmes le saluaient une dernière fois. Cette lugubre explosion au-dessus de nos têtes fit taire à nouveau la foule, pour un moment. Puis nous défilâmes à petits pas à travers la ville. Je profitai des remous du cortège pour reculer de quelques pas et semer mon cousin qui tenait à son rang. Dans les rues, les magasins juifs fermaient précipitamment leurs portes : il ne fallait pas que l’image de la mort se projetât à l’intérieur de leurs murs. Les femmes s’installaient aux fenêtres. Nous promenâmes ainsi la mort à travers la ville, passant volontairement par les principales artères avant d’arriver aux portes. Là, le cortège se défit et nous nous répartîmes dans les calèches. Comme je me trouvais à l’écart, je fus heureusement séparé de mes oncles et cousins.
Les cochers prirent immédiatement le trot derrière le corbillard qui allait bon train. De la rapidité de la course, de l’heure qui avançait, naquit une certaine fraîcheur qui fit plaisir à mes compagnons de route. D’abord, ils parlèrent un peu du mort puis se demandèrent de leurs nouvelles réciproques, celles de leurs familles, passèrent à la dureté des temps, à la difficulté de vivre et enfin à leurs affaires. Y trouvant quelques sujets d’agréments et de taquineries, ils en furent égayés et bientôt, dans la calèche bien close, on plaisanta franchement.
Seul, je n’arrivais pas à être gai, moi qui n’avais point participé à leur peine de tout à l’heure. L’arrivée au cimetière rendit à mes compagnons leur dignité attristée. Nous nous reformâmes en cortège, je retrouvai mon cousin et pris place près de lui, non loin de mon père, à trois rangées du corbillard. Déjà les fossoyeurs s’affairaient autour du trou creusé à ras de terre entre les marbres bas des tombes juives.
C’était la première fois que je pénétrai dans l’enceinte de ce nouveau cimetière ; le vieux, situé au milieu de la ville qui l’avait rejoint et entouré, ne m’impressionnait pas, ses tombes abandonnées, brisées, envahies par l’herbe et les chardons ne devaient plus contenir que des os disjoints ou même en poussière. Ici, on se trouvait au milieu de cadavres tout frais et de monuments neufs, bien entretenus, qui témoignaient de l’enrichissement des gens et de la vitalité des descendants : marbres sculptés en couronnes, oiseaux, colonnes brisées, grilles en fer forgé, chaînes d’or. Dieu, quel mauvais goût, me disais-je, dans ce qu’on appelle l’art funéraire ! Art ces infâmes vases de grès, ces odieuses fleurs violettes en celluloïd, en étoffe, trempées par la pluie, racornies par le soleil ! Mais probablement s’y mêle-t-il encore quelque respect semi-religieux ! J’étais sans pitié, fort de mon adolescence, de mon mépris de la mort, qui me paraissait impossible, inadéquate à moi.
Le rabbin, dodelinant de sa grosse tête chevelue sur un informe ballot de vêtements orientaux, sales, luttait de vitesse avec les fossoyeurs, grignotait les mots et abrégeait les formules de la prière funèbre. Les croque-morts, à l’écart, bavardaient entre eux. Tous ces salariés du rite, rabbins, fossoyeurs, croque-morts, employés de la communauté, trahissaient par leur naïve indifférence l’hypocrisie générale. L’officiant faisait bien d’ailleurs ; la chaleur demeurait malgré l’heure avancée et je sentais la sueur renaître à mon front. Nous pouvions heureusement garder nos chapeaux sur la tête. Enfin la tombe fut prête, les croque-morts sortirent du trou et allèrent chercher le cadavre. Ils le maintinrent un instant au-dessus de la fosse, puis l’y descendirent lentement.
Je savais ce qui allait se passer, on me l’avait raconté, et ne voulais pas le voir. Mais la curiosité l’emporta sur l’horreur et je ne pus détourner la tête. Lorsque le corps, encore étrangement vivant, fut à quelques centimètres du sol, ils le lâchèrent : au moment précis où il heurtait la pierre, les assistants devaient pousser un énorme cri collectif, pour étouffer tout bruit, ainsi qu’il est dit dans le rituel. Ils le poussèrent mais imperceptiblement trop tard et j’entendis l’affreuse matité du choc. Le travail mécanique des fossoyeurs reprit aussitôt, à la même cadence.
Avec une habileté exercée, ils plaçaient des pierres plates au-dessus de la fosse pour la fermer. En deux minutes, l’oncle Joseph fut définitivement isolé. Nous allâmes ensuite nous laver les mains à une fontaine consacrée, car la vue du cadavre nous avait souillés. Pourquoi les mains, me dis-je hargneux ? Pourquoi ne pas prendre tout un bain ? Je me lavai, cependant, comme tout le monde. A la sortie, nous attendait pour la quête un délégué trésorier de la communauté. Je ne donnai rien et passai droit, et comme toujours ma gêne tâchant de paraître fronde."
Source :
[www.leborgel.com]
"Les voisins et les relations se rassemblaient dans la rue, autour du corbillard à l’ombre, et bientôt, il y eut foule. Les fenêtres, fermées pour la sieste, s’ouvraient et se garnissaient de têtes au spectacle. Les gens autour de moi, qui ne me connaissaient pas, bavardaient agréablement. Cette pause dans leurs activités quotidiennes les mettait, malgré eux, d’une bonne humeur discrète.
Le silence se fit lorsque le cercueil, péniblement descendu à travers la cage étroite de l’escalier, apparut enfin, et fut glissé avec un roulement sourd dans le corbillard. Les hommes, nous nous plaçâmes les uns derrière les autres, par ordre d’âge, les plus âgés d’abord. Ainsi, je me trouvai juste à côté de mon cousin et homonyme exact, le fils de l’oncle Gagou. Comme, dans le brouhaha, qui reprit, il pouvait parler à cœur ouvert, mon cousin me fit aussitôt d’aigres reproches. Comment n’étais-je pas venu immédiatement ? La tante veuve, pourtant, avait fait avertir, individuellement et immédiatement, tous les membres de la famille. L’oncle Joseph avait droit à tous les respects. (Je commençais à le savoir.) Le cousin parlait d’une voix légitime et sûre de son droit. Il est vrai aussi que nous avions le même nom ; le même nom et le même prénom. Nous étions deux exemplaires et la copie peut bien gourmander le modèle ou plutôt l’inverse, car je m’écartais des règles bien fondées sur la religion, les coutumes et la tradition. Le vrai Alexandre Benillouche, c’était lui, tout de noir vêtu, pour pleurer avec la famille la mort de son chef.
Le corbillard s’ébranla. Brusquement aux fenêtres retentirent de longs hurlements. Empêchées par la loi d’accompagner le mort au cimetière, les femmes le saluaient une dernière fois. Cette lugubre explosion au-dessus de nos têtes fit taire à nouveau la foule, pour un moment. Puis nous défilâmes à petits pas à travers la ville. Je profitai des remous du cortège pour reculer de quelques pas et semer mon cousin qui tenait à son rang. Dans les rues, les magasins juifs fermaient précipitamment leurs portes : il ne fallait pas que l’image de la mort se projetât à l’intérieur de leurs murs. Les femmes s’installaient aux fenêtres. Nous promenâmes ainsi la mort à travers la ville, passant volontairement par les principales artères avant d’arriver aux portes. Là, le cortège se défit et nous nous répartîmes dans les calèches. Comme je me trouvais à l’écart, je fus heureusement séparé de mes oncles et cousins.
Les cochers prirent immédiatement le trot derrière le corbillard qui allait bon train. De la rapidité de la course, de l’heure qui avançait, naquit une certaine fraîcheur qui fit plaisir à mes compagnons de route. D’abord, ils parlèrent un peu du mort puis se demandèrent de leurs nouvelles réciproques, celles de leurs familles, passèrent à la dureté des temps, à la difficulté de vivre et enfin à leurs affaires. Y trouvant quelques sujets d’agréments et de taquineries, ils en furent égayés et bientôt, dans la calèche bien close, on plaisanta franchement.
Seul, je n’arrivais pas à être gai, moi qui n’avais point participé à leur peine de tout à l’heure. L’arrivée au cimetière rendit à mes compagnons leur dignité attristée. Nous nous reformâmes en cortège, je retrouvai mon cousin et pris place près de lui, non loin de mon père, à trois rangées du corbillard. Déjà les fossoyeurs s’affairaient autour du trou creusé à ras de terre entre les marbres bas des tombes juives.
C’était la première fois que je pénétrai dans l’enceinte de ce nouveau cimetière ; le vieux, situé au milieu de la ville qui l’avait rejoint et entouré, ne m’impressionnait pas, ses tombes abandonnées, brisées, envahies par l’herbe et les chardons ne devaient plus contenir que des os disjoints ou même en poussière. Ici, on se trouvait au milieu de cadavres tout frais et de monuments neufs, bien entretenus, qui témoignaient de l’enrichissement des gens et de la vitalité des descendants : marbres sculptés en couronnes, oiseaux, colonnes brisées, grilles en fer forgé, chaînes d’or. Dieu, quel mauvais goût, me disais-je, dans ce qu’on appelle l’art funéraire ! Art ces infâmes vases de grès, ces odieuses fleurs violettes en celluloïd, en étoffe, trempées par la pluie, racornies par le soleil ! Mais probablement s’y mêle-t-il encore quelque respect semi-religieux ! J’étais sans pitié, fort de mon adolescence, de mon mépris de la mort, qui me paraissait impossible, inadéquate à moi.
Le rabbin, dodelinant de sa grosse tête chevelue sur un informe ballot de vêtements orientaux, sales, luttait de vitesse avec les fossoyeurs, grignotait les mots et abrégeait les formules de la prière funèbre. Les croque-morts, à l’écart, bavardaient entre eux. Tous ces salariés du rite, rabbins, fossoyeurs, croque-morts, employés de la communauté, trahissaient par leur naïve indifférence l’hypocrisie générale. L’officiant faisait bien d’ailleurs ; la chaleur demeurait malgré l’heure avancée et je sentais la sueur renaître à mon front. Nous pouvions heureusement garder nos chapeaux sur la tête. Enfin la tombe fut prête, les croque-morts sortirent du trou et allèrent chercher le cadavre. Ils le maintinrent un instant au-dessus de la fosse, puis l’y descendirent lentement.
Je savais ce qui allait se passer, on me l’avait raconté, et ne voulais pas le voir. Mais la curiosité l’emporta sur l’horreur et je ne pus détourner la tête. Lorsque le corps, encore étrangement vivant, fut à quelques centimètres du sol, ils le lâchèrent : au moment précis où il heurtait la pierre, les assistants devaient pousser un énorme cri collectif, pour étouffer tout bruit, ainsi qu’il est dit dans le rituel. Ils le poussèrent mais imperceptiblement trop tard et j’entendis l’affreuse matité du choc. Le travail mécanique des fossoyeurs reprit aussitôt, à la même cadence.
Avec une habileté exercée, ils plaçaient des pierres plates au-dessus de la fosse pour la fermer. En deux minutes, l’oncle Joseph fut définitivement isolé. Nous allâmes ensuite nous laver les mains à une fontaine consacrée, car la vue du cadavre nous avait souillés. Pourquoi les mains, me dis-je hargneux ? Pourquoi ne pas prendre tout un bain ? Je me lavai, cependant, comme tout le monde. A la sortie, nous attendait pour la quête un délégué trésorier de la communauté. Je ne donnai rien et passai droit, et comme toujours ma gêne tâchant de paraître fronde."
Source :
[www.leborgel.com]
|
Re: Albert Memmi - 1 19 mars 2008, 08:54 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 258 |
Je ne pense pas que le probleme chez Albert Memmi etait la confrontation entre lorient et loccident
Jè sugerre plutot le manque de surete au sujet de l``identite
`qui le preoccupait .Etre juif ou etre `COMME les autres peuples```
Ce n``est pas facile
bien a vous cher Mr Lapid
sarel
Jè sugerre plutot le manque de surete au sujet de l``identite
`qui le preoccupait .Etre juif ou etre `COMME les autres peuples```
Ce n``est pas facile
bien a vous cher Mr Lapid
sarel
|
Re: Albert Memmi - 1 09 mars 2009, 21:04 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
Albert Memmi - 1 (suite)

Lu sur Harissa :
[www.harissa.com] Albert Memmi
[www.harissa.com] JUIF, TUNISIEN ET FRANCAIS
[www.harissa.com] RENCONTRE AVEC ALBERT MEMMI
[www.harissa.com] KIFS D'ALBERT MEMMI
Autres liens :
[www.limag.refer.org] Albert Memmi. Du malheur d’être juif au bonheur sépharade par Guy Ducas (commentaire)
[www.africultures.com] Albert Memmi L'Homme et l'oeuvre

[www.lire.fr] Portrait d'un juif

[www.elwatan.com] Hommage à Albert Memmi
[yves.frisch.free.fr] Albert Memmi
[books.google.co.il] Postcolonialisme & Autobiographie

Lu sur Harissa :
[www.harissa.com] Albert Memmi
[www.harissa.com] JUIF, TUNISIEN ET FRANCAIS
[www.harissa.com] RENCONTRE AVEC ALBERT MEMMI
[www.harissa.com] KIFS D'ALBERT MEMMI
Autres liens :
[www.limag.refer.org] Albert Memmi. Du malheur d’être juif au bonheur sépharade par Guy Ducas (commentaire)
[www.africultures.com] Albert Memmi L'Homme et l'oeuvre

[www.lire.fr] Portrait d'un juif

[www.elwatan.com] Hommage à Albert Memmi
[yves.frisch.free.fr] Albert Memmi
[books.google.co.il] Postcolonialisme & Autobiographie
|
Re: Albert Memmi - 5 09 mars 2009, 21:22 |
Membre depuis : 17 ans Messages: 3 376 |
Albert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » ! - Par Fériel Berraies Guigny - 6 mars 2007-
Albert Memmi est né en 1920 dans le quartier populaire de la Hara, à Tunis. Issu d'une famille juive de langue maternelle arabe, il a été formé à l’école française, d'abord au lycée Carnot de Tunis, puis à l'Université d'Alger, où il étudiera la philosophie, et enfin à la Sorbonne à Paris.
Albert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » !
Memmi se trouvant au carrefour de 3 cultures, a construit son œuvre sur la difficulté de trouver un équilibre entre Orient et Occident. Il a tout au long de sa vie et de sa carrière, été profondément influencé par son « terroir » et ses racines. Cette tunisianité qu’il a gardé au plus profond de son cœur, de son être et de sa mémoire, on la perçoit toujours dans ses écrits : « … Ma Tunisie à moi, est celle d’un écrivain, je la retrouve dans les odeurs, les couleurs… ».
Memmi est qualifié par ses pairs contemporains, de plus grand écrivain tunisien d’expression française (dictionnaire Bordas, des littératures), de figure de proue avec A. Camus, de représentant de la Littérature Maghrébine ( Magazine littéraire, Paris) ou encore par Hédi Bouraoui de « père fondateur de la littérature tunisienne d’expression française. Des hommages qui font de lui un véritable symbole culturel, dont la portée devient universelle, car elle dépasse les frontières.
On ne compte plus les références et les distinctions qu’a récolté cet écrivain, qui s’inscrit parmi les penseurs les plus éclairés de notre époque.
Son premier roman se veut largement autobiographique, La statue de sel, en 1953, sera préfacé par Albert Camus. Albert Memmi, devient presque une légende avec son œuvre la plus connue, un essai théorique préfacé par Jean-Paul Sartre : Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur publié en 1957 et qui apparaît, à l'époque, comme un soutien aux mouvements indépendantistes. Cette œuvre montre comment la relation entre colonisateur et colonisé les conditionne l'un et l'autre.
Il est aussi connu pour l'Anthologie des littératures maghrébines publiée en 1965 (tome I) et 1969 (tome II).
« … je suis un humaniste… » se plait il à répéter sans cesse, une vision et une empathie pour l’autre que l’on retrouve inconditionnellement dans sa réflexion.
L’œuvre d’ Albert Memmi a été traduite dans une vingtaine de pays, il a obtenu une dizaine de prix littéraires dont le Grand prix de la Francophonie décerné par l’Académie française et le Grand prix littéraire d u Maghreb. Une soixantaine d’ouvrages lui sont consacrés à travers le monde. On lui doit des concepts nouveaux comme hétéro phobie, ou judéité ; ainsi que des définitions inédites du racisme ou de la décolonisation (adoptées par l’Encyclopedia Universalis). Membre de plusieurs sociétés savantes, il a reçu de nombreuses décorations dont celle d’officier de la légion d’honneur, commandeur du nichan iftikhar et officier de l’ordre de la république tunisienne etc…
Albert Memmi a poursuivit une double carrière, celle de chercheur et d’écrivain.
Professeur Honoraire à l’Université de Paris, où il a occupé une chaire de sociologie de la culture, professeur à l’Université de Washington, membre de conseil à l’Université de Princeton, professeur Honoraire à H.E.C.
Docteur Honoris Causa de l’Université de Néguev, là où il a exercé, il a toujours su gagner l’admiration et l’estime de ses collègues.
Feriel Berraies Guigny a rencontré, Albert Memmi, dans son antre du Marais à Paris, « là où j’aime me retrouver, pour réfléchir et méditer quand je le peux… ».
Une discussion très émouvante s’est nouée, sur tout un parcours et une vision, sa philosophie de l’humain, des rapports avec l’autre et les maux et contraintes de nos sociétés contemporaines. Pour finir par l’amour pour sa douce Tunisie du souvenir, autant de thématiques qui ont signé l’empreinte la plus profonde de sa création littéraire.
Entretien :
1 - Dans votre roman ‘‘Agar’’, vous évoquez la difficulté de vivre avec l'autre face à sa différence. N’est-ce pas là, selon vous, le mal de la société actuelle ?
Toute mon œuvre repose sur deux mécanismes fondamentaux : celui de la dominance sujéstion qui signifie le conflit et l’agressivité, d’où ma définition du racisme qui est entrée dans le dictionnaire et qui est également patrimoine de l’Unesco. Et le second mécanisme , qui est celui de la dépendance pourvoyance.
Dans la collectivité ou de façon individuelle, il y a des mécanismes de conflit et de lutte. Dans cette catégorie nous pouvons inclure par exemple, la colonisation, la lutte entre les noirs et les blancs, les rapports entre un couple. Et dans tous ces cas de figure, c’est bien la différence qui fait le conflit.
S’agissant de la relation de dépendance pourvoyance, bien que l’on soit en lutte avec l’autre qui est différent, nous avons en même temps, besoin de lui.
La pourvoyance devient donc la réponse de l’autre, face au besoin du premier. La dépendance est un phénomène merveilleux. Le fond de la dépendance est toujours le même, bien que l’objet puisse changer.
Dans la colonisation, il y a la dominance du colonisateur et les réponses du dominé.
Quant à savoir si ce mal est actuel, je peux vous dire que ce mal existe et depuis fort longtemps. Mais il est vrai qu’aujourd’hui il s’est accentué et que l’on a de plus en plus de mal à cohabiter avec la différence de l’autre.L’instantanéité et la facilité des communications, ont rendu les migrations encore plus considérables. Et c’est ce qui fait le rejet de l’autre.
Ma philosophie repose sur trois axes : l’humanisme, le rationalisme et la laïcité. Dans toute situation, il faut toujours se demander quel est l’intérêt de l’autre ? et surtout, il faut procéder avec raison et non
avec émotion.
2) L'islamophobie est aujourd’hui une réalité. Elle provoque parfois des réactions aussi néfastes que l’antisémitisme. Ne pensez-vous pas que les deux attitudes (et phénomènes) doivent être combattus ensemble et non séparément ?
L’antisémitisme et l’islamophobie participent de ce même rejet de l’autre. Cela est basé sur un certain nombre de préjugés, de mauvaises interprétations de l’histoire, voire de beaucoup d’injustices et d’agressivité de la part de l’autre.
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est qu’il y a des mécanismes communs et des spécificités.
Il faut toujours commencer par chercher les mécanismes communs dans une situation. Cela peut se faire selon une méthode rationnelle avec preuve à l’appui. Ensuite les spécificités on les retrouve par delà les mécanismes communs. Dans chaque catégorie il y a des mécanismes communs et c’est le cas de l’islamophobie et de l’antisémitisme. Dans ces deux catégories, il y a le rejet de l’autre, les préjugés, puis une histoire défaillante. Le monde arabo-musulman n’est pas encore ressorti d’une vision assez rétrograde et dévalorisante de l’autre, c’est un peu ce qui se passe aussi, s’agissant du statut de la femme.
3 - Vous avez développé le concept d’hétérophobie. Comment le situez-vous dans le contexte actuel de choc des civilisations ?
C’est le constat du racisme qui m’a amené à développer ce concept. J’ai beaucoup traité de cette question, notamment dans mon portrait du colonisé, qui d’ailleurs vient de paraître en arabe ce mois ci, aux éditions tunisiennes de Mohamed Attia. Je me suis aperçu que la colonisation s’accompagnait toujours d’un rejet biologique du colonisé. Le colonisé est « un être inférieur.. . ». C’est un mécanisme de dévalorisation afin de justifier une domination. De là, je me suis aperçu qu’il y avait d’autres conditions dans lesquelles pouvaient jouer les mêmes mécanismes. Ce mécanisme est bel et bien ancré dans le concept du choc des civilisations, qui explique que ce sont les prétendues différences culturelles, religieuses, psychologiques qui amènent le manque de dialogue et l’hostilité.
J’ai donc cherché un concept qui puisse englober ces caractéristiques et aussi les dépasser jusqu’à la métaphysique. C’est ainsi, que je suis parvenu à l’hétérophobie. Aujourd’hui, avec toute cette agitation universelle, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun.
4 - N’y a-t-il pas aujourd’hui, face à la montée des fondamentalismes religieux, une nouvelle forme d’intégrisme, celle de la laïcité ? Et comment la combattre ?
Je ne suis pas d’accord. On ne peut comparer le fondamentalisme religieux à la laïcité. Je ne nie pas par contre qu’il puisse y avoir certains excès de la part des laïcs. Tenez je vais vous conter une anecdote, j’habite non loin de l’hôtel de ville, ici même il y a une place où on a accroché des têtes durant la révolution française !
Même pour les Rois, je n’appliquerai pas cette forme de laïcité !
La laïcité pour moi, est uniquement une forme constitutionnelle, ce n’est pas nécessairement une philosophie globale totalitaire qui englobe tous les aspects de l’existence. C’est uniquement une forme de contrat entre des groupes différents qui forment une société globale. Tout cela dans le but de pouvoir coexister ensemble en paix. Pour moi c’est la garantie de la liberté de penser et de culte.
Chose que les fondamentalistes ne vous donnent pas !
Actuellement, il y a une tradition laïque qui est écrasée par les fondamentalistes de tout bord !
Je suis plus proche des penseurs comme Montaigne ou de la philosophie des grecs, que de ma religion. Il y a véritablement une lutte à mener et que nous devons revendiquer. Mais il est vrai, qu’il faudrait davantage de courage de la part de nos intellectuels qui doivent affirmer haut et fort leur laïcité.
Mais je comprends aussi ceux qui essayent de combler un certain vide spirituel dans leur vie, car l’homme a aussi peur du néant qui lui rappelle sa mortalité. La religion devient un substitut à ce vide.
5 - Au lendemain des indépendances, vous avez brossé un portrait du colonisé. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les dé-colonisés ?
Il faut distinguer le décolonisé resté dans son pays natal, de celui qui s’est installé en Occident.
Celui qui est resté au pays fait face à des problèmes spécifiques et on les retrouve principalement autour d’une carence de la part des Chefs politiques de la plupart des pays du Tiers Monde. La corruption et la tyrannie y sont gangrenées. C’est un cercle infernal difficile à briser qui génère les problèmes sociaux actuels : chômage, troubles sociaux et donc répression.
Le décolonisé dans le pays d’accueil, va quant à lui subir tous les affres de l’exil. C’est un étranger avant tout, et il se trouvera toujours en conflit avec le majoritaire. Il sera confronté aux problèmes d’intégration. Il y a véritablement, ici aussi, une lutte à mener pour que cessent les inégalités, pour dissiper les préjugés, faire prévaloir les droits. Mais c’est un long travail.
6 - Quel portrait pourriez-vous dresser, aujourd’hui, du colonisé palestinien, irakien ou afghan ?
S’agissant des cas de figure que vous énoncez, je ne vous parlerai que du palestinien et de l’irakien, car s’agissant de l’afghan je ne maîtrise pas le sujet. Pour le palestinien, il est réellement dominé par l’israélien et il faut que cela cesse. C’est mon profond sentiment d’humaniste.
Mais il est vrai aussi que le Monde arabe surévalue la question palestinienne. Et à mon humble avis, si l’Etat d’Israël venait à disparaître, les problèmes du Monde arabe continueraient à exister. Il faut par conséquent, arrêter de prendre la Palestine comme alibi.
Aujourd’hui la réalité est la suivante, nous avons face à nous un conflit entre deux nationalismes. Il faut donc parvenir à un accord et surtout que le monde arabe s’investisse moins.
S’agissant de l’Irak on pensait qu’en éliminant Saddam, c’était éloigner le danger de ce pays et de l’Occident. Or ce fut l’effet inverse, c’est aujourd’hui le chaos et l’anarchie. Fallait il pour autant la guerre ? je n’en suis pas si sur. Sur ce terrain, les Nations Unies se sont désengagés, mais il est vrai que c’est la donne pétrolière qui régit tout dans cette région. Et le monde Occidental est affolé à la perspective de manquer de pétrole, ce qui amène les écarts que vous savez.
7 - Les musulmans, dit-on souvent en Occident, ne sont pas prêts au débat contradictoire, à la critique et à l’autocritique ? Les juifs – et surtout les Israéliens – le sont-ils davantage ? En d’autres termes, peut-on, aujourd’hui, en Occident, critiquer l’Etat d’Israël ?
Il faut critiquer le gouvernement israélien et non l’existence de l’Etat d’Israël. J’ai pris très souvent position contre les gouvernements israéliens, nous « intellectuels juifs » nous ne ménageons pas notre critique envers certaines gouvernances israéliennes. Mais le problème véritable du Monde arabe, c’est qu’il a du mal à absorber ses minorités. Il faut donc faire attention à la totalisation, du genre « les juifs sont des usuriers » ou que « les noirs sentent mauvais » ou « que les musulmans sont des terroristes
» ou « que les femmes sont sournoises »…
Des propos pareils sont le résultat d’une erreur de logique, ce sont des accusations implicites qui génèrent l’hétérophobie.
8 - Dans une intervention lors d'un récent colloque à Paris sur la paix au Proche-Orient, vous avez dit que l'un des problèmes du monde arabe actuel est son incapacité à ‘‘retenir’’ ses minorités ? Est-ce que l’Europe, les Etats-Unis et Israël, n’ont-ils pas eux aussi le même problème avec leurs minorités arabes, turcs, africaines, etc. ?
Tous les majoritaires ont tendance à se méfier des minorités et à les « parquer » mais pour le reste, c’est uniquement une question de degré.
9 – Que signifie, pour Israël et les Arabes, «renoncer à certains mythes» ? Quels sont ces mythes que vous jugez anachroniques des deux côtés ?
Pour Israël, il est temps d’abandonner l’idée d’un grand Israël démographique et territorial et il lui faut cesser de croire également, qu’il est l’unique solution au monde juif. Pour les arabes, il leur faut accepter leurs minorités d’autant qu’ils ont besoins d’elles. L’Occident a besoin du monde arabe et vice versa.
10 – Quels souvenirs gardez-vous aujourd’hui de la Tunisie, pays de votre enfance ? De quelle Tunisie vous prévalez vous aujourd'hui ?
Ma Tunisie à moi, est la Tunisie d’un écrivain, je revois les odeurs, les couleurs, les petits rites comme « manger un beignet à Sidi Bou Said ». J’y suis viscéralement attaché, et de mes 25 livres, il y en a au moins 10 où la Tunisie est présente. C’est cette Tunisie là que j’aime.
Albert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » !
Source : [www.destindelafrique.com]
Albert Memmi est né en 1920 dans le quartier populaire de la Hara, à Tunis. Issu d'une famille juive de langue maternelle arabe, il a été formé à l’école française, d'abord au lycée Carnot de Tunis, puis à l'Université d'Alger, où il étudiera la philosophie, et enfin à la Sorbonne à Paris.
Albert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » !
Memmi se trouvant au carrefour de 3 cultures, a construit son œuvre sur la difficulté de trouver un équilibre entre Orient et Occident. Il a tout au long de sa vie et de sa carrière, été profondément influencé par son « terroir » et ses racines. Cette tunisianité qu’il a gardé au plus profond de son cœur, de son être et de sa mémoire, on la perçoit toujours dans ses écrits : « … Ma Tunisie à moi, est celle d’un écrivain, je la retrouve dans les odeurs, les couleurs… ».
Memmi est qualifié par ses pairs contemporains, de plus grand écrivain tunisien d’expression française (dictionnaire Bordas, des littératures), de figure de proue avec A. Camus, de représentant de la Littérature Maghrébine ( Magazine littéraire, Paris) ou encore par Hédi Bouraoui de « père fondateur de la littérature tunisienne d’expression française. Des hommages qui font de lui un véritable symbole culturel, dont la portée devient universelle, car elle dépasse les frontières.
On ne compte plus les références et les distinctions qu’a récolté cet écrivain, qui s’inscrit parmi les penseurs les plus éclairés de notre époque.
Son premier roman se veut largement autobiographique, La statue de sel, en 1953, sera préfacé par Albert Camus. Albert Memmi, devient presque une légende avec son œuvre la plus connue, un essai théorique préfacé par Jean-Paul Sartre : Portrait du colonisé précédé du portrait du colonisateur publié en 1957 et qui apparaît, à l'époque, comme un soutien aux mouvements indépendantistes. Cette œuvre montre comment la relation entre colonisateur et colonisé les conditionne l'un et l'autre.
Il est aussi connu pour l'Anthologie des littératures maghrébines publiée en 1965 (tome I) et 1969 (tome II).
« … je suis un humaniste… » se plait il à répéter sans cesse, une vision et une empathie pour l’autre que l’on retrouve inconditionnellement dans sa réflexion.
L’œuvre d’ Albert Memmi a été traduite dans une vingtaine de pays, il a obtenu une dizaine de prix littéraires dont le Grand prix de la Francophonie décerné par l’Académie française et le Grand prix littéraire d u Maghreb. Une soixantaine d’ouvrages lui sont consacrés à travers le monde. On lui doit des concepts nouveaux comme hétéro phobie, ou judéité ; ainsi que des définitions inédites du racisme ou de la décolonisation (adoptées par l’Encyclopedia Universalis). Membre de plusieurs sociétés savantes, il a reçu de nombreuses décorations dont celle d’officier de la légion d’honneur, commandeur du nichan iftikhar et officier de l’ordre de la république tunisienne etc…
Albert Memmi a poursuivit une double carrière, celle de chercheur et d’écrivain.
Professeur Honoraire à l’Université de Paris, où il a occupé une chaire de sociologie de la culture, professeur à l’Université de Washington, membre de conseil à l’Université de Princeton, professeur Honoraire à H.E.C.
Docteur Honoris Causa de l’Université de Néguev, là où il a exercé, il a toujours su gagner l’admiration et l’estime de ses collègues.
Feriel Berraies Guigny a rencontré, Albert Memmi, dans son antre du Marais à Paris, « là où j’aime me retrouver, pour réfléchir et méditer quand je le peux… ».
Une discussion très émouvante s’est nouée, sur tout un parcours et une vision, sa philosophie de l’humain, des rapports avec l’autre et les maux et contraintes de nos sociétés contemporaines. Pour finir par l’amour pour sa douce Tunisie du souvenir, autant de thématiques qui ont signé l’empreinte la plus profonde de sa création littéraire.
Entretien :
1 - Dans votre roman ‘‘Agar’’, vous évoquez la difficulté de vivre avec l'autre face à sa différence. N’est-ce pas là, selon vous, le mal de la société actuelle ?
Toute mon œuvre repose sur deux mécanismes fondamentaux : celui de la dominance sujéstion qui signifie le conflit et l’agressivité, d’où ma définition du racisme qui est entrée dans le dictionnaire et qui est également patrimoine de l’Unesco. Et le second mécanisme , qui est celui de la dépendance pourvoyance.
Dans la collectivité ou de façon individuelle, il y a des mécanismes de conflit et de lutte. Dans cette catégorie nous pouvons inclure par exemple, la colonisation, la lutte entre les noirs et les blancs, les rapports entre un couple. Et dans tous ces cas de figure, c’est bien la différence qui fait le conflit.
S’agissant de la relation de dépendance pourvoyance, bien que l’on soit en lutte avec l’autre qui est différent, nous avons en même temps, besoin de lui.
La pourvoyance devient donc la réponse de l’autre, face au besoin du premier. La dépendance est un phénomène merveilleux. Le fond de la dépendance est toujours le même, bien que l’objet puisse changer.
Dans la colonisation, il y a la dominance du colonisateur et les réponses du dominé.
Quant à savoir si ce mal est actuel, je peux vous dire que ce mal existe et depuis fort longtemps. Mais il est vrai qu’aujourd’hui il s’est accentué et que l’on a de plus en plus de mal à cohabiter avec la différence de l’autre.L’instantanéité et la facilité des communications, ont rendu les migrations encore plus considérables. Et c’est ce qui fait le rejet de l’autre.
Ma philosophie repose sur trois axes : l’humanisme, le rationalisme et la laïcité. Dans toute situation, il faut toujours se demander quel est l’intérêt de l’autre ? et surtout, il faut procéder avec raison et non
avec émotion.
2) L'islamophobie est aujourd’hui une réalité. Elle provoque parfois des réactions aussi néfastes que l’antisémitisme. Ne pensez-vous pas que les deux attitudes (et phénomènes) doivent être combattus ensemble et non séparément ?
L’antisémitisme et l’islamophobie participent de ce même rejet de l’autre. Cela est basé sur un certain nombre de préjugés, de mauvaises interprétations de l’histoire, voire de beaucoup d’injustices et d’agressivité de la part de l’autre.
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est qu’il y a des mécanismes communs et des spécificités.
Il faut toujours commencer par chercher les mécanismes communs dans une situation. Cela peut se faire selon une méthode rationnelle avec preuve à l’appui. Ensuite les spécificités on les retrouve par delà les mécanismes communs. Dans chaque catégorie il y a des mécanismes communs et c’est le cas de l’islamophobie et de l’antisémitisme. Dans ces deux catégories, il y a le rejet de l’autre, les préjugés, puis une histoire défaillante. Le monde arabo-musulman n’est pas encore ressorti d’une vision assez rétrograde et dévalorisante de l’autre, c’est un peu ce qui se passe aussi, s’agissant du statut de la femme.
3 - Vous avez développé le concept d’hétérophobie. Comment le situez-vous dans le contexte actuel de choc des civilisations ?
C’est le constat du racisme qui m’a amené à développer ce concept. J’ai beaucoup traité de cette question, notamment dans mon portrait du colonisé, qui d’ailleurs vient de paraître en arabe ce mois ci, aux éditions tunisiennes de Mohamed Attia. Je me suis aperçu que la colonisation s’accompagnait toujours d’un rejet biologique du colonisé. Le colonisé est « un être inférieur.. . ». C’est un mécanisme de dévalorisation afin de justifier une domination. De là, je me suis aperçu qu’il y avait d’autres conditions dans lesquelles pouvaient jouer les mêmes mécanismes. Ce mécanisme est bel et bien ancré dans le concept du choc des civilisations, qui explique que ce sont les prétendues différences culturelles, religieuses, psychologiques qui amènent le manque de dialogue et l’hostilité.
J’ai donc cherché un concept qui puisse englober ces caractéristiques et aussi les dépasser jusqu’à la métaphysique. C’est ainsi, que je suis parvenu à l’hétérophobie. Aujourd’hui, avec toute cette agitation universelle, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun.
4 - N’y a-t-il pas aujourd’hui, face à la montée des fondamentalismes religieux, une nouvelle forme d’intégrisme, celle de la laïcité ? Et comment la combattre ?
Je ne suis pas d’accord. On ne peut comparer le fondamentalisme religieux à la laïcité. Je ne nie pas par contre qu’il puisse y avoir certains excès de la part des laïcs. Tenez je vais vous conter une anecdote, j’habite non loin de l’hôtel de ville, ici même il y a une place où on a accroché des têtes durant la révolution française !
Même pour les Rois, je n’appliquerai pas cette forme de laïcité !
La laïcité pour moi, est uniquement une forme constitutionnelle, ce n’est pas nécessairement une philosophie globale totalitaire qui englobe tous les aspects de l’existence. C’est uniquement une forme de contrat entre des groupes différents qui forment une société globale. Tout cela dans le but de pouvoir coexister ensemble en paix. Pour moi c’est la garantie de la liberté de penser et de culte.
Chose que les fondamentalistes ne vous donnent pas !
Actuellement, il y a une tradition laïque qui est écrasée par les fondamentalistes de tout bord !
Je suis plus proche des penseurs comme Montaigne ou de la philosophie des grecs, que de ma religion. Il y a véritablement une lutte à mener et que nous devons revendiquer. Mais il est vrai, qu’il faudrait davantage de courage de la part de nos intellectuels qui doivent affirmer haut et fort leur laïcité.
Mais je comprends aussi ceux qui essayent de combler un certain vide spirituel dans leur vie, car l’homme a aussi peur du néant qui lui rappelle sa mortalité. La religion devient un substitut à ce vide.
5 - Au lendemain des indépendances, vous avez brossé un portrait du colonisé. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur les dé-colonisés ?
Il faut distinguer le décolonisé resté dans son pays natal, de celui qui s’est installé en Occident.
Celui qui est resté au pays fait face à des problèmes spécifiques et on les retrouve principalement autour d’une carence de la part des Chefs politiques de la plupart des pays du Tiers Monde. La corruption et la tyrannie y sont gangrenées. C’est un cercle infernal difficile à briser qui génère les problèmes sociaux actuels : chômage, troubles sociaux et donc répression.
Le décolonisé dans le pays d’accueil, va quant à lui subir tous les affres de l’exil. C’est un étranger avant tout, et il se trouvera toujours en conflit avec le majoritaire. Il sera confronté aux problèmes d’intégration. Il y a véritablement, ici aussi, une lutte à mener pour que cessent les inégalités, pour dissiper les préjugés, faire prévaloir les droits. Mais c’est un long travail.
6 - Quel portrait pourriez-vous dresser, aujourd’hui, du colonisé palestinien, irakien ou afghan ?
S’agissant des cas de figure que vous énoncez, je ne vous parlerai que du palestinien et de l’irakien, car s’agissant de l’afghan je ne maîtrise pas le sujet. Pour le palestinien, il est réellement dominé par l’israélien et il faut que cela cesse. C’est mon profond sentiment d’humaniste.
Mais il est vrai aussi que le Monde arabe surévalue la question palestinienne. Et à mon humble avis, si l’Etat d’Israël venait à disparaître, les problèmes du Monde arabe continueraient à exister. Il faut par conséquent, arrêter de prendre la Palestine comme alibi.
Aujourd’hui la réalité est la suivante, nous avons face à nous un conflit entre deux nationalismes. Il faut donc parvenir à un accord et surtout que le monde arabe s’investisse moins.
S’agissant de l’Irak on pensait qu’en éliminant Saddam, c’était éloigner le danger de ce pays et de l’Occident. Or ce fut l’effet inverse, c’est aujourd’hui le chaos et l’anarchie. Fallait il pour autant la guerre ? je n’en suis pas si sur. Sur ce terrain, les Nations Unies se sont désengagés, mais il est vrai que c’est la donne pétrolière qui régit tout dans cette région. Et le monde Occidental est affolé à la perspective de manquer de pétrole, ce qui amène les écarts que vous savez.
7 - Les musulmans, dit-on souvent en Occident, ne sont pas prêts au débat contradictoire, à la critique et à l’autocritique ? Les juifs – et surtout les Israéliens – le sont-ils davantage ? En d’autres termes, peut-on, aujourd’hui, en Occident, critiquer l’Etat d’Israël ?
Il faut critiquer le gouvernement israélien et non l’existence de l’Etat d’Israël. J’ai pris très souvent position contre les gouvernements israéliens, nous « intellectuels juifs » nous ne ménageons pas notre critique envers certaines gouvernances israéliennes. Mais le problème véritable du Monde arabe, c’est qu’il a du mal à absorber ses minorités. Il faut donc faire attention à la totalisation, du genre « les juifs sont des usuriers » ou que « les noirs sentent mauvais » ou « que les musulmans sont des terroristes
» ou « que les femmes sont sournoises »…
Des propos pareils sont le résultat d’une erreur de logique, ce sont des accusations implicites qui génèrent l’hétérophobie.
8 - Dans une intervention lors d'un récent colloque à Paris sur la paix au Proche-Orient, vous avez dit que l'un des problèmes du monde arabe actuel est son incapacité à ‘‘retenir’’ ses minorités ? Est-ce que l’Europe, les Etats-Unis et Israël, n’ont-ils pas eux aussi le même problème avec leurs minorités arabes, turcs, africaines, etc. ?
Tous les majoritaires ont tendance à se méfier des minorités et à les « parquer » mais pour le reste, c’est uniquement une question de degré.
9 – Que signifie, pour Israël et les Arabes, «renoncer à certains mythes» ? Quels sont ces mythes que vous jugez anachroniques des deux côtés ?
Pour Israël, il est temps d’abandonner l’idée d’un grand Israël démographique et territorial et il lui faut cesser de croire également, qu’il est l’unique solution au monde juif. Pour les arabes, il leur faut accepter leurs minorités d’autant qu’ils ont besoins d’elles. L’Occident a besoin du monde arabe et vice versa.
10 – Quels souvenirs gardez-vous aujourd’hui de la Tunisie, pays de votre enfance ? De quelle Tunisie vous prévalez vous aujourd'hui ?
Ma Tunisie à moi, est la Tunisie d’un écrivain, je revois les odeurs, les couleurs, les petits rites comme « manger un beignet à Sidi Bou Said ». J’y suis viscéralement attaché, et de mes 25 livres, il y en a au moins 10 où la Tunisie est présente. C’est cette Tunisie là que j’aime.
Albert Memmi « Aujourd’hui, l’hétérophobie devient une extension du rejet biologique, à l’ensemble des traits culturels de chacun » !
Source : [www.destindelafrique.com]
|
Re: Albert Memmi - 1 10 mars 2009, 00:04 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 258 |
Cher Lapid je pense que Albert Memmi n'a pas reussi a comprendre le "juif"
Il n'a pas essaye 'ou il n'a pas voulu 'chercher profondemment.
Les solutions universelles n'interressent pas l';univers quand il s'agit du "juif"
C;est un fait qui apparrait periodiquement.
Celui de parraitre ou copier les autres nations de la part du juif et leur rejet base sur les memes intentions anti juives bien ancrees.
Bien a vous sarel
Il n'a pas essaye 'ou il n'a pas voulu 'chercher profondemment.
Les solutions universelles n'interressent pas l';univers quand il s'agit du "juif"
C;est un fait qui apparrait periodiquement.
Celui de parraitre ou copier les autres nations de la part du juif et leur rejet base sur les memes intentions anti juives bien ancrees.
Bien a vous sarel
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.