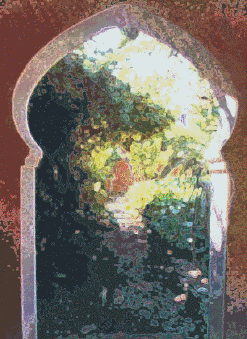|
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....FREDDY...CAMUS.....*****
Envoyé par albert
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 17 octobre 2008, 04:42 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 238 |
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 21 octobre 2008, 01:40 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 238 |
Une nouvelle historique de
Reuven (Roger) Cohen
L'enterrement de Che'mile 1ère partie
Les parapluies endeuillés signalaient le site de la cérémonie dans l'allée du cimetière juif de Bagneux.
Ils formaient une carapace noire au dessus des visages que l'on ne pouvait discerner. Comme cette formation de bataille, la tortue, adoptée par l'armée romaine lors des sièges des places fortes, qui consistait à imbriquer les boucliers les uns dans les autres au dessus des têtes pour se protéger des projectiles ennemis. Tout le long de leur vie de militant, ils s'étaient défendus ainsi contre les attaques ennemies, se serrant les uns contre les autres, anonymes et sans visages.
Depuis le matin, la pluie tombait, serrée et continue, répondant au tonnerre et aux éclairs par des averses soudaines et violentes. Ce n'était pas un temps à mettre un chien dehors. Mais eux en avaient vu d'autres. Et, comme d'habitude, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils étaient tous là, fidèles à leur devoir. Ils honoraient Che'mile, un vieux compagnon de route, un fidèle qui n'avait jamais failli, un pur dans son engagement politique, toujours présent à l'appel malgré les malheurs qui s'étaient abattus sur lui.
Ouvrier du cuir, il s'était adapté, à son arrivée en France à son nouveau statut, travaillant sans relâche dans cet atelier sombre et insalubre, s'efforçant de nourrir sa famille. Il ramait contre vents et marées pour quelques francs en espèces que lui remettait son patron à la fin de la semaine. Une vie morne sur un fond de manque et de besoin. Une vie sombre le jour, triste le soir, silencieuse la nuit après que les petits se soient endormis. Les livres qui alimentaient jadis son quotidien, demeuraient fermés. Pas de conversation. Pas de radio. Le silence angoissant.
Mais à la fin de la semaine, à l'entrée du Shabbat, après que le patron juif ait fermé l'atelier, il revenait à la vie.
C'est alors qu'il se replongeait dans ce qui avait fait de lui ce qu'il avait toujours été, un intellectuel, un militant politique, un idéologue dont on appréciait les analyses et le discours.
C'est alors qu'il respirait, qu'il reprenait contact avec les choses de la vie. Tôt le matin du Samedi, il se levait, s'installait près de la fenêtre afin de profiter de la première lumière du jour, secouait d'un livre la poussière de la semaine, et lisait.
Il lisait en Yddish, bien entendu, cette langue vernaculaire du peuple juif en Ashkénaze que l'élite locale de Pologne et d'Europe Centrale avait "classicisée" afin qu'elle modèle ces communautés juives éparses en un Peuple, en une Nation. Car une Nation, pour ces militants, est configurée par la langue qu'elle parle - et qu'elle écrit. L'essai du philosophe Johann Gottfried Herder "Essai sur l'origine de la langue" de 1770, avait été le livre de chevet des fondateurs du Parti. Ses membres s'appliquaient à ce que le Juif ne commerce avec ses frères que dans leur langue nationale. Comme plus tard les Sionistes qui avaient fait de l'hébreu, alors langue de rite et de prières - comme l'est le latin chez les Catholiques - la langue parlée et écrite du Peuple Juif sur sa Terre.
Puis, au réveil des grands, toujours en silence, il les prenait par la main et se dirigeait épanoui, le cœur dilaté dans sa poitrine, vers le siège du Parti. Le parti occupait une espèce d'entrepôt du coté de La Place de la République. On y avait entassé de vielles tables et des chaises bancales, des étagères fatiguées qui pliaient sous le poids de livres épais, tout un appareil de "vieilleries" recueillies aux Puces. Près de l'entrée fumait un samovar que l'on s'appliquait à astiquer pour maintenir la brillance de ses chromes, la seule source de luminosité dans la semi obscurité de la salle.
C'était le seul éclat, le seul luxe que le Parti s'était permis. C'était le seul espace qui autour du rite du thé témoignait, les jours de la semaine, d'un semblant de vie sociale dans cet antre poussiéreux.
Mais le Samedi, c'était autre chose.
Le Samedi était le grand jour. Le jour où on ajoutait au lustre central des ampoules électriques qui permettaient de découvrir sur les murs les portraits de Marx et de Lénine, celui de Haim Jitlowski, accompagné d'une citation de son fameux article polémique "Farvos davke yiddish ?", ceux de John Mill et de Kremer et de Mutnik, ces premiers leaders du Parti. Les murs s'illuminaient alors et devenaient amicaux, proches des camarades qui retrouvaient de nouveau leur identité politique, ignorée tout le long de leur semaine de labeur.
C'était le jour où les chaises ne suffisaient pas pour accueillir les membres du Parti. Il y en avait qui demeuraient debout tout le long de la Réunion hebdomadaire du Parti, afin d'écouter le Message de la Semaine que transmettait son Secrétaire, et qui était suivi des interventions des camarades, en Yddish bien entendu. Car la plupart des membres du Parti installés cependant à Paris depuis plus de vingt ans, ne parlaient qu'un français déformé et boiteux. Les grands enfants que l'Ecole républicaine éduquait et qui accompagnaient leurs parents à cette Réunion du Samedi, suivaient sans sourciller les conversations et les interventions. Ils recevaient là leur éducation Nationale et Politique. Certains des membres présents soutenaient qu'ils possédaient le Yddish, en ses termes les plus sophistiqués, comme eux-mêmes le possédaient. "Nous détenons par là, ajoutaient-ils, la garantie que cette langue ne s'éteindra jamais".
Enfin, celui que l'on attendait depuis le début des interventions, reçut la parole. Che'mile se leva, et avec un grand sourire, il repoussa point par point, et avec une logique et un calme écrasants, les propositions du Secrétariat Général, que son Secrétaire, en conclusion du Message de la Semaine, avait mises à l'ordre du jour. Che'mile développa, comme alternative d'action du Parti aux propositions du Secrétariat, une motion qui consistait à développer la lutte ouvrière juive au sein des syndicats français et ce, dans l'esprit de la stratégie traditionnelle du Parti. Les "camarades" le suivaient avec délectation. Il les ramenait qui dix, qui vingt, qui trente années en arrière, là où tout était transparent et efficace, où la logique des concepts était inéluctable, où l'idéologie mordait à pleine dents dans la réalité. Avec lui tout devenait clair, leur situation ouvrière et son analyse, les mesures à prendre et la stratégie à mener, tout ce qui avait fait dire à Hegel "Ce qui est logique est réel et ce qui est réel est logique".
Mais la réalité était autre. La crise économique qui se développait avait augmenté la rareté de l'emploi "et mis fin aux rêves de prolétarisation" sur lesquels était née cette idéologie. "Dans le Paris des années trente, écrit David H. Weinberg, le travail à domicile du façonnier est la principale caractéristique des métiers juifs. Sur plus de 50 000 immigrés travaillant dans le textile et le vêtement, à peine 22 500 étaient véritablement des salariés travaillant en atelier. La plus grande partie du travail était effectuée par plus de 10 500 façonniers dont l'existence apparemment indépendante dissimulait une exploitation féroce". (1)
La peur d'attirer l'attention sur eux, empêchait ces façonniers immigrés, travailleurs clandestins, de s'organiser. La peur de perdre leur contrat avec leur patron menait inéluctablement à une exploitation éhontée. Mais ils n'en avaient pas le choix, et "les tentatives de grèves de façonniers qui eurent lieu en juin 1936 tournèrent court assez vite". (2)

Le Prof et l'élève
Lire la suite jeudi prochain
Bibliographie :
(1) David H Weinberg, les Juifs à Paris de 1933 à 1939, p. 30, Paris 1974
(2) Ibidem, p. 33.
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 22 octobre 2008, 09:42 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 238 |
L'enterrement de Che'mile
2ème partie
Nouvelle de Reuven (Roger) Cohen

La voix du Prof.
Aussi, le discours de Che'mile s'adressait à un autre public et à une autre époque. Mais on le suivait, ce samedi comme les autres samedis, avec délice, car il rappelait à leur souvenir les journées héroïques du passé.
Masha, à qui sa petite fille donnait le bras pour la soutenir et qui la couvrait de son large parapluie noir, se souvenait avec émotion de cette session hebdomadaire du Parti, celle qui changea sa vie. La pluie se mêlait à ses larmes. Sa petite fille s'appliquait à la protéger de la pluie qui ne cessait de tomber drue et forte, l'attirait vers elle pour que le parapluie la protège. Mais Masha était ailleurs. Elle était dans cette salle de Réunion qui soudain s'était illuminée lorsque Che'mile avait pris la parole.
Elle se souvint de son regard bleu et vif, qui se fixa un instant sur elle quand elle applaudit, plus enthousiaste que les autres, au slogan qu'il venait de forger comme conclusion à son intervention "L'ouvrier juif est tout, le parti n'est qu'un moyen pour l'aider à réaliser son bonheur, ici en France comme partout ailleurs !" Il vint alors à elle et lui serra la main, en signe de remerciement.
Cela faisait des semaines qu'elle hésitait à l'aborder. Elle, la jeune militante qui n'osait prendre la parole devant ces géants du Parti, ces géants qui jonglaient avec les Idées comme elle parlait avec sa voisine d'atelier, lui serra la main et accepta son invitation.
Elle travaillait dans un atelier de couture, ces mêmes ateliers occupés aujourd'hui par les ouvriers chinois de la couture. Elle se savait exploitée par le patron qui n'en avait que faire des droits syndicaux de ses ouvriers.
Malgré ses demandes d'aide auprès du représentant de son syndicat, rien ne bougeait, comme si celui-ci était de connivence avec le patron de l'atelier. Et voilà que Che'mile, dans son intervention, avait "expliqué", lui dit-elle près de la petite table bancale où fumaient les deux verres de thé, la voie à suivre pour se mesurer à ces manques.
Car dans ces ateliers, l'ouvrier juif immigré, était considéré comme un sous-prolétaire, un de ce "lupen proletariat" dont parlaient Marx et Engels dans "Le Manifeste", ce petit livre lumineux que lui avait donné son père.
Le Syndicat avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ses ouvriers immigrés juifs qui faisaient ces boulots. "C'est un moment à passer, lui avait dit son représentant. En moins d'un an les sous-prolétaires trouvent un meilleur boulot, mieux payé, et le syndicat les prend alors en charge."
Mais Che'mile ne l'entendait pas ainsi, et à la fin de son intervention, il contraignit le Parti, par un vote à main levée, à s'occuper de ceux pour qui, en fait, il existait. Elle en fut épatée. Dorénavant, pour elle, nul autre que lui n'existait.
Le Bund avait fixé cette ligne de conduite, qu'exigeait d'appliquer Che'mile, à son congrès constitutif clandestin auquel participèrent 13 délégués des groupes socialistes juifs locaux. Ces 13 membres fondateurs, du 7 au 9 octobre 1897 de notre calendrier, s'étaient réunis dans le grenier d'une petite maison en bois dans un faubourg de Vilna.
Kremer, un de ces pères fondateurs avait résumé les buts du nouveau parti en ces termes : "Une union générale de toutes les organisations socialistes se fixera pour but non seulement la lutte pour les revendications politiques russes en général, mais aussi pour défendre les intérêts spécifiques des travailleurs juifs, et avant tout, le combat contre toutes les lois discriminatoires." Et venait alors la suite, lumineuse dans son analyse de la réalité juive telle que la vivaient Masha, She'mile et des milliers d'ouvriers juifs immigrés en France : "Car les ouvriers juifs sont opprimés à la fois en tant que travailleurs et en tant que Juifs." (3)
Six mois plus tard, le 1er mars (le 13 mars) 1898, sous l'impulsion du Bund, se tint à Minsk le congrès constitutif du parti social-démocrate russe. Le Bund y envoya Kremer, Mutnik et Katz. Il n'y eut donc pas de surprise. Le nouveau parti décida d'adopter les vues du Bund relatives à l'ouvrier Juif : "Il reconnaît (le parti social-démocrate) à chaque nationalité ou groupe ethnique le droit à la reconnaissance de son individualité propre par les autres nationalités ou groupes." (4)
Le parti russe accordait donc au Bund les pleins pouvoirs dans toutes les questions liées au prolétariat juif. De son coté, le Bund adhérait au programme du parti.
En un mot, c'est la voie à suivre qu'avait exigée Che'mile du Parti, lors de son intervention à la Réunion du Parti, Place de la République.
Mais Paris n'est pas Minsk, et les partis de la République ne pouvaient admettre en leur sein des factions. Depuis la Révolution, la hantise de la République, depuis la Première République de 1792, avait été les factions.
Aussi, aucun syndicat affilié à un parti républicain quelconque ne pouvait admettre qu'en son sein ne fonctionne une faction autonome. Tout au plus pouvait-il accepter qu'une commission "soumise" au Secrétariat, se chargeât des problèmes particuliers relatifs aux ouvriers immigrés juifs, selon une stratégie décidée par le parti.
Le Ghetto politique que voulait instituer en France le Bund n'avait aucune chance de se réaliser.
Les Français "autochtones" voyaient d'un mauvais œil ces tentatives, que menait le Bund, d'implanter dans certains quartiers juifs, comme celui du Marais, de Belleville, de la rue des Rosiers, de la Bastille, de la République, des ghettos juifs parlant yddish, vivant encore, après plusieurs années en France, comme s'ils habitaient le Shteitel. Ils croyaient fermement en la vertu civilisatrice de la République Française, cette vertu capable d'intégrer à la Nation française tout immigré qui en manifestait le désir sincère. Depuis l'abbé Grégoire et Napoléon ils s'étaient identifiés de tout cœur au principe qui, en France, accordait tout, aux Juifs en tant qu'individus, et rien, en tant que nation. Après la défaite de l'armée française à Sedan, en 1870, et la naissance de la Troisième République, nombreux parmi "Les optants", ces milliers de Français d'Alsace et de Lorraine qui avaient décidé d'abandonner leur maison et leurs biens et de passer en France afin de conserver la Nationalité française, étaient Juifs. L'article 2 du Traité de Francfort, qui stipulait, après l'annexion de ces deux provinces à l'Allemagne de Bismarck, que "Les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires, qui entendront conserver leur Nationalité française, jouiront jusqu'au 1er octobre 1872 [...] de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer", fut largement "exploité" par les Juifs français de ces provinces françaises annexées.
Dans son ouvrage "Les fous de la République" (rappel au fameux concept des Fous de Dieu) Pierre Birnbaum insiste sur "la dévotion" que portent à La Troisième République les Juifs qui s'y sont intégrés. "Cette République émancipatrice, rationaliste et soucieuse de progrès, écrit-il, ils entendent la servir de toute leur force [...] Ils l'aiment avec dévotion, propagent ses valeurs, se précipitent dans ses bras protecteurs." (5)
Mais qu'ils soient du Nord ou du Sud de la France, de Paris, de Bordeaux ou d'Avignon, les Juifs autochtones développèrent un certain dédain à l'égard de la vie de ghetto et du style de vie qu'avaient adoptés ses ouvriers juifs immigrés, adeptes du Bund.
Ils voyaient en eux tout ce qu'il fallait fuir, tout ce dont il fallait se "purifier" afin d'être reçus et embrassés par les bras grands ouverts que leur tendait la République. Aussi, l'antisémitisme dont ils étaient victimes était, à leurs yeux, compréhensible quoique blâmable.
Inconsciemment ces autochtones juifs subissaient l'influence de la presse antisémite et de ses chroniqueurs. Les chroniques de Maxime Ducamp de la fin du 19eme sont reprises, dans les années trente, avec malveillance. Il avait décrit les Juifs immigrés sans travail, comme :"Une plèbe famélique, vivant de grappillage, offrant des chaînes de sûreté et des pastilles de sérail le long des rues, trafiquant des cigares de contrebande qu'elle échangeait contre de vieux habits, marchands de lorgnettes d'occasion, chiffonniers aux environs de la Place Maubert, bouquinistes à la porte des collèges, brocanteurs, revendeurs de vieille ferraille et au besoin receleurs." (6)
C'était cette image qui accrochait encore l'imagination, trente ans plus tard.
Pour certains de ces Juifs autochtones, leur religiosité modérée et leur patriotisme inconditionnel commençaient même à les entraîner vers la droite. "Un jour de 1934, écrit Wladimir Rabi, le Consistoire de Paris s'avise de célébrer un office à la synagogue de la rue de la Victoire à l'occasion de rassemblement de Croix de feu : c'est un beau tollé dans la presse juive immigrée, mais le fait est révélateur d'un certain glissement. La même année, se crée une Union patriotique des Français israélites, dont le but déclaré est de protéger les autochtones contre les Juifs "un peu voyants". (7)
Les gens du Bund rejetaient ces critiques de ces Juifs autochtones qui avaient perdu, selon eux, leurs sentiments et leur conscience juives. Même leur solidarité juive, soutenaient-ils, avait été touchée, et le fameux "Kol Israël Haverim", source profonde de la connaissance de l'interdépendance juive, avait disparu de leur morale.
En tant que mouvement révolutionnaire, le Bund mettait tous ces manques sur le compte de leur Conscience de classe, plus que sur le compte de leur conscience nationale. La première d'entre elles, à leur entendement, était déterminante. Dans l'affaire du prédicateur juif, engagé par la police afin d'exhorter les grévistes juifs d'une manufacture de tabac de Vilna, en 1896, de cesser la grève, le manifeste publié par le groupe social-démocrate de Vilna, devenu Bund un an plus tard, "Der shtot maguid", n'avait-il pas déclaré : "Le peuple juif est divisé en deux classes dont l'hostilité est si grande que même la sainteté du Temple ne peut l'arrêter". (8)
Lire la suite dimanche
Bibliographie :
(3) Henri Mincszeles "Histoire générale du Bund un mouvement révolutionnaire juif", p. 61, Paris, 1995.
(4) Ibidem, p. 64.
(5) Pierre Birnbaum, Les fous de la République Histoire politique des Juifs d'Etat de Gambetta à Vichy, p. 8, Paris, 1992.
(6) Béatrice Philippe, Les juifs à Paris à la belle époque, p. 49, Paris, 1992.
(7) Wladimir Rabi, in Histoire des Juifs en France, ed. Bernard Blumenkranz, p.376, Paris, 1972.
(8) Henri Minczeles, p. 47, Paris, 1995.
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 24 octobre 2008, 03:15 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 238 |
Une nouvelle de Reuven (Roger) Cohen
3ème et denière partie.
C'était de ces idées que s'alimentait, She'mile. C'étaient ces citations qui ornaient ses interventions, le samedi, à la Réunion du Parti. C'étaient elles qui régalaient ses camarades, c'était la vibration de sa voix, quand il les prononçait, qui faisait chavirer Masha.
Le Secrétaire et les membres du Bureau politique essayaient bien d'adapter la voie du Parti à la réalité française. Ils voyaient bien que les démarches adoptées au vote à main levée, sous l'effet d'un enfermement moral, d'une nostalgie sans lendemain d'un retour aux principes du passé, que préconisait She'mile, n'avaient aucune chance de répondre aux problèmes présents, qu'il n'y avait là qu'une utopie. Ils voyaient bien que certains ouvriers immigrés juifs avaient compris que la France n'était pas la Pologne. Ils les voyaient s'efforcer de fuir leur statut d'ouvriers immigrés, que célébrait le Bund comme la souche des lendemains qui chantent, pour s'installer à leur compte, ouvrir un petit commerce, gravir les échelons qui les mèneraient au stade de la petite bourgeoisie libérale, que conspuait le Parti.
Mais rien n'y fit. La souffrance quotidienne de ces ouvriers immigrés était si grande qu'ils se refusaient à renoncer à leurs codes de lecture de la réalité. Ils ne saisissaient pas que ceux-ci voilaient celle-la, plus qu'ils ne l'éclairaient. Ce drame, que connaît toute religion, tout "parti révolutionnaire", qui avaient fixé une fois pour toutes les cadres et les concepts de leurs relations à la réalité quotidienne, n'était-il pas semblable à celui de la Commune de Paris, lorsque les communards Delescluze, l'ancien de 1848, et Rigaux, le jeune, s'étaient faits massacrés derrière des barricades d'un autre âge, voués aveuglement aux codes des Journées révolutionnaires de 92 et de 48 ?
Aussi, pour les gens du Bund, ce qui avait guidé les aînés dans le passé, continuait à être valable au présent et donnait un sens à leur quotidien. C'est ainsi qu'ils continuèrent à s'élever contre le Sionisme dans les années trente, à Paris, comme jadis l'avait fait le Parti à l'orée du 20ème siècle, dans les derniers jours de mai 1901, à Bialystok, lors de son quatrième congrès.
Pour le Bund, le Sionisme était un mouvement réactionnaire, et son fondateur Théodore Herzl n'avait eu aucune pensée sincère à l'égard du prolétariat Juif. Certes il y avait bien eu, à la fin du 19ème siècle, Nahman Syrkin, qui avait essayé de relier les idéaux socialistes au Sionisme et avait préfiguré ces Marxistes implacables qu'avaient été Ber Borochov et le parti Poalei Tsion.
Mais ceux-ci, avec leur obsession d'un territoire juif et du retour des Juifs sur la Terre de leurs ancêtres, en Palestine, exaspéraient les idéologues du Bund, à les haïr. Ce mouvement crée par la petite bourgeoisie, pensaient-ils, ne pouvait engendré qu'un "socialisme bourgeois". Or, n'était-il pas dit, par raillerie, dans le Manifeste du Parti communiste : "Le socialisme bourgeois tient tout entier dans cette affirmation que les bourgeois sont des bourgeois - dans l'intérêt de la classe ouvrière".(9)
Aussi, le Bund avait-il déclaré à ce quatrième congrès : "Le congrès considère le Sionisme comme une réaction de la classe bourgeoise contre l'antisémitisme et la situation anormale du peuple Juif. [...] Le Sionisme politique érigeant pour but la création d'un territoire pour le peuple juif ne peut prétendre résoudre la question juive [...] ni satisfaire le peuple dans son ensemble [...] et demeure une utopie irréalisable. Le congrès estime que l'agitation des sionistes compromet le sentiment national et peut-être un frein au développement de la conscience de classe [...] Que ce soit dans les organisations économiques (caisses) ou politiques (sections bundistes), il ne faut pas admettre les sionistes."(10)
Ces deux partis se haïssaient comme des frères ennemis. Ils avaient trop de points communs idéologiques pour que l'un supportât la présence de l'autre. Mais par rapport à ce qui les rapprochait, ce qui les séparait était insurmontable.
Aux Juifs menacés par l'antisémitisme, ils promettaient tous deux une solution radicale qui devait régler leurs problèmes au présent comme au futur. Les deux solutions se disputaient l'avenir du peuple en tant que Nation et en tant que soumis au processus de prolétarisation qui était en train de changer, à leur avis, la face du monde.
Pour le Bund le retour du peuple prolétarisé sur la Terre de ses ancêtres était une pure utopie. Elle mettait en danger l'organisation d'une solution viable pour la Nation Juive.
Pour Borochov et le Poalei Tsion, le Bund ne pouvait prétendre représenter un mouvement de la classe ouvrière. Les quelques ouvriers disséminés dans de petites entreprises ne représentaient pas un prolétariat capable de tenir tête aux représentants du capitalisme et à l'Etat bourgeois. La seule solution envisageable était l'auto émancipation du peuple et la création d'un Etat Juif socialiste. "Renaissance juive et socialisme marchaient de pair". (11)
Borochov soutenait qu' "Eretz Israël était le meilleur pays pour les Juifs et qu'il n'en existait pas de meilleur (à moins de le prouver). Il était historiquement celui des Juifs".(12)
Des années plus tard, après la shoa, Masha et Che'mile, chacun de leur coté, essayaient encore de persuader leurs enfants et petits enfants que la solution du Bund était toujours la seule solution viable, et que le départ des Juifs de France vers Eretz Israël était une erreur, qu'ils ne pardonneront jamais au sionistes qui les avaient enrôlés dans ce but.
La pluie a cessé.
Une petite éclaircie se dessine entre les nuages. On a plié les parapluies et je peux à présent discerner les visages, reconnaître parmi les militants du Bund qui se tiennent encore en rangs serrés, Moïche, Rivkalé et Sarah. Je découvre, non loin de la famille, des personnages importants comme Basheviss Singer, Lanzman, et d'autres encore qui ont modelé l'esprit juif en France.
Le fils aîné de Che'mile s'apprête à lire le kaddish, alors que le soleil pointe entre les nuages comme pour faire honneur, lui aussi, à celui qu'on met en terre. Comme un bruissement de feuilles mortes, un frisson de tristesse parcourt la foule. Je serre la main de Dana, pris, moi aussi, d'un tremblement que je ne parviens pas à maîtriser. "Tu ne vas pas te trouver mal me souffle-t-elle à l'oreille, avec un petit sourire".
Dana m'a piloté à Bagneux. Elle m'avait promis de m'accompagner à cet enterrement qui me fait revivre le passé et ma controverse de sioniste avec les gens du Bund, avec Che'mile en particulier. J'étais plus jeune que lui de plusieurs années et je ne partageais pas ses conceptions figées, sur le peuple juif, sur le sionisme, sur le socialisme. Mais j'aimais polémiquer avec lui.
Elle savait quelle émotion m'avait étreint quand j'avais appris son décès. "C'est tout un pan de ma vie personnelle et publique qui disparaît avec lui, lui avais-je dit au téléphone. Tu sais que j'ai toujours vu en lui un véritable intellectuel, du genre qu'évoque Emmanuel Lévinas dans son livre Difficile liberté.
Et je lui avais énoncé la citation que je connais, bien entendu, par coeur : "Les intellectuels en tant qu'intellectuels, quand ce sont de vrais intellectuels, ont pour mission de dégager et de mesurer les possibles que libèrent les glissements de sens annonçant des glissements de terrains [...]". (13)
Dana a été pendant des années mon élève. Nous avons gardé le contact. Elle vient écouter de temps en temps mes conférences. Je lui refile les bouquins que j'écris, mes articles qui paraissent dans les revues juives. Mais elle a depuis longtemps abandonné son activité au sein de la communauté, et ne se consacre qu'à son art et à sa famille.
Le fils aîné de Che'mile termine de lire le Kaddish, signe que la cérémonie prend fin.
C'est alors que nous sommes témoins d'une scène surréaliste comme on n'en voie plus ! Les gens du Bund déplient un grand étendard rouge où est brodé en lettres d'or et en Yddish son appartenance, et, d'une seule voix claire et puissante, ils entament l'Internationale, en Yddish.

D'une seule voix claire et puissante, ils entament l'internationale
Le public reste bouche bée et n'ose bouger de sa place. Mu par je ne sais quel ressort, je me joins à eux, m'accorde à leur ton et à leur cadence, mais la chante en français, comme lors de nos manifestations. Eux en yddish, nous en français. L'hymne terminé, je serre des mains, reconnais encore d'autres bundistes, parle de Che'mile. Mais Dana s'approche de moi, me prend par le bras et m'entraîne. "La séance de nostalgie est terminée, me souffle-t-elle à l'oreille, il se fait tard et il faut que je rentre."
Sur la route du retour à Paris, le silence est lourd. Les souvenirs affluent en trombes. Soudain je me mets à chanter le refrain de l'internationale "C'est la lutte finale...".
"Ah non, s'écrie Dana, tu ne vas pas nous remettre ça !" Nous explosons les deux de rire. J'entends le rire sarcastique de Che'mile sur le siège arrière de la voiture, comme lorsque je me faisais rabrouer. Je tourne la tête instinctivement, essayant de discerner son visage à l'arrière de la voiture. Dana me fixe étonnée.
"Tu cherches quelque chose, me dit-elle ?
"Je lui réponds, ce n'est rien, des souvenirs."
Bibliographie :
(9) Marx Engels, Manifeste du Parti communiste, p. 85, Paris, 1972.
(10) Henri Minczeles, p. 78, Paris, 1995.
(11) Henri Minczeles, p. 268, Paris, 1995.
(12) Ibidem, p. 269.
(13) Emmanuel Levinas, Difficile liberté, p. 364, Paris, 1983.
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 25 octobre 2008, 11:54 |
Modérateur Membre depuis : 18 ans Messages: 4 016 |
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 04 novembre 2008, 10:36 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 11 160 |
‘...I’je ye ouldi nem’chiou nââ'mlou Ménè Ménè... !*
(Viens mon fils, allons faire une promenade.)
Ou alors…
‘…I’je en h’attec fouq el kass’riya**
(Viens t’asseoir sur le pot.)
Aujourd’hui Méne Ménè est révolu
Kass’riya manque de pot aussi.
Quoique parfois je disais à Sharon.
‘...I’je en hateq fouq el kass’riya... !’
Et sa maman me répliquait...
‘...Mais enfin papa tu te crois où... ?’
Où me croirais-je hein les amis... ?’
Avec ma kass’riya, ce mot encore vivant dans mon palais de vieilles poteries.
La kass’riya de chez nous ne ressemble plus au pot français.
J’ai donc francisé ma kass’riya en pot.
‘...Viens ma chérie t’asseoir sur le poOOOt... !’
Je la faisais asseoir et j’attendais.
‘...Alors Chérie, tu as descendu ton petit qallouss... *?’
‘...Mais enfin Papa, qallouUUUUUss, encore ces mots là... !’
‘...Je dis quoi alors Doris... ?’
‘...Comme tout le monde.... pas QALLOUSS...!’
‘...Et c’est quoi ‘Qallouss’ comme tout le monde... ?’
‘...Un petit caca... !’
‘...Alors ma chérie tu as fais ton PETIT CaaaCAAAA.. ?’
Elle me regarde, se lève avec La forme du pot imprimé sur ses petits fesses.
‘...Caca et Pipi, Papi...’
'...Ah deux en un, avec des vers que tu me les as faits en pluUUs, alors i'jjé nem'chah'leq termiq...*
'...EncoOOOOOre...!!!
J'ai de la chance d'être encore chez moi.
.Kass’riya en judéo arabe, langue barbare égale pot.
.Qallouss petit caca.
.'...Viens que je t'essuie le cul cul.
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 09 novembre 2008, 09:37 |
Membre depuis : 15 ans Messages: 113 |
Mardi avant l'aube, nous avons été aux urgences, Vivi s'étant senti mal. A quatre heures il a été décidé de l'hospitaliser par les médecins, quelques minutes après notre arrivée. Sa sturation est tombée à 76 et le pouls est monté à 105.
Branché au Bibap, la saturation est remontée à 100 et le pouls a battu normalement.
Nous sommes rentrés à 20 heures préparer un repas rapidement et le gober tout aussi vite.
C'était une longue journée.
Dans la chambre nous avons rencontré le voisin de lit de Vivi, un certain B. natif de Djerba, qui nous a raconté ses visites chez un ami F. N. célibataire habitant l'Immeuble Tak-Tak près du marché Central à Sfax. Avec F. N. il pouvait prendre contact avec les jeunes dulcinées de l'époque, 1950.
Mais le fils de B. est venu le voir à l'hôpital et B. ne parlait plus à la première personne du singulier, mais il disait : " J'ai un ami qui a fait ceci et cela… qui a dit… etc." Mais son fils n'était pas dupe et il nous a dit qu'il connaissait toutes ces anecdotes, depuis belle lurette.
A quinze heures B. a été libéré et je l'ai vite regretté parce qu'il a été remplacé par un ex - Gabésien U. qui criait tout le temps ; " Je veux mes savates, où sont-elles ? "
Voulant être gentil, j'ai cherché et retrouvé ses babouches, sur le rebord de sa table de nuit. En guise de remerciements, il m'a promis que : " lorsque mon fils sera là, tu verras de toutes les couleurs "!
Ensuite il m'a ordonné d'ouvrir le paravent donnant sur le lit de Vivi, qui n'était pas d'accord et s'est vu obligé de changer de lit, pour être éloigné du furieux Gabésien.
Le quidam m'a reordonné d'ouvrir le paravent sinon, il a menacé de le mettre en pièces, et moi aussi. Sa femme est venue plus tard et il l'a envoyée parler aux médecins qui ne l'ont pas soigné à ses dires.
Plus tard, il s'est plaint à son fils qu'il n'a pas pris son bain. Toutes ses jérémiades n'étaient pas fondées, d'après le personnel.
Le soir j'ai quitté cette famille avec des souhaits de prompt rétablissement. Je leur ai dit que je suis de Sfax et que je connais Gabès où habitait mon oncle. La mère et le fils ont enfin sourit et la maman m'a dit connaitre mon tonton et elle a reconnu les noms des personnes, de sa ville, que j'ai cités.
J'étais heureux, car en les mettant à l'aise, je contribuais au calme dans la chambre, les malades ayant besoin de tranquillité.
Nous avons souhaité une bonne nuit à Vivi qui a eu de nombreuses visites, celle de mon cousin Alexandre et de sa femme Rachel, de mes filles Osnath et Shir et de mon petit fils Moshé. Ma sœur Viviane et son mari Yossi nous ont remplacés auprès de lui. A minuit, il a été branché au Bipape.
Le mercredi le Gabésien était plus calme. Nous l'avons aidé à s'assoir pour manger, avons cherché sa calotte tombée au bas du lit et nous lui avons fourni une cuvette d'eau et une serviette pour se laver et s'essuyer les mains.
Un nouveau venu L., un peu fou a servi de distraction au Gabésien. Il m'a dit qu'il compte se marier dans deux mois, mais je ne le crois pas.
L. s'en allait souvent sans se débrancher de ses appareils et tuyauteries, ce qui lui causait des coupures dans les bras et le sang coulait... Il fallait le ratrapper, le rebrancher, soigner ses plaies et nettoyer le sang. Des fois, changer les draps imbibés se sang.
La vieillesse est ingrate pusqu'elle cause tant d'ennuis aux vielles personnes.
D'un autre côté, mercredi matin on m'a téléphoné du service technique du centre médical et on m'a annoncé que le Bipap (s'écrit aussi Vpap, tout dépend de la firme qui le met au marché) sera mis à nôtre disposition ces jours ci. Cet appareil intelligent réapprend aux poumons à fonctionner d'eux-mêmes et s'adapte à la quantité d'oxygène présente dans les voies sanguines.
J'ai été signer un engagement au montant du coût de l'appareil, avec un second témoin. Le Bipap a été fourni à Vivi jeudi après midi. Il en a appris le fonctionnement et a dû rester encore une nuit à l'hôpital afin de prouver au personnel qu'il s'en tire assez bien.
Vendredi Vivi a été libéré et il se trouve à la maison. Le Bipap est branché pendant la nuit seulement. D. merci çà va mieux.
Mes frères et amis, je vous souhaite d'être en bonne santé tout le temps et que je ne n'entende de vous que des bonnes nouvelles. Bsoroth Tovot.
Amitiés de nous trois.
Camus
Rien ne me fait plus plaisir, que de faire plaisir: signé Vivi il Diavolo
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 09 novembre 2008, 22:42 |
Membre depuis : 18 ans Messages: 1 445 |
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 10 novembre 2008, 10:05 |
Membre depuis : 15 ans Messages: 113 |
merci avous les amis et pour vous prouver ma reconnaissance voilà le début de mon séjour a l'hôpital
Merci a Gisèle, Camus et Viviane qui ne m'ont pas lâché d'un pouce pendant ces mauvais moments.
Avant de commencer je voudrais dire que si quelqu'un croit se reconnaître je dirais que toute ressemblance est possible, bien que j'ai tous fais pour illuminer toute options de reconnaissance, en allant jusqu'à changer le nom du centre médical Soroca a un simple hôpital au nom de Sirote la. Les personnages sont réels les faits aussi. Ainsi que les premières lettres de leur noms.
Vivi hospitalisé !
Ce que les nuits peuvent êtres dures certaines fois, il en était de même pour le lundi soir dernier. Une grande douleur me coupe la respiration, un calmant que j'avais pris une heure auparavant n'était pas de grande aide.
Ma belle sœur qui s'aperçoit de ma détresse, essaie de me venir en aide, en me préparant une inhalation, qui elle non plus ne porte aucune amélioration à mon état.
Il ne nous restait plus qu'à décider pour l'urgence de l'hôpital Sirote la ou appeler le médecin. Comme nous savons qu'il est difficile d'avoir un médecin à ces heures là, on choisit d'aller aux urgences. Camus aussi est déjà debout et habillé et se joint à nous. Pendant que Gisèle garait la voiture, Camus est allé ouvrir un dossier et m'a confié à une infirmière qui m'a conduit à la salle d'attente. L'infirmière me voyant traumatisé me demande si c'est le cœur ou autre chose ? Tout en prenant la saturation elle m'allonge sur un lit et m'emmène directement à l'urgence. Enfin je peux respirer après avoir été branché à un Bibap, appareil respiratoire, dire que j'étais a une saturation de 76% !
c'est au tour d'un électrocardiogramme, radio et après çà en m'embarque direct a la section interne "A".
Voila Vivi peut enfin respirer, se reposer et peut être dormir un peu avec un peu de chance.
Camus et Gisèle ne veulent pas partir avant de me voir enfin endormis. Le soleil brillait haut dans le ciel quand j'ai commencé à fermer les yeux.
Aller dormir comme il faut dans un hôpital, pour cela il vous faut être dur de caractère ou bien mort de fatigue. A chaque fois c'est telle ou telle infirmière qui vient à son tour prendre la tension, la température ou bien la saturation, pourquoi ne pas donner tout çà a une seule ?
Cela économiserait beaucoup d'argent a l'office et des forces a Vivi.
Enfin mes yeux se ferment. Mais pas pour longtemps malheureusement…….
Monsieur B (Brouclou)
Entre un petit somme et un autre, une dame s'adresse à mon voisin du lit gauche.
-- Bonjour Monsieur "B" je viens pour une prise de sang.
-- Une prise de sang ? Revenez dans une heure, je dois d'abord faire mes ablutions et prendre conseil avec le Bon D.ieu en le louant et prier pour ma santé. (De ma belle sœur j'apprends que c'était la troisième fois qu'elle vient le chercher)
Une heure après notre amie revient, pour la prise de sang, Monsieur B la voyant, demande:
-- Quoi vous insistez pour cette prise de sang ?
-- Bien sûr Mr, voulez vous vous allonger s'il vous plaît ?
-- M'allonger ? Que vous empêche de prendre cette prise de sang ? Vous allez la prendre de mes jambes ou ailleurs ?
-- Vous ne voulez pas tant pis, je ne perdrais pas mon temps avec vous et se retourne pour partir.
Un petit remord lui dit de se comporter un peu mieux envers cette infirmière. Et l'appelle : " infirmière, nurse revenez s.v.p. " !
-- Monsieur je ne suis ni infirmière et ni nurse, je suis médecin alors un peu plus de respect. (C'est comme même exagéré de traiter d'infirmière un médecin stagiaire "jid neuf").
Enfin attendri, notre ami se laisse faire, mais que diable voilà que le médecin commence à remplir une première éprouvette, la deuxième et la troisième… Notre ami n'en peut plus et commence à gueuler comme quoi qu'il n'est ni agneau et ni veau. Sur place, il ne demande pas plus et ni moins qu'a voir le directeur de l'hôpital pour éclaircir cette affaire.
Ce n'est qu'après une promesse de l'infirmière responsable que le médecin chef viendra le voir dans quelques instants, qu'il retourne au lit.
entre temps le voilà qu'il téléphone a son fils pour lui dire ce que l'hôpital veut faire a ses dépends.
Son fils étant un peu plus intelligents lui explique que pour différentes analyses il faut autant d'éprouvettes.
Pendant ces longues journées dans un lit il est normal que les malades font connaissances, c'est comme cela que nous avons sus que notre ami B. était de Zarzis, d'ailleurs son accent le confirmait, qu'il était du sud tunisien.
--Tiens nous sommes voisins de salle et de ville moi je suis de Sfax lui jette Camus.
--Sfax, Sfax ! Que de nostalgie cela ramène en moi, figurez vous que j'avais un ami qui habitait l'immeuble Tac-tac avec qui je partageais mes aventures amoureuses.
Être âgé, veut dire des fois des fuites de mémoires et ce qui en était avec lui qui recommença à nous raconter ses prouesses près de son fils mais sans oublier cette fois de parler en tierce personne. (Comme par exemple je connais quelqu'un qui avait un ami…..) . Son fils n'avale pas çà et dit à Camus :
--Laisse le parler, je connais mon père et connais toutes ses histoires donc il ne peut rien cacher.
Biens sûr que l'infirmière avait tenu promesse, vers dix heures c'était l'heure de l'auscultation générale de la "session interne A" par les médecins, sous la direction du professeur C.
Mr B. Étant le dernier de la salle, était donc le premier à être visité par les médecins et derrière toute cette clique se trouvait notre stagiaire. La voyant Mr B lui fit un geste de venir, mais elle le connaissant déjà, fait un pas en arrière. Après deux appels il la persuada de venir vers lui pour, ô miracle demander pardon.
Ce qui n'empêche pas le professeur de dire :
-- Monsieur B. selon votre dossier et l'analyse de sang qu'on a effectué, la prise de sang que vous avez eu la grande gentillesse de donner à Madame, tout montre que vous êtes en très bonne santé. Donc vous pourrez quitter l'hôpital aujourd'hui même.
Monsieur U (Ubaldo)
Le lit de notre zarzisoi ne resta pas longtemps vide.
Trois heures après arrive un certain "U" (Ubaldo) encore plus sympa que le premier la suite le prouvera.
(A suivre....)
Rien ne me fait plus plaisir, que de faire plaisir: signé Vivi il Diavolo
Merci a Gisèle, Camus et Viviane qui ne m'ont pas lâché d'un pouce pendant ces mauvais moments.
Avant de commencer je voudrais dire que si quelqu'un croit se reconnaître je dirais que toute ressemblance est possible, bien que j'ai tous fais pour illuminer toute options de reconnaissance, en allant jusqu'à changer le nom du centre médical Soroca a un simple hôpital au nom de Sirote la. Les personnages sont réels les faits aussi. Ainsi que les premières lettres de leur noms.
Vivi hospitalisé !
Ce que les nuits peuvent êtres dures certaines fois, il en était de même pour le lundi soir dernier. Une grande douleur me coupe la respiration, un calmant que j'avais pris une heure auparavant n'était pas de grande aide.
Ma belle sœur qui s'aperçoit de ma détresse, essaie de me venir en aide, en me préparant une inhalation, qui elle non plus ne porte aucune amélioration à mon état.
Il ne nous restait plus qu'à décider pour l'urgence de l'hôpital Sirote la ou appeler le médecin. Comme nous savons qu'il est difficile d'avoir un médecin à ces heures là, on choisit d'aller aux urgences. Camus aussi est déjà debout et habillé et se joint à nous. Pendant que Gisèle garait la voiture, Camus est allé ouvrir un dossier et m'a confié à une infirmière qui m'a conduit à la salle d'attente. L'infirmière me voyant traumatisé me demande si c'est le cœur ou autre chose ? Tout en prenant la saturation elle m'allonge sur un lit et m'emmène directement à l'urgence. Enfin je peux respirer après avoir été branché à un Bibap, appareil respiratoire, dire que j'étais a une saturation de 76% !
c'est au tour d'un électrocardiogramme, radio et après çà en m'embarque direct a la section interne "A".
Voila Vivi peut enfin respirer, se reposer et peut être dormir un peu avec un peu de chance.
Camus et Gisèle ne veulent pas partir avant de me voir enfin endormis. Le soleil brillait haut dans le ciel quand j'ai commencé à fermer les yeux.
Aller dormir comme il faut dans un hôpital, pour cela il vous faut être dur de caractère ou bien mort de fatigue. A chaque fois c'est telle ou telle infirmière qui vient à son tour prendre la tension, la température ou bien la saturation, pourquoi ne pas donner tout çà a une seule ?
Cela économiserait beaucoup d'argent a l'office et des forces a Vivi.
Enfin mes yeux se ferment. Mais pas pour longtemps malheureusement…….
Monsieur B (Brouclou)
Entre un petit somme et un autre, une dame s'adresse à mon voisin du lit gauche.
-- Bonjour Monsieur "B" je viens pour une prise de sang.
-- Une prise de sang ? Revenez dans une heure, je dois d'abord faire mes ablutions et prendre conseil avec le Bon D.ieu en le louant et prier pour ma santé. (De ma belle sœur j'apprends que c'était la troisième fois qu'elle vient le chercher)
Une heure après notre amie revient, pour la prise de sang, Monsieur B la voyant, demande:
-- Quoi vous insistez pour cette prise de sang ?
-- Bien sûr Mr, voulez vous vous allonger s'il vous plaît ?
-- M'allonger ? Que vous empêche de prendre cette prise de sang ? Vous allez la prendre de mes jambes ou ailleurs ?
-- Vous ne voulez pas tant pis, je ne perdrais pas mon temps avec vous et se retourne pour partir.
Un petit remord lui dit de se comporter un peu mieux envers cette infirmière. Et l'appelle : " infirmière, nurse revenez s.v.p. " !
-- Monsieur je ne suis ni infirmière et ni nurse, je suis médecin alors un peu plus de respect. (C'est comme même exagéré de traiter d'infirmière un médecin stagiaire "jid neuf").
Enfin attendri, notre ami se laisse faire, mais que diable voilà que le médecin commence à remplir une première éprouvette, la deuxième et la troisième… Notre ami n'en peut plus et commence à gueuler comme quoi qu'il n'est ni agneau et ni veau. Sur place, il ne demande pas plus et ni moins qu'a voir le directeur de l'hôpital pour éclaircir cette affaire.
Ce n'est qu'après une promesse de l'infirmière responsable que le médecin chef viendra le voir dans quelques instants, qu'il retourne au lit.
entre temps le voilà qu'il téléphone a son fils pour lui dire ce que l'hôpital veut faire a ses dépends.
Son fils étant un peu plus intelligents lui explique que pour différentes analyses il faut autant d'éprouvettes.
Pendant ces longues journées dans un lit il est normal que les malades font connaissances, c'est comme cela que nous avons sus que notre ami B. était de Zarzis, d'ailleurs son accent le confirmait, qu'il était du sud tunisien.
--Tiens nous sommes voisins de salle et de ville moi je suis de Sfax lui jette Camus.
--Sfax, Sfax ! Que de nostalgie cela ramène en moi, figurez vous que j'avais un ami qui habitait l'immeuble Tac-tac avec qui je partageais mes aventures amoureuses.
Être âgé, veut dire des fois des fuites de mémoires et ce qui en était avec lui qui recommença à nous raconter ses prouesses près de son fils mais sans oublier cette fois de parler en tierce personne. (Comme par exemple je connais quelqu'un qui avait un ami…..) . Son fils n'avale pas çà et dit à Camus :
--Laisse le parler, je connais mon père et connais toutes ses histoires donc il ne peut rien cacher.
Biens sûr que l'infirmière avait tenu promesse, vers dix heures c'était l'heure de l'auscultation générale de la "session interne A" par les médecins, sous la direction du professeur C.
Mr B. Étant le dernier de la salle, était donc le premier à être visité par les médecins et derrière toute cette clique se trouvait notre stagiaire. La voyant Mr B lui fit un geste de venir, mais elle le connaissant déjà, fait un pas en arrière. Après deux appels il la persuada de venir vers lui pour, ô miracle demander pardon.
Ce qui n'empêche pas le professeur de dire :
-- Monsieur B. selon votre dossier et l'analyse de sang qu'on a effectué, la prise de sang que vous avez eu la grande gentillesse de donner à Madame, tout montre que vous êtes en très bonne santé. Donc vous pourrez quitter l'hôpital aujourd'hui même.
Monsieur U (Ubaldo)
Le lit de notre zarzisoi ne resta pas longtemps vide.
Trois heures après arrive un certain "U" (Ubaldo) encore plus sympa que le premier la suite le prouvera.
(A suivre....)
Rien ne me fait plus plaisir, que de faire plaisir: signé Vivi il Diavolo
|
Re: *****EN DIRECT DE LA SALLE VIVI DIAVOLO....CAMUS...FREDDYB..LES TROIS FRERES REUNIS..5X5***** 18 novembre 2008, 10:58 |
Membre depuis : 16 ans Messages: 11 160 |
Ma belle et fière consciIIence
Merci de m’être toujours fidèle
Mon alliée ma compaAAAgne
Toujours honnête envers moi
Je ne t’ai jamais prise à défaut
Et tu ne m’as jamais trompéEEEEe.
Ma belle consciIIence
Tu commandes mes acCCtes,
Tu me dictes tes volontés
Et jamais tu ne m’as trahie.
C’est toi qui choisie mes voies mes chemiIIns
Ma belle conduite que l’on se le dise
Elle ne s’est jamais départie
De ma confiaAAAnce.
Ma belle conscieEEEEnce
Imagine- toi vieilliIIIr
Et que me lâcheeEEEr
Aux trois quart de ma vie
Serait bien pire qu’un amour déçu.
Adieu ta fraicheuUUr et ma joie de vivre.
Dois-je donc te chercher AILLEURS
Une belle compagne, une associée
Bien jeune et bien jolie pour te seconder,
Lorsqu’un matin tu me trahiras.
A toi qui me lit, sans que te cite
Toi qui as perdu ta conscience
A un âge loin d’être aigrie.
Comment as-tu osé, trahir ton amie,
Aurais-tu donc perdu, ta raison
Et toute notion de discrétion.
Car tu as failli aux règles d’amitié
Tu t’es permise, toi la fausse actrice
De parler au nom de celle qui ne t’a rien permis.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des messages dans ce forum.