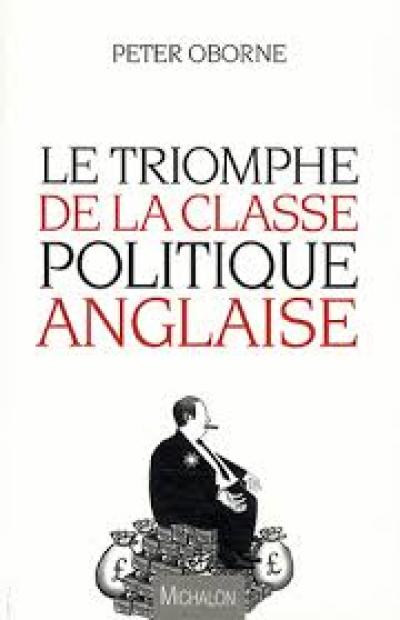
La Défaite de la politique
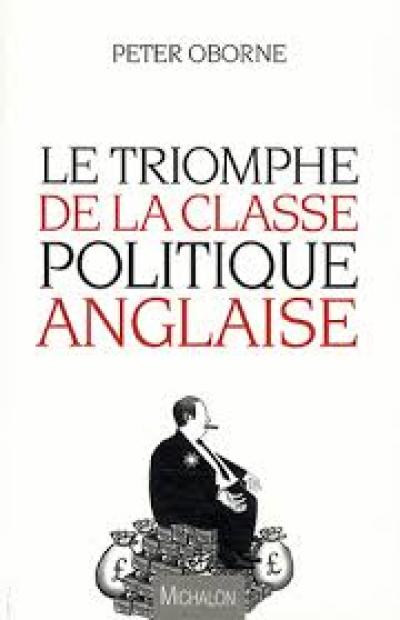
La Défaite de la politique(info # 012304/14) [Analyse]
Par Llewellyn Brown©Metula News Agency
Le déclin actuel de la France sur les plans économique et sociétal ne va pas sans sa part de bouffonnerie sous la gouvernance de François Hollande. La promesse d’offrir au pays un « gouvernement exemplaire » s’est concrétisée par un pot-pourri d’ « affaires », témoin l’exemple spectaculaire du ministre des Finances, Jérôme Cahuzac, jurant solennellement devant l’Assemblée nationale qu’il n’était titulaire d’aucun compte en Suisse. Un mensonge rapidement démasqué, sans que son auteur perdît un instant de son arrogance.
La “première concubine” étalant ses états d’âme par des tweets, s’est vue éclipsée un temps par la “première maîtresse” ; puis les deux fonctions ont pris subitement pris fin par la décision souveraine du chef de l’État (on doit supposer qu’il s’agissait de deux CDD…).
Cette déconfiture du domaine politique ne date pas d’hier : elle devient seulement plus éclatante, suscitant l’étonnement de citoyens et de commentateurs. Un livre récemment traduit et publié en France rend cet état déliquescent des affaires publiques bien plus clair pour notre compréhension. Il s’agit de l’ouvrage du journaliste anglais, Peter Oborne, intitulé Le Triomphe de la classe politique anglaise1. Son analyse très fine, et étayée par une longue expérience, jette une lumière impitoyable non seulement sur la politique d’outre-Manche, mais sur la maladie qui affecte la vie politique des pays occidentaux dans leur ensemble.
Oborne montre comment un changement radical s’est produit dans la vie politique anglaise, renversant les structures établies au cours du XIXème siècle. En effet, les réformateurs de l’époque victorienne se sont efforcés de maintenir une distinction très ferme entre l’intérêt général et les intérêts particuliers, entre public et privé. Jusqu’à récemment, les hommes politiques et les partis étaient encore profondément ancrés dans la population et les provinces. Cependant, commençant par Margaret Thatcher et Tony Blair (créateur du “New Labour”), des “réformateurs” ont sévi, détruisant cette structure. Ils ont engendré une véritable classe de carriéristes et de profiteurs, coupés de la vie du peuple et hostiles aux préoccupations de ceux qu’ils sont supposés représenter.
L’Establishment – au cœur de l’ancien système – a ainsi succombé aux attaques conjuguées des économistes radicaux, sur la droite, et de la révolution sociale et culturelle, sur la gauche : groupes qui sont tous deux adversaires de l’autorité et de la tradition. Dès lors, le mot à la mode est “modernisation”, un terme qui respire l’optimisme, la croyance dans le progrès mais qui, en réalité, exprime les dictats de l’économie et du marché, régis notamment par la mondialisation et le capitalisme financier.
Ce qu’on appelait l’Establishment – une classe fondée essentiellement sur l’hérédité – était composé d’hommes dévoués à leur fonction. Quand ils quittaient celle-ci, c’était pour occuper d’autres fonctions auprès du peuple. Ils ne tiraient, le plus souvent, aucun bénéfice financier de leur poste, bien au contraire. Les hommes politiques se concevaient comme de modestes serviteurs au service d’idéaux et d’institutions légués par la tradition, et qu’ils avaient le devoir de perpétuer. De nos jours, le politicien estime être à l’origine de lui-même, et au service de sa seule carrière : les institutions sont de simples outils dont il se sert librement. Loin de s’effacer derrière sa tâche, il est convaincu de sa propre importance.
Les diverses institutions traditionnelles formaient alors autant de contre-pouvoirs qui protégeaient l’individu contre l’État. Les hommes politiques actuels, en revanche, les haïssent parce qu’elles entravent l’exercice de leurs pouvoirs ; d’où leur propension à jeter le discrédit sur elles, leur refus de se plier à leurs règles.
Ainsi, alors que la bourgeoisie et les classes populaires doivent leur propre montée en puissance à l’action du parlement, la classe politique délaisse ce dernier, réservant ses annonces importantes aux media, aux fins de mieux contrôler l’opinion publique. L’auguste chambre des Lords – à l’origine une institution héréditaire – permettait une révision approfondie des projets de loi, avec le concours de pairs disposant de connaissances et d’expériences spécialisées. Actuellement, la chambre est envahie de pairs nommés à vie (telle que la controversée Catherine Ashton), sous l’influence des coteries ou groupes de pression : les politiques aiment à jouir du prestige des Lords, mais ne tolèrent pas ses contrepoids.
Les instances dirigeantes sont désormais perméables à l’économie et aux activités commerciales, et les hommes politiques exploitent leur position à des fins d’enrichissement personnel. Naguère, les indemnités accordées aux politiques n’étaient pas suffisantes pour vivre : une autre source de revenus était indispensable et, dès qu’ils n’étaient pas réélus, les politiciens retournaient à leur vie de citoyen ordinaire. Maintenant, ces derniers perçoivent un salaire. Ils font carrière comme n’importe quel employé ; ils exigent donc que leur rémunération soit conséquente, et entendent rester à leur poste le plus longtemps possible. Les indemnités qu’ils perçoivent constituent une source de profit : une allocation pour l’hébergement, par exemple, sert à l’achat de résidences secondaires, ou à la spéculation sur le marché de l’immobilier.
Les partis ont subi le même déclin que les institutions, et ne représentent plus leur base traditionnelle. Les financements privés remplacent la contribution des adhérents : les conférences annuelles, par exemple, servent uniquement aux rencontres entre hommes d’affaires et politiciens. Les places à la chambre des Lords sont à vendre, ainsi que les honneurs. Dans ces affaires antidémocratiques, tous les partis trouvent leur compte ; aucun ne s’y opposera : l’intérêt vénal qui les réunit est plus important que leur supposée opposition idéologique.
Ce qui importe à la classe politique, c’est la communication, la maîtrise de son image, la démarche publicitaire dans le but de manipuler l’opinion publique. La parole n’a plus qu’une valeur marchande : maniant un lexique vertueux et convenu, l’homme politique ne s’estimera pas tenu d’assumer les conséquences de ses dires face aux démentis de la réalité. Adoptant un ton moralisateur, les hommes politiques veulent faire croire que les membres de leur classe ont le monopole de la vertu. Ils ont beau jeu, puisqu’ils bénéficient d’un régime de faveur que l’on refuse au citoyen ordinaire : ils savent bien qu’on ne leur tiendra pas rigueur pour leurs erreurs ou pour leurs mensonges. Il en allait autrement par le passé : si l’homme politique d’hier échouait ou était reconnu coupable d’abus, il démissionnait aussitôt. Celui d’aujourd’hui se contente d’en rejeter la responsabilité sur ses subordonnés.
Sous ce système, aucun débat d’idées n’est possible. Autrefois, on soutenait la doctrine du parti, et si l’on osait s’y montrer réfractaire, on était accusé de trahison. Aujourd’hui, la classe politique est hostile aux grandes idées : toute proposition audacieuse est vigoureusement écartée. Les hommes politiques conçoivent les idées comme des produits de consommation de masse, comme des armes dans la campagne électorale, non comme annonçant un projet à mettre en œuvre. De là vient la pratique électoraliste de la triangulation : l’homme politique cherche à occuper le centre dans le débat, pour accuser (faussement) ses adversaires de tenir des positions “réactionnaires” ou “extrémistes”. La conséquence de cette tactique est que tous les partis – qu’ils soient ”de gauche” ou “de droite” – professent les mêmes idées, claironnent les mêmes slogans.
De la même façon, les programmes électoraux sont élaborés en fonction de l’opinion publique, dans le seul but de gagner. On analyse les attentes de l’électorat au moyen de logiciels permettant de cibler la part de la population qui déterminera le résultat final : seule cette population-là intéresse les directeurs de campagne, les autres électeurs sont ignorés. Ainsi, la vie de l’électorat ne trouve aucune expression de ses préoccupations dans les débats politiques.
La presse subit le même destin : au lieu de représenter un contre-pouvoir – comme les journaleux aiment à le prétendre –, elle est au service de l’élite. Les journalistes n’interprètent plus les événements, mais reproduisent ce que les communicants des dirigeants veulent qu’ils publient. Politique et journalisme sont désormais interchangeables : les deux classes partagent le même niveau social (bourgeois) et les mêmes idées. Ensemble, ils assurent le maintien du système qui assure leur statut de privilégiés.
Dans cette esquisse du déclin de la politique anglaise, on reconnaît les mécanismes qui sont également à l’œuvre dans la vie politique française. Assurément, l’analyse d’Oborne met en évidence la face noire du capitalisme postmoderne. Etant à vendre au plus offrant, les hommes politiques actuels ne prendront jamais le risque de réaliser un acte vrai qui risquerait de provoquer une transformation des événements. Ils continueront à ménager leur propre confort, se conformant aux résultats des sondages et aux vœux de ceux qui les financent.
C’est dire qu’aujourd’hui, il n’existe plus d’autre – Etat, nation, patrie – au nom duquel on puisse accomplir des actions nobles : on ne dispose plus de ces idéaux au nom desquels l’homme d’Etat pouvait, à l’occasion, réclamer le sacrifice des citoyens, ou se sacrifier lui-même.
Comme on le voit déjà chez les domestiques de Molière, et comme Voltaire le prônait2 : l’échange monétaire abolit toute nécessité de s’affronter ou de se sacrifier ; on préfère survivre, et jouir à l’infini de tous les objets que le capitalisme nous offre. Nous vivons sous le régime de la tolérance, et nous devons tout accepter, sous peine de remettre en cause le mythe du progrès. Pour le capitalisme actuel, l’appartenance ethnique, la tradition, doivent être abolies au nom du sujet abstrait, mondialisé, consommateur apte à faire tourner la machine. Derrière cette liberté et cette disponibilité affichées, l’homme est au service de l’économie, et non l’inverse. Un seul exemple frappant : l’achat obligatoire de produits informatiques constamment mis à jour, et qui rendent ainsi les anciennes versions caduques…
En retour, on perd tout ce qui mériterait que l’on se sacrifie pour lui : on vit enchaîné à son auge. Voilà ce à quoi nous convie notre classe politique ; et ce à quoi s’opposent certains mouvements citoyens, dont nous avons vu l’ampleur, au cours de ces derniers mois. En effet, le rejet massif du mariage homosexuel s’est vu stigmatiser, par les bien-pensants, comme l’expression d’un esprit dangereusement réactionnaire. Ce que ces derniers n’ont pas voulu voir – y compris les psychanalystes, dont c’est pourtant le métier d’interroger les formes du malaise dans la civilisation –, c’est à quel point il s’agissait d’un symptôme témoignant de l’abandon, par les hommes politiques, de leur mission de favoriser un lien vivifiant en société, non de collaborer à la dissolution de celle-ci. Décidément, les anciens de Mai 68 – les nantis d’aujourd’hui – conspuent avec véhémence ceux qu’ils voient comme les nouvelles “classes dangereuses” !
Notes :
1 Peter Oborne, Le Triomphe de la classe politique anglaise, traduit de l’anglais par Olivier Collomb, Paris, Michalon Éditeur, 2014. La quatrième de couverture offre une notice biographique : « Peter Oborne, chroniqueur politique dans The Daily Telegraph et rédacteur-adjoint de The Spectator, est l’une des plus importantes signatures du journalisme britannique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages salués outre-Manche pour leur critique des mécanismes du pouvoir et du discours politique. »
2 « Qu’à la bourse d’Amsterdam, de Londres […] le juif [sic], le mahométan, le déicole chinois […] trafiquent ensemble : ils ne lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des âmes à leur religion. » (Voltaire, Dictionnaire philosophique, éd. R. Naves et O. Ferret, art. « Tolérance », Paris, Classiques Garnier, 2008, p. 375).
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Commentaires récents
il y a 14 semaines 1 jour
il y a 20 semaines 4 jours
il y a 22 semaines 2 jours
il y a 29 semaines 5 jours
il y a 32 semaines 6 jours
il y a 46 semaines 6 jours
il y a 49 semaines 4 heures
il y a 49 semaines 1 jour
il y a 1 année 1 semaine
il y a 1 année 2 semaines