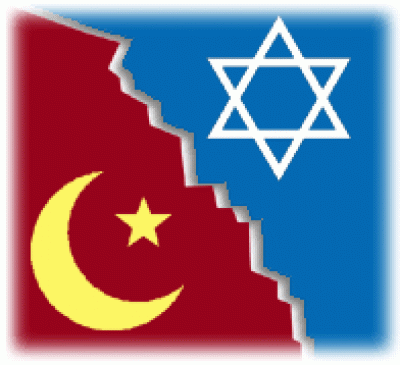
Judaïsme et Islam, choc de valeurs ou conflit politique ?
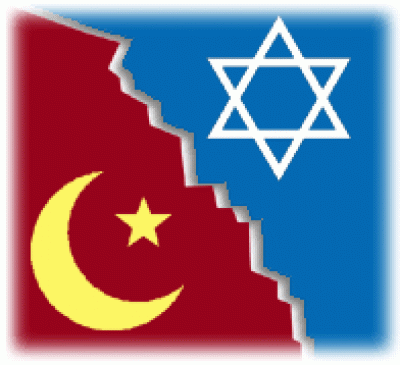
Judaïsme et Islam, choc de valeurs ou conflit politique ?
Entre Bible et Coran y aurait-il un choc de valeurs ? N'étant investi d'aucune responsabilité religieuse ou communautaire, je ne présente pas ici un point de vue officiel du judaïsme. Inversement les idées que je vais exposer n'ont pas de prétention à l'originalité, de sorte que ma contribution se réduit à un effort de synthèse : comment répondre à la question posée si on se situe dans la continuité de la tradition juive la plus classique, c'est-à-dire plus précisément de la tradition talmudique ? D'autre part, j'insiste sur le fait que mon propos ne concerne pas le conflit israélo-palestinien qui, sauf à tout mélanger, appartient à un autre horizon, l'horizon politique de deux peuples se disputant une même terre.
Tout d'abord existe-t-il entre judaïsme et islam un conflit d'ordre théologique ? La réponse est sans ambiguïté : un tel conflit n'existe pas. Depuis toujours, l'islam est compris par les Juifs comme un monothéisme strict, un monothéisme d'une pureté parfaite, l'antithèse par excellence de tout paganisme. Le judaïsme a toujours su distinguer christianisme et polythéisme. Il n'empêche que l'idée de l'incarnation divine, du moins dans sa connotation réaliste, est profondément étrangère à notre tradition et détermine un fossé qui ne peut être comblé. Un tel problème ou d'autres analogues n'existent pas dans nos relations avec l'islam.
Le fait suivant, rapporté par Léon Askenazi1, l'illustre parfaitement :
Un peu avant la création de l'Etat d'Israël, le Rav Kook avait été appelé à des discussions par les Anglais. Ils lui ont dit : «Comment vous, les sionistes, vous voulez revenir à Jérusalem ? Que va-t-on faire avec les musulmans ?» Il a répondu: «Quoi ? Il y a une mosquée. Et alors ? Grâce à Dieu, dans une mosquée, il n'y a pas d'idole et s'il y avait la paix entre les Juifs et les musulmans, nous les Juifs d'Israël, de Jérusalem, nous pourrions dire nos prières dans la mosquée, sur la montagne du Temple. Ce serait parfaitement casher. Les musulmans sont de vrais monothéistes.»
Il est frappant de constater que la quasi-totalité des grands théologiens juifs, notamment Saadia Gaon, Maïmonide, Ibn Gabirol, Juda Halévy, sont tous issus de pays musulmans et ont étudié et discuté les doctrines islamiques, reprenant éventuellement à leur compte certaines notions ou arguments, quitte à indiquer avec telle ou telle doctrine des points de divergence. Historiquement tout s'est passé comme si la connaissance de la théologie islamique était utile à la formulation propre de la pensée juive, au même titre que la connaissance et la discussion des doctrines de Platon et d'Aristote2.
Il faut toutefois faire état d'une certaine différence dans l'interprétation du monothéisme entre judaïsme et islam. La notion de monothéisme a deux significations que l'on peut fixer respectivement par les termes d'unicité et d'unité du divin. La première version du monothéisme consiste à professer dans toute sa clarté et toute sa simplicité l'unicité de l'être divin. Telle est la pierre angulaire du credo islamique qui énonce : il n'y a pas d'autre divinité que Dieu. A partir de cette notion pure s'édifie une théologie rationnelle établissant les attributs positifs de cet unique Etre Suprême, lequel est rigoureusement exempt de toute représentation imagée. Rien dans cette conception ne peut choquer un tenant du judaïsme et la théologie juive se présente souvent en première approximation sous une forme semblable.
Cependant, à cette idée d'unicité, le judaïsme en superpose une autre, plus complexe, celle d'unité du divin, qu'il me faut maintenant introduire. Le point de départ en est un saut théologique, en vertu duquel la notion même d'Etre Suprême muni de ses attributs est dépassée, sinon même abandonnée. Dans le Guide des Egarés, Maïmonide a donné de ce saut théologique une formulation sans ambiguïté : en dernière analyse, rien ne peut être positivement énoncé de Dieu. Toute affirmation sur Dieu est une manière de parler excluant son contraire. L'ultime théologie du judaïsme, dit fermement Maïmonide, est négative. La théologie négative définie par Maïmonide place la notion de Dieu dans une transcendance qui non seulement échappe à toute représentation imagée, mais, plus que cela, échappe à toute détermination conceptuelle. Une expression nette de la différence qui apparaît ici entre pensée juive et pensée islamique a été également énoncée par le Rav Kook : le Dieu de l'islam se présente comme un Infini conçu, atteint conceptuellement ; le Dieu du judaïsme comme un Infini non conçu. Une autorité majeure du 18-ème siècle, le Gaon de Vilna, ira même encore plus loin dans cette radicalisation en énonçant : «de l'Infini, on ne peut rien dire ni penser, on ne peut même pas le définir comme l'Existant nécessaire 3.»
Conséquence de ce saut théologique, la relation à l'Infini ne saurait conserver son caractère de simplicité immédiate et directe. Elle se produit à travers les multiples figures où nous rencontrons l'Infini selon une détermination partielle. Pour le dire schématiquement, c'est à travers un monde de valeurs, qui, elles, sont tout à la fois infinies et concevables que s'effectue la relation à l'Infini. Dès lors le principe monothéiste prend une nouvelle signification : il consiste en l'affirmation de l'unité ultime des valeurs, et en conséquence leur conciliation possible, par delà la variété ou les contradictions dans lesquelles nous les saisissons. Telle est l'inspiration centrale de la loi juive : construire un modèle d'existence prenant en compte les nécessités concrètes et au sein duquel chaque aspiration humaine, chaque idéal, chaque transcendance, puisse trouver sa place. Il ne s'agit plus tant d'affirmer l'unicité de l'Etre suprême que l'unité dernière des formes de notre relation à l'Infini, laquelle ne peut se produire qu'à travers une multiplicité de valeurs4. Voici comment Léon Askénazi, à la suite de Jacob Gordin et d'Elie Benamozegh, résume cette conception du monothéisme :
La "sainteté", pour la Torah, c'est l'unité de toutes les valeurs. Chaque peuple, chaque nation, chaque tradition, chaque doctrine, chaque religion à la limite a, semble-t-il, pour tâche dans l'histoire de mettre en évidence, de façon spéciale, telle ou telle valeur en particulier. Le cas du judaïsme est à part. Son idéal, c'est l'unité des valeurs. Jacob Gordin, mon maître, citait le rabbin Elie Benamozegh, qui dans Israël et l'humanité écrit : Chaque nation, chaque tradition a une perle ; mais Israël est le fil du collier5.
Cette conception ne signifie pas relativisme, absence de toute hiérarchisation. Au sein de la constellation des transcendances qui se dévoilent avec l'apparition de l'humain, le judaïsme a des préférences nettes. Pour lui l'éthique, visée d'un perfectionnement personnel bien sûr mais surtout souci des obligations envers autrui et réalisation collective de la justice sociale, tient une place centrale ou en tout cas une place de choix. Le judaïsme privilégie une relation à l'Infini dont l'action morale est à la fois l'accomplissement et le témoignage. Voici comment s'exprime Emmanuel Levinas :
La relation morale réunit donc à la fois la conscience de soi et la conscience de Dieu. L'éthique n'est pas le corollaire de la vision de Dieu. Elle est cette vision même.... Dans l'Arche Sainte d'où Moïse entend la voix de Dieu, il n'y a rien d'autre que les tables de la Loi... ``Dieu est miséricordieux'' signifie ``Soyez miséricordieux comme lui''... Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire... Le pieux, c'est le juste6.
De même le Rav Kook écrit :
Cela ne nous chagrine pas si telle ou telle structure de justice sociale s'établit sans la moindre mention de Dieu, car nous savons que la seule exigence de justice, sous quelque forme que ce soit, constitue par elle-même l'épanchement divin le plus lumineux...7
Cependant hiérarchiser la constellation des valeurs ne signifie en aucune façon exclusion de l'une quelconque d'entre elles. Il suffit pour le judaïsme que soient respectés certains principes tenus par lui pour universels qui, pour la plupart, sont commandés par la raison ou se trouvent à la base de toute civilisation humaine. Le judaïsme fixe ces principes dans ce que le Talmud appelle les lois noachides, les lois des fils de Noé. Or il est facile de montrer que l'islam satisfait amplement aux exigences de ces lois noachides. En conséquence, nous avons la réponse à la question qui nous est posée : on ne saurait par définition associer à la relation entre judaïsme et islam la notion de choc des valeurs. Ce serait d'emblée contraire à l'idée monothéiste telle qu'elle est comprise par le judaïsme, unité ultime à la fois déclarée et construite de la multiplicité des accès à l'Infini, chacun de ces accès ayant sa pleine légitimité. C'est, entre autres, et peut-être même à une place privilégiée, le cas de l'islam.
Tant que nous nous maintenons sur ce plan théorique, toute divergence entre judaïsme et islam a donc vocation à se concrétiser dans une confrontation d'idées menée sur un mode amical, voire même fraternel. Mais un problème grave apparaît lorsque le monothéisme de l'unicité de l'islam se traduit de façon mécanique dans la vie sociale et politique. En effet, corollaire de la notion d'unicité, la ligne de plus grande pente de cette traduction tend à l'instauration d'une société religieusement homogène, éventuellement même totalitaire. Cette ligne de plus grande pente a souvent été suivie dans le monde islamique, avec notamment pour conséquence pour la communauté juive une situation de soumission institutionnelle accompagnée d'humiliations juridiquement formalisées. Cependant je ne prétends pas qu'il doive obligatoirement en être ainsi. Assurément l'islam peut être interprété sur un mode nuancé et tolérant et cela s'est effectivement produit à certaines périodes heureuses.
A partir du 20e siècle, la tendance hégémonique de l'islam, en corrélation avec la transformation de l'existence juive, a conduit à un nouveau conflit qu'il me faut maintenant décrire. Avec la naissance du mouvement sioniste, le peuple juif est entré dans une nouvelle phase de son histoire. Tout se passe comme si le peuple juif, considéré comme un tout, avait décidé de mettre un terme à des siècles de dispersion et d'absence d'indépendance politique en rétablissant sa souveraineté sur tout ou partie de la terre de Palestine. Or cette terre étant considérée comme une terre musulmane, la réalisation d'un tel processus est inadmissible pour un islam à tendance hégémonique. D'où la naissance d'un conflit de type très spécial. Ce n'est pas un conflit entre deux peuples, tel le conflit israélo-palestinien, où deux peuples se disputent une même terre. Ce n'est pas une guerre de religion, telles ces guerres qui ont opposé dans le passé l'islam et la chrétienté. Ce n'est pas non plus le choc de deux empires ou de deux systèmes sociaux. Dans tous ces exemples classiques les protagonistes, les entités qui s'opposent, relèvent d'un concept commun, peuple, religion, empire, système social. Alors qu'ici nous nous trouvons en face d'un conflit dont les protagonistes sont d'un côté une religion, un monothéisme à visée hégémonique, l'islam, et de l'autre un peuple, le peuple juif, l'essence du conflit étant la contestation religieuse d'une souveraineté nationale.
Cette hétérogénéité entre les parties en cause donne au conflit un caractère d'extrême rigidité. Les termes dans lesquels ce conflit se pose, religion à vocation hégémonique contre peuple aspirant à son indépendance, privent un dialogue de tout objet possible et même d'un langage commun et semblent ne pouvoir conduire qu'à la violence. Comment concilier l'eau et le feu ? Avant de revenir sur ce point dans un instant, je veux souligner deux éléments qui se combinent pour aggraver encore de façon non négligeable la rigidité issue de cette difficulté conceptuelle.
Le premier élément est la dispersion du peuple juif, dispersion en premier lieu géographique mais aussi culturelle. Qu'y a-t-il de commun entre des Juifs intégrés à des nations et à des cultures différentes ? Dans un opuscule célèbre de 1913, Staline avait établi les cinq critères constitutifs de toute identité nationale, et, sur la base de cette analyse, il avait logiquement conclu que les Juifs ne sauraient prétendre à une telle identité. Sans reprendre le détail de la construction stalinienne, les autorités islamiques utilisent souvent une argumentation voisine qui n'accorde à l'existence juive que l'unité d'une religion. Qu'importe si cette argumentation est effectuée de bonne foi ou non ? Dans tous les cas elle contribue à la rigidité du conflit.
Un deuxième élément tient au fait que le processus historique en cours est loin d'être achevé. La majorité du peuple juif vit toujours en diaspora et il n'est pas besoin d'être prophète pour prévoir que, sauf circonstances inattendues, son rassemblement en Israël ne sera pas accompli avant plusieurs dizaines d'années. La nécessité d'une telle durée conduit tout naturellement à nier non seulement la légitimité mais la réalité même du processus. Ne doit-il pas être interprété comme une pure utopie à laquelle les dures lois de l'histoire finiront par mettre un terme ?
Les deux éléments que je viens de mentionner, dispersion du peuple juif et longueur inévitable de son rassemblement, peuvent se réunir en un même argument auquel il est malaisé de répondre. L'histoire ne fournit aucun exemple d'un peuple exilé de sa terre, dispersé pendant des siècles, se rassemblant à nouveau et retrouvant sa souveraineté nationale.
Dès lors quelle valeur peut-on accorder à une revendication qui n'a aucun précédent ? N'est-ce pas tout simplement une chimère ? Le refus islamique jouit donc d'une cohérence et d'un attrait spéculatif indéniable.
On ne sera cependant pas étonné d'apprendre que la tradition juive prend ici le contre-pied de la position islamique. Dans son ouvrage l'Eternité d'Israël, le Maharal de Prague, une autorité talmudique incontestée du 16ème siècle, établit le caractère inéluctable d'une fin de l'exil. Voici, succinctement résumé, le schéma de son argumentation. Le point de départ en est l'évidence de l'existence d'un peuple juif. Or, dit le Maharal, il n'est pas conforme à la nature des choses qu'un peuple soit dispersé, qu'il ne réside pas sur sa terre et même qu'il soit soumis à la souveraineté d'autres nations. Une situation aussi anormale ne saurait subsister toujours et, tôt ou tard, l'histoire du peuple juif retrouvera un cours normal. La dispersion, l'exil et la dépendance politique ne peuvent être que provisoires.
Partis d'une grande proximité théologique, nous voici donc en face de deux logiques antagonistes. Il faut donc nous demander si ce conflit irréductible doit nécessairement conduire à la violence et si, à plus long terme, on ne peut quand même espérer qu'il trouvera sa solution. A partir de maintenant, c'est surtout ma conviction personnelle que je vais présenter.
Il est concevable que le conflit entre l'islam et le peuple juif subsiste dans sa version théorique sans être accompagné de violence. Il ne manque pas de part et d'autre d'esprits pragmatiques qui, comme Jean de La Fontaine, savent que « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.» La patience et le pragmatisme sont des principes acceptables aussi bien par le peuple juif que par l'islam et ils ont souvent été mis en pratique. Dès lors, on peut concevoir un arrangement provisoire, une sorte de hudna prolongée ou cote bien taillée, permettant à chacun de rester fidèle à sa conception tout en repoussant à une date ultérieure indéterminée son plein accomplissement, excluant par là même le recours à la violence. Mais peut-être n'est-ce qu'un rêve !
Et pour finir, une solution proprement dite du conflit est-elle pensable ? La réponse serait assurément négative si nous n'avions été les témoins en notre temps de la résolution d'un conflit similaire qui apparaissait, si l'on peut dire, encore plus irréductible, je veux parler du conflit millénaire entre le peuple juif et le christianisme ou, plus précisément, l'Eglise catholique. En moins de cinquante ans, il a trouvé sa solution, ce qui était au sens littéral impensable auparavant8. Il est très éclairant d'en décrire les étapes que je ramènerai à trois principales.
Dans un premier temps, sur l'initiative de Jean XXIII, avec le concile Vatican II, l'Eglise catholique a coupé avec son antisémitisme traditionnel. Il suffit de se reporter aux documents diffusés à l'époque par l'opposition au concile pour mesurer l'importance de cette révolution.
Puis, dans les décennies qui ont suivi, nous avons assisté à une révolution cette fois proprement théologique, l'abandon par l'Eglise de la doctrine de la substitution. Le peuple juif n'est plus une branche morte dont l'obstination à refuser le message chrétien explique ou même justifie les malheurs qui l'accablent. Le maintien à côté de l'Eglise d'un peuple juif fidèle à sa foi est désormais reconnu comme absolument légitime, sinon même nécessaire. On attribue souvent à Jean-Paul II le mérite de cette transformation. Il me semble que c'est autant au Cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI et trop vite qualifié de prélat conservateur, que nous la devons. J'ai nettement l'impression qu'il a en tout cas participé directement à la construction théorique de la nouvelle théologie. Enfin dernière étape, grâce avant tout à une décision de Jean Paul II, la reconnaissance par l'Eglise de l'Etat d'Israël. Qu'il puisse subsister telle ou telle divergence plus ou moins importante ne doit pas occulter l'essentiel : sauf retournement improbable, le conflit entre le peuple juif et l'Eglise catholique appartient désormais au passé.
Je n'aurai pas la naïveté de croire qu'il faut s'attendre dans un délai rapproché à une évolution similaire de l'islam. L'espérance d'une solution n'a pas encore de contenu concret mais du moins peut-elle être soutenue en tant qu'idée par l'existence d'un précédent. Je ne peux cependant occulter l'anxiété qui accompagne cette idée et n'ose même pas nommer ce qui a conduit au précédent qui l'a rendue pensable.
Georges Hansel
Footnotes:
1 Léon Askénazi, La Parole et l'Ecrit, vol. II, p. 419, Editions Albin Michel, 2005.
2 Un exemple en est l'analyse faite par Maïmonide de la notion de providence (Guide des Egarés, III-17, Editions Verdier, Paris 1979).
3 Cf. Sifra detsniouta, likouté hagra, sod hatzimtsoum.
4 Les figures de cette visée unitaire, elles-mêmes multiples, sont implicites dans la discussion talmudique, mais, à ma connaissance, seule la Kabbale s'attache à leur thématisation. Encore ne faut-il pas confondre la Kabbale avec les formes perverties, parfois même superstitieuses, sous lesquelles elle est malheureusement popularisée.
5 Léon Askénazi, la Parole et l'écrit, vol. II, p. 437.
6 Difficile Liberté, p. 33, Editions Albin Michel, 1976.
7 Igrot Hareia, I-44, Edition Mossad Harav Kook, Jérusalem, 1962.
8 En 1967, Emmanuel Levinas parlait encore d'un «problème insoluble» et saluait précisément dans l'Amitié judéo-chrétienne «maturité et sérieux pour problèmes insolubles». Il s'agissait seulement de «Reconnaître et nommer ces substances insolubles et empêcher qu'elles n'éclatent en violence, en ruse, en politique, monter la garde devant les foyers des conflits, religiosité et solidarités nouvelles, l'Amour du Prochain est-il autre chose ?» (Par-delà le dialogue, Journal des Communautés, 1967, repris dans Altérité et transcendance, Fata Morgana, 1995).
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires

Commentaires récents
il y a 16 semaines 2 jours
il y a 22 semaines 4 jours
il y a 24 semaines 2 jours
il y a 31 semaines 5 jours
il y a 34 semaines 6 jours
il y a 49 semaines 4 heures
il y a 51 semaines 9 heures
il y a 51 semaines 1 jour
il y a 1 année 3 semaines
il y a 1 année 4 semaines