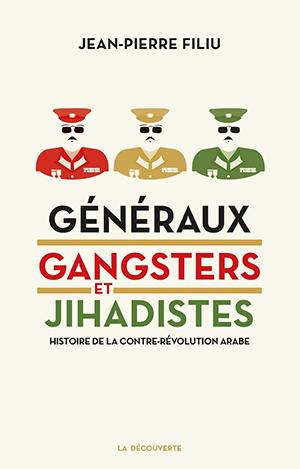
Généraux, gangsters et jihadistes: Comment la Tunisie a échappé à la contre-révolution
Qu’est-ce qui a permis à la transition démocratique tunisienne d’échapper à la contre-révolution qui a, partout dans la région, plombé tout élan contre la dictature. Alors que dans d’autres pays, généraux, gangsters et jihadistes s’allient volontiers pour enterrer toute espérance démocratique, la détermination des Tunisiens à barrer la route à la résurgence de l’Etat profond et à favoriser une démarche institutionnelle pour adopter une nouvelle constitution et légitimer par les urnes les nouveaux pouvoirs, est-elle à l’origine de cette exception arabe? Dans un ouvrage instructif intitulé Généraux, gangsters et jihadistes, histoire de la contre-révolution arabe, paru à Paris aux Editions de la Découverte, Jean-Pierre Filiu nous en fournit des clés de lecture.
Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po (Paris), après avoir enseigné à Columbia (New York) et Georgetown (Washington), l’auteur remonte à l’histoire contemporaine, depuis l’éclatement de l’Empire ottoman et la recomposition du monde arabe pour analyser la construction étatique postcoloniale. Le kamélisme en Turquie et le wahhabisme en Arabie saoudite avaient commencé en idéologies d’Etat par faire avorter la renaissance arabe, encore naissante. Puis, nouveaux Mamelouks, ici et là, Etats policiers, ailleurs, dictatures un peu partout, ont établi des systèmes sécuritaires implacables. Au nom de «la guerre globale contre la terreur», des attelages troubles entre hiérarques militaires et trafiquants de haut vol se sont mis en triade avec des terroristes.
Jean-Pierre Filiu passe en revue les différentes séquences vécues par les pays arabes, pays par pays, notamment les 50 années qui auront été nécessaires de 1922 à 1970 pour qu’ils deviennent progressivement indépendants. Il s’arrête particulièrement sur les luttes sanglantes entre factions au pouvoir, le détournement de ces indépendances et l’arbitraire exercé contre les élites et les démocrates.
L’expérience tunisienne ne doit pas rester unique
Dans un chapitre intitulé «l’alternative tunisienne», Filiu met en exergue «la validité d’une réponse démocratique à l’impasse mamelouke». «La transition constitutionnelle, écrit-il, a été menée à bien malgré la récession économique durable et une menace terroriste sans précédent. La société civile, et, avant tout, l’Ugtt ont joué un rôle majeur dans cette transition, couronné par le prix Nobel de la paix en 2015. Il n’y a aucune fatalité à ce que l’expérience tunisienne demeure unique dans la région, ni à ce que les peuples continuent à être broyés entre dictateurs et jihadistes».
Passant en revue les atouts de la Tunisie dans son «exception», en établissant la comparaison avec d’autres pays, notamment l’Egypte, l’auteur mentionne d’abord que le pays n’avait jamais été soumis aux «Mamelouks modernes» et à la violence engendrée par leurs généraux. Il rappelle que l’armée tunisienne, très républicaine, a refusé en janvier 2011 de tirer sur les manifestants, obligeant Ben Ali à fuir, et qu’Ennahdha, bien qu’émergeant dans une forte tradition islamiste, ne s’était pas allié avec les dictateurs, à l’instar des Frères musulmans en jonction au début avec l’armée, en Egypte.
Une association audacieuse: révolution, réformes et démocratie
L’un des points forts de la Tunisie, estime Filiu, est la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, présidée par Yadh Ben Achour. Il y trouve une association audacieuse entre révolution, réforme politique et transition démocratique. Tout au long de ce chapitre, il passe en revue les atouts de la Tunisie, les occasions historiques qui se présentent au pays et le défi jihadiste. Il n’omet pas de relever que « le doute et la frustration se diffusaient dans la population face aux accommodements entre le parti présidentiel et Ennahdha», de donner écho à une fracture sociale, un sentiment de désenchantement et le décrochage d’une partie des habitants par rapport à leurs compatriotes mieux insérés dans les échanges locaux et internationaux.
«A bien des égards, écrit l’auteur en conclusion de ce chapitre, la Tunisie avait rejoint la famille et les préoccupations, voire les angoisses, de ces démocraties occidentales. Le pays avait dès lors à craindre la virulence de tels débats que son isolement persistant dans un environnement aussi gravement mamelouk».
Bonnes feuilles
Des occasions historiques
La Tunisie avait pour elle de considérables atouts par rapport à l’Égypte dès le début de sa transition post-dictatoriale. Mais le processus tunisien bénéficia grandement de décisions judicieuses, généralement prises à temps, même si c’était parfois, comme bien souvent dans l’Histoire, pour des raisons discutables. L’initiative la plus opportune fut de convoquer d’emblée des élections populaires pour une Assemblée constituante, au mandat initialement fixé à un an. L’élaboration d’une nouvelle Constitution était très largement considérée comme un préalable à la légitimation des nouvelles autorités, et non comme la consécration d’un camp déterminé à l’encontre de ses rivaux politiques.
En Égypte, le CSFA, avec le soutien des Frères musulmans, poussa dès mars 2011 à un référendum sur des amendements limités à la Constitution en vigueur sous Sadate et Moubarak. L’alliance révolutionnaire, qui défendait un vote négatif, fut brutalement désavouée par 77% de suffrages favorables. Cette simple actualisation de la Constitution d’ancien régime laissa la HCC en position d’arbitre suprême. Et la HCC n’hésita d’ailleurs pas, en juin 2012, à prononcer l’illégalité du Parlement élu quelques mois plus tôt dans un scrutin à la fois pluraliste et honnête. Les Mamelouks au pouvoir n’avaient jamais eu l’intention de laisser le dernier mot au suffrage universel. Le Parlement élu de novembre 2011 à janvier 2012 avait donc été privé de pouvoir réel bien avant sa dissolution par la HCC, puisque le gouvernement n’avait de compte à rendre qu’au CSFA.
Les Frères musulmans, après l’élection de Morsi à la présidence en juin 2012, tentèrent de trancher ce nœud gordien en faisant adopter une Constitution qui divisa profondément le pays, malgré les 64 % de votes positifs. Six mois après son coup d’État, Sissi espéra lui-même renverser la tendance avec une Constitution taillée à sa mesure, et approuvée par un vote officiellement proche de l’unanimité. Au-delà des revirements des salafistes, hier partenaires des Frères musulmans, désormais ralliés à Sissi, une fraction importante de l’électorat égyptien avait voté pour deux textes d’inspiration opposée en à peine plus d’une année.
Cette succession de référendums âprement disputés déboucha sur ce que le politologue Nathan Brown a décrit avec finesse comme le «cul-de-sac constitutionnel de l’Égypte 2». La Tunisie, par contraste, se garda bien de tels raccourcis, porteurs d’aussi tragiques impasses. Les instances de transition repoussèrent de trois mois les élections constituantes prévues en juillet 2011. L’Assemblée ainsi élue se donna plus de deux ans, malgré un mandat originel fixé à une seule année, pour élaborer un texte dont les 146 articles furent discutés et approuvés séparément. La Constitution, une fois finalisée, fut soumise au vote de l’Assemblée et approuvée par 200 élus contre 12.
Un référendum aurait pu susciter en Tunisie des divisions aussi vives qu’en Égypte. L’Assemblée constituante avait donc assumé sa mission d’aboutir à un consensus sur les questions les plus polémiques. Les deux premiers articles ne pouvaient être soumis à révision. Et le premier était repris de la Constitution de 1959: «La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime.» L’ambiguïté constructive découlait du fait que, Tunisie et État étant en arabe deux termes féminins, l’islam pouvait dès lors être considéré comme la religion du pays ou celle de l’État. Le second article énonçait la nature «civile» de l’État, dans un refus parallèle des options «militaire» et «religieuse». Les articles 40 et 46 consacraient l’égalité entre les sexes, allant plus loin que bien des Constitutions occidentales en matière de parité parlementaire et de lutte contre la violence domestique. Le compromis entre la préférence laïque pour un système présidentiel et le soutien islamiste à un régime parlementaire conduisit à un équilibre institutionnel entre le chef de l’État (élu au suffrage universel direct) et le Premier ministre (responsable devant le Parlement).
Quant à l’Égypte, malgré son attachement proverbial à l’ordre et à la stabilité, elle s’offrit le luxe discutable de trois Constitutions en trois ans, sans jamais atteindre une formule de consensus durable. La Tunisie, dans l’intervalle, œuvrait patiemment à l’adoption de la charte fondatrice d’une nouvelle étape de son histoire. Le mode de scrutin était aussi très différent entre les deux pays: il contraignait en Tunisie le parti arrivé en tête à se concilier des partenaires de coalition gouvernementale, alors que la prime au vainqueur, même en cas de majorité relative, prévalait en Égypte. Là encore, un tel système, loin de favoriser la stabilité, creusait les divisions politiques : Ennahda et les Frères musulmans avaient tous deux recueilli 37% des voix aux premières élections libres de l’automne-hiver 2011-2012, mais les islamistes tunisiens n’obtenaient que 89 des 217 sièges de la Constituante, contre 235 des 508 députés pour leurs homologues égyptiens.
Les Frères musulmans égyptiens pouvaient s’appuyer sur les 121 députés salafistes pour atteindre une écrasante majorité sur les sujets les plus sensibles aux yeux du courant laïque, et donc lui imposer leurs vues. Ennahda dut, au contraire, nouer un pacte tripartite avec le Congrès pour la République (CPR), nationaliste, et Ettakatol, social-démocrate. Les islamistes présidaient et dominaient le gouvernement de coalition, tandis que le CPR obtenait la présidence de la République, et Ettakatol celle de la Constituante. Nous avons vu comment la HCC, mise en place par Moubarak, finit par dissoudre le Parlement égyptien, dans une vaine tentative pour barrer la route aux Frères musulmans, vainqueurs de la présidentielle juste après. La séquence tunisienne, malgré une succession de crises, fut beaucoup moins heurtée en ce que la Constituante accomplit son mandat et adopta, en janvier 2014, la charte fondatrice de la IIe République. Ennahda accepta alors d’abandonner la présidence du gouvernement pour qu’un cabinet d’inspiration technocratique organise les premières élections authentiquement parlementaires (la Constituante n’avait fait office d’Assemblée nationale que par défaut, sa mission étant justement constituante).
Ce ne fut qu’à l’issue de ces législatives d’octobre 2014 que se déroula le scrutin présidentiel de décembre, près de quatre ans après la chute de Ben Ali. Le contraste était cruel avec l’Égypte, où les Mamelouks avaient vidé de leur substance les premières élections parlementaires, misant sur la polarisation induite par une compétition présidentielle. Ce jeu dangereux s’était retourné contre eux avec l’élection de Morsi, en juin 2012, mais ils avaient pris leur revanche avec le coup d’État de Sissi, un an plus tard. Les promesses de tenue de nouvelles législatives avaient vite été balayées par les putschistes, au profit du plébiscite de mai 2014 en faveur de Sissi («élu» avec 97% des voix, soit neuf points de plus qu’Assad à la même période). Le scrutin parlementaire de l’automne 2015, boudé par l’électorat égyptien, n’avait dès lors abouti qu’à l’avènement d’une chambre d’enregistrement.
Au-delà de la vitalité de la scène politique et de la société civile en Tunisie, la séquence institutionnelle a bel et bien préservé ce pays des pièges où l’Égypte post-Moubarak s’est embourbée, jusqu’à se paralyser. La Tunisie, à la différence de l’Égypte, a ainsi vécu un authentique changement de régime.»
Généraux, gangsters et jihadistes,
Histoire de la contre-révolution arabe De Jean-Pierre Filiu
Editions de la Découverte, Paris, 2018
Version papier : 22 € Version numérique: 14,99 €
Leaders.com.tn
